12/09/2013
KR'TNT ! ¤ 155. CHROME CRANKS / JALLIES / DOGS / BOB LUMAN / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE
KR'TNT ! ¤ 155
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
12 / 09 / 2013
|
CHROME CRANKS / JAILLIES / DOGS / BOB LUMAN / PIERRE LATTES / CHRONIQUE VULVEUSE ( II ) |
PARIS / POINT EPHEMERE / 03 – 09 – 2013
THE CHROMES CRANKS
LES CHROME CRANKS ONT DU CRAN
Quand on vous pose la question : «Quels sont les plus grands hurleurs de l'histoire du rock ?», vous répondez immédiatement Little Richard et Wilson Pickett. Puis, après quelques secondes de réflexion, vous ajouterez sans doute les noms de Frank Black, de Jeffrey Lee Pierce et de Gerry Roslie. Et les plus pointus iront chercher des noms comme ceux de Bobby Hocko (Swamp Rats) ou Chetley Cheetah Weise (Quadrajets, Immortal Lee County Killers).
Mais si on voulait rétablir une sorte de vérité historique, le titre de champion du monde toutes catégories du scream reviendrait à Peter Aaron, figure de proue des Chrome Cranks, ce groupe-vaisseau fantôme qui hante les Sargasses de nos imaginaires depuis vingt ans.

Le groupe semble en effet sortir de l'un des contes les plus sombres d'Edgar Poe. Il se dégage d'eux une sorte de majesté vermoulue qu'on ne retrouve qu'à bord des vaisseaux abandonnés, lorsque dans l'épaisseur des ténèbres, les craquements du bois se mêlent aux hurlements du vent. Ce groupe détient l'indicible pouvoir de hanter à la fois les épidermes et les consciences. Mais ces gens-là ne recourent pas aux petits stratagèmes utilisés par les grands méchants loups du gothique, oh la la, pas du tout. Les Chrome Cranks sont issus d'une lignée urbaine purement new-yorkaise qui remonte au Velvet Underground, à William Burroughs et aux Fugs et qui élève le trash au niveau d'un art suprême. Ils croisent la prodigieuse agressivité du chaos urbain new-yorkais avec l'énergie diabolique de Howlin' Wolf et l'intelligence sulfureuse d'Ambrose Bierce. Ils donnent à la culture trash ses lettres de noblesse, la rendant enfin audible après l'insupportable barbarie sonique issue des scènes hardcore de Washington D.C. et de Los Angeles.
L'aventure commença dans les années quatre-vingt dix par une petite photo publiée dans la rubrique «On» du New Musical Express. Pour les groupes débutants, cette rubrique constituait une sorte de tremplin fatidique. On y qualifiait les Chrome Cranks de stoogiens, alors, il n'en fallut pas davantage. Cap sur le rayon import des deux ou trois disquaires parisiens capables de proposer ça et wham bam, thank you pas mam mais On, ce fut une sorte de jackpot. (J'ajoute que la rubrique «On» du NME fut tout le temps de sa durée une référence absolue.)

J'ai d'abord eu dans les pattes le second album des Cranks paru sur Crypt, «Dead Cool», et ce fut un choc comme on en ressent peu dans une vie d'amateur. Là dessus, cinq morceaux relèvent du pur génie : «Desperate Friend» - enfoncé au pilon, monté sur un riff massif d'une autre époque, de type «Gloria» des Them, glorieux mélange de garage d'Irlande du Nord, de sauvagerie à la Howlin' Wolf et de majesté crampsy - «Way Out Lover» - la bombe du siècle, un champignon atomique de basse fuzz qui dilate le bulbe, pièce imbattable, oh ya ya, balayée par des vagues fuzzo-subliminales, et Peter Aaron hurle à la vie comme à la mort, spectaculaire et vertigineux, c'est battu à la forge derrière, non, il n'existe aucun équivalent sur le marché - «Bloodshot Eye» - pièce purement stoogienne de type «Down In The Street», riff de rue qui s'enfonce dans la pénombre - «Nightmare In Pink» - mètre-étalon du trash-punk new-yorkais, pure giclée de jus, magnifique de délabrement mongoloïde, dynamitée à chaque instant - et l'immense «Shine It On», rien au dessus, tendu dans la chair du punk-rock, irradié par l'ampleur du scream, porté par la clameur de l'insanité, au-delà de toutes les normes, au-delà de TOUT, explosion de toute la pulsion sexuelle du rock. Le morceau le plus hurlé de l'histoire du rock, monté en épingle et explosé au sommet du riff. Qui peut égaler ce screamer fou ? Personne. Cette déflagration sonique surpasse celle des Stooges. Eh oui, on ne croyait pas ça possible et c'est arrivé près de chez vous, une balle dans l'oreille, shine it oooon yeahhhh, l'inaccessible étoile du trash. On prend feu en écoutant ça. Comme si on rôtissait en enfer et qu'on avouait, avec une certaine morgue, adorer ça.

Les Chrome Cranks vont enchaîner trois autres albums remplis à ras-bord de classiques : «Chrome Cranks», puis «Love In Exile», et «Hot Blonde Cocktail». Avec le morceau qui donne son titre à l'album «Hot Blonde Cocktail», Peter Aaron nous plonge dans l'ivresse de la folie. Couplets posés et refrains échappés de l'asile. Personne n'est allé aussi loin que lui dans l'arrachage de barrières de sécurité, à part Antonin Artaud. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer Artaud à notre époque. Il aurait adoré les amplis Marshall et les Fender Jaguar, les flaques de bière sur la scène et les traces de sang sur le tablier de la guitare. Il aurait hurlé son ventre de poudre ténue et le sexe du bas de son âme qui monte en triangle enflammé. Il n'aurait pas engagé Marthe Robert ni Jacques Prevel, mais Bob Bert à la batterie, William Weber à la guitare et certainement Jerry Teel à la basse. Peter Aaron se serait incliné devant le maître et aurait accepté de voir son orchestre le quitter. Sur Hot Blonde, on trouve aussi ce vieux classique des Cranks, «Lost Time Blues», fuzzy et riffé comme un classique des sixties, solidement arrimé et secoué de petites explosions intraveineuses - et le screamer le plus ardent du XXe siècle invente le trash éternel, celui qui va marquer les mémoires au fer rouge. Tout l'esprit du rock ultime se trouve piégé dans cette pièce crampsy et maudite. Au-delà, il n'y a plus rien, comme dirait Léo Ferré.

Le groupe a tenu dix ans. C'est un record, pour une pétaudière à huit pattes. Puis vint le split. En 1996, paraissait «Diabolical Boogie», un double album proposant les singles, les démos et les raretés. Peter Aaron profitait de l'occasion pour écrire un texte d'introduction digne de celui proposé par Lux Intérior dans «How To Make A Monster». Ce texte magistral s'intitule «Cordes cassées, rêves brisés (et des crachats)». En voici le début : «Ce n'est pas un texte de présentation, c'est un exorcisme. Pour moi, en tous les cas. Oh je sais que ça peut sembler pathétique. Je veux dire, les Chrome Cranks n'étaient rien d'autre qu'un groupe de rock en plus. Mais c'était MON groupe. Être dans un groupe, c'est comme être marié. Quand un groupe s'arrête, comme le font la plupart des groupes, c'est dans la grande majorité des cas pour les mêmes raisons que celles qui détruisent un mariage : la jalousie, l'absence de communication, l'arrogance et parfois des abus de substances. Vous voyez de quoi je veux parler. Ça oui, on a eu tout ça dans les Chrome Cranks, et à la puissance dix. Moi-même, je peux plaider coupable pour au moins deux des raisons citées (mais pas la dernière, à moins que vous ne considériez la caféine et la nicotine comme des drogues). J'aurais bien aimé pouvoir comprendre tout ça à l'époque, mais... Toujours pareil, blah blah blah, à quoi bon ?» Il rend ensuite hommage à ses amis Jerry Teel, Bob Bert et William Weber : «En observant le line-up classique des Chrome Cranks depuis mon promontoire du XXIe siècle, je vois un ensemble de choses qui permettent de distinguer le groupe de la scène garage classique et «rétro» à laquelle on nous rattachait. On avait des atouts comme par exemple les lignes des basse néandertaliennes de Jerry, ou la distorse de dingue et l'insupportable volume sonore que je sortais de mon ampli. C'est la frappe extrêmement brutale de Bob qui emmenait le groupe, et il frappait toujours comme un malade, que ce soit sur scène ou en studio. Et comme je suis un fervent amateur de rock depuis trente ans, je peux vous dire en vous regardant dans le blanc des yeux qu'il existe peu de guitaristes du niveau de William G. Weber. Ce mec anormalement doué peut jouer dans n'importe quel style et il joue bien mieux que n'importe quel guitariste de la scène new-yorkaise des années 90 - et même encore aujourd'hui - et bizarrement, personne n'a pensé à enregistrer ce guitariste de génie. Oh, n'oublions pas ce screamer fou qu'on entend sur les vieux morceaux rassemblés sur cet album, je suppose qu'il fait lui aussi partie des atouts. Peut-être n'étions-nous pas le groupe le plus original de l'histoire du rock, mais on y croyait dur comme fer et on a vraiment essayé de rester aussi inventifs qu'on le pouvait, tout en restant dans la cadre que William et moi avions pré-défini au départ. En règle générale, les journalistes appréciaient beaucoup les Cranks.»

Véritable fatras hystérique, «Diabolical Boogie» dégueule de fuzz et de scream de partout. Avec les Chrome Cranks, on est sûr d'aller de blast en blast. C'est écrit, comme dirait Léon Bloy, le grand punkster de l'Avant-siècle. Sur quel autre disque peut-on trouver un tel shoot de trash-blues toxique ? Aucun. L'objet reste unique au monde. Dès le premier morceau, «Love And Sound», les Chrome Cranks nous plongent la tête dans leur chaudron, c'est trashé dans l'âme, yah-yah ! Et Peter Aaron hurle comme un beau damné, il explose de trashitude céleste, il est l'empereur du trash derrière lequel l'herbe ne repousse pas, il bat tous les records de hurlements de Sainte-Anne, il hurle comme s'il voulait conjurer tous les démons de la création («The Big Rip-Off»), atmosphères plombées et rafales de scream, telle est leur recette, on a l'impression de voir un morceau en putréfaction, ou des organismes incandescents, succession de couplets hurlés dans la nuit glacée («Sacred Soul»), Bob Bert cogne dans tous les coins, solos outranciers et écarts de voix impardonnables («Street Waves», reprise de Pere Ubu). «Pin-Tied» est un clin d'œil au swamp-blues. Les alligators de Screamin' Jay Hawkins et de Roky Erickson se pavanent dans la mélasse sonique. Les Chrome Cranks sonnent parfois comme ces pauvres tarés de Birthday Party. Ils prennent le parti-pris de l'épaisseur du non-retour. C'est une abomination. Peter Aaron vient hurler par là-dessus. On retrouve l'atmosphère des Scientists, les ambiances irrespirables, les moustiques, les sangsues, les Seminoles, les flèches et les cadavres qui flottent. La musique tournoie sur des accords séculaires. Et puis ce «Red Dress», d'une rare violence, embarqué au scream et viandé à coups d'accords stoogiens, pur génie trash, sommet de la vraie jute et screamé jusqu'à la racine du son primal, comme s'ils ouvraient une voie vers une nouvelle sorte de folie libératrice. Une folie de la modernité, telle que la concevait certainement Artaud. Stoogerie encore avec «Collision Blues», mais les élèves dépassent les maîtres, Peter Aaron pose une voix à la Iggy sur un beat rebondi et ça devient rapidement effrayant de collusion collutoire, puis ça jaillit et ça explose dans le magma des enfers rouges d'un cerveau en contusion, yah yah yah ! celui de Peter Aaron. Ils semblent encore s'enfoncer dans le chaos avec cette version de «Burn Baby Burn», drumbeat dément, l'une des intros du siècle, beat plombé, menaçant, l'empire du binaire de la mort noire, et Peter Aaron fait le loup derrière. Les guitares se fondent dans la fournaise. La voix de Peter sort du fond de la crypte. Le beat enfonce les clous. Bob bat le beat des dieux viking. Peter Aaron sonne comme Lux Interior. La pression est terrible. Et soudain, ça se met en route, ça tourne garage, mais garage en feu, c'est hallucinant de barbarie sonique, qui va aller chercher des enfers pareils, à part les Chrome Cranks ? On entend les pas traînants des guerriers ivres de carnage dans les rues de la ville en feu, c'est agité de violents spasmes de riffage sixties. Dans «Come In And Come On», Peter Aaron hurle comme Dracula - Scream Dracula Scream - et William Weber arrose le chaos de jus de bottleneck. Ça sent la friture. Nouvelle version du blues des catacombes, «Lost Time Blues», Peter Aaron fait son bouc émissaire des enfers, c'est dingue ce qu'il peut bien hurler. Dingue, vraiment dingue. Tout est là, dans le néant du scream. On tombe ensuite sur une version live de «Draghouse» : une sauvagerie sans équivalence dans toute l'histoire du rock. Un métro lancé dans la nuit, sans but ni conducteur. Ce truc sonne comme un cauchemar de la révolution industrielle. Une charge de la brigade légère glorieuse et héroïque, une épiphanie des clones du fourbi définitif, du Lovecraft fondu déversé dans l'œil d'Absalon, ça hurle comme sur les croix des hérétiques, à l'époque où l'on fouillait les chairs au fer rouge et où l'on faisait issir les moelles. Ils font même une reprise de «Little Johnny Jewel», le premier single de Television : la reprise du siècle, n'ayons pas peur des mots. Hantée. Esprit es-tu là ? Et puis pour finir, un glam du diable avec la reprise de «The Slider» de TRex. Chaos technique. On sort de ce disque complètement sonné, en maudissant le ciel. Trop éprouvant pour les nerfs, surtout quand on les sait fragiles. Mais si le radicalisme sied à votre tempérament, alors c'est l'orgasme intellectuel garanti, la commotion sidérale. Ça peut même aller jusqu'à la révélation.
Les Chrome Cranks, c'est en effet le groupe parfait. Ils disposent de tous les éléments de choix : le son, le look, les compos, l'esprit, la démesure, le goût du chaos et une certaine «wasted elegance».
Puis, pendant dix ans, aucune nouvelle de Peter et de ses amis. Rien. Pour les admirateurs du groupe, ça semblait incompréhensible. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi les Chrome Cranks vendent-ils moins de disques que Blur ou Radiohead ? Comment lutter contre une telle injustice ?

Et puis le miracle est venu d'un label indépendant du pays basque espagnol, Bang Records. Entre 2009 et 2013, trois nouveaux albums des Chrome Cranks sont parus sur cet audacieux petit label (qui réédite aussi le Gun Club et les Scientists - il n'y a pas de hasard, Balthasar). «The Murder Of Time» est une compilation, par contre, «Ain't No Lies In Blood», c'est bel et bien l'album de reformation du groupe. C'est toujours aussi hanté, aussi pilonné, les Cranks appliquent les mêmes vieilles recettes apocalyptiques, multipliant les violentes montées en température. Dans une reprise de Roger McGuinn, «Lover Of The Bayou», William Weber déverse des déluges de notes et Bob Bert démultiplie à l'infini les doublements de redoublements. Ils sont encore plus enragés qu'avant. Sur «Rubber Rat», ils virent jazzy, avec un son musclé, vaillant et déterminé. Jerry Teel y joue une ligne de basse souple et élastique. Avec «Star To Star», ils renouent avec le grand art abyssal, dans une ambiance ténébreuse et dangereusement électrisée. «Broken Hearted King» est monté sur une structure bombastique ultra-puissante, un beat de surmenage valvulaire agité de pulsations animales. Encore un morceau mauvais et hérissé. Et Bob bat comme une bête. Toujours ces purées fumantes de distorse et de chant hurlé, comme au temps béni de «Doll On A Dress» et de l'immoral «Dirty Son (Lie Down/Fade Out)».

«Moon In The Mountain» vient de paraître. Cet objet original propose une face en 33 tours et une face en 45 tours. Je recommande la face 33 tours. On y retrouve des morceaux anciens enregistrés pour une radio anglaise, et notamment «Wrong Number» qui vous cueille au menton avec son pilon de grosse caisse, ses couplets vomis et ses cisailleries de guitare. Du velours pour les tympans. Sauvagerie démente ou démence de la menthe, olé ! Merci Bang ! On retrouve ensuite «2:35» avec ses accords martyrs et ses virulences à répétition, «Backdoor Maniac» et ses dynamiques perverses et ses vibrillonnages de scream, ils appuient dessus comme sur une boule de pus, ça gicle ça hurle et ça cavale, yaaah yaaah comme dirait Peter. Bel hommage à Wolf avec «We're Goin' Down», même uh-uuuuh, avec des down qui pleuvent comme vache qui pisse et ça se termine avec un «Down So Low» qui bascule dans une biscaille épaisse et drue. Tout y est. On appelle ça un fantastique album de rock.
Comme Peter est un hyper-actif, il mène un projet parallèle, Avondale Airforce, en compagnie d'un nommé Stanton Warren. Cette fois, ça sort sur Beast, le petit label rennais qui monte. On se retrouve avec un album fascinant et complètement différent de ce que fait Peter avec les Cranks. Il travaille sur des riffs basiques et répétitifs et laisse partir les guitares en différé. L'une part en solo languide et l'autre barbouille un fond de bouillie impavide et jugulée à l'extrême. Tous les morceaux sont des drug-songs maladivement belles comme «Touch My Mind». Il monte aussi des grooves binaires dignes des Cramps, comme dans «Five Seconds». Ce mec est brillant. Shine It On. Il va chercher des sons de réverb vinaigrée bien étudiés. «Stare At The Sun» est une pièce expérimentale hallucinogène de peu de foi et sifflée sur le tard, comme pour mieux envoûter l'auditeur imprudent. Il termine avec «Come To Terms», une balade en demi-teinte doublée d'une scie de distorse. Il joue un solo liquide en continu et place un chant de tuberculeux languide à la Syd Barrett. Encore une fois, le seul mot qui vienne à la bouche, c'est : révélation.

Inutile d'aller chercher des adjectifs pour dire à quel point on était tous contents de revoir les Chrome Cranks sur scène à Paris, au Point Éphémère, par une belle soirée d'été indien. Avec un petit effort d'imagination, on pouvait entendre l'océan clapoter dans le bassin du canal et les mouettes couiner tout autour. Cui-cui-cui ! Comme les pingouins mais aussi comme les péronnelles qui bavachaient aux alentours. William Weber a pris un peu de poids, Bob Bert porte des lunettes et deux mèches blanches ornent son front, Jerry Teel porte une barbichette et un petit chapeau, comme sur les pochettes des albums de son groupe Chicken Snake. Par contre Peter Aaron n'a pas vieilli. Il garde exactement la même allure qu'avant. Stupéfiant. On pourrait le croire vampire, si on se laissait aller à rêvasser. On éprouve une certaine émotion à les voir s'installer sur scène. Les Chrome Cranks sont des héros invulnérables, ne l'oublions pas. Et crack ! Ils envoient la purée sans aucune formalité, on entend battre le gros laminoir des forges du Creusot, bah-boum, bah-boum, et Peter se met à hurler comme un damné, yaaaah-yaaaah. William fuzz-man Weber joue assis. Jerry Teel promène son regard d'aigle sur le public et claque ses grosses basslines binaires et bien épaisses. Bob Bert bat comme Thor. Ses sticks s'abattent comme des marteaux. L'hypnotisme des Chrome Cranks, c'est lui. Crank it up, Bob ! Tambour de guerre ou pilon de forge, bah-boum, bah-boum, c'est au choix. Ils passent une série de classiques à la moulinette, «Nightmare In Pink», «Hot Blonde Cocktail», «Draghouse» et quelques morceaux du dernier album comme «Rubber Rat» et «Star To Star». Ils reviennent jouer deux morceaux en rappel dont le défenestrant «Way Out Lover» qui fait valser pas mal de têtes. Peter Aaron dégouline de partout. Pour lui, le compte est bon.

Edgar Poe nous cueillit en fin de soirée. Retour sur Rouen impossible. Les deux tunnels et les accès A86 fermés. Alors nous nous mîmes à errer pendant des heures, de banlieue en banlieue, nauséeux et hagards, révoltés et ivres de fatigue, comme si le trash des Chrome Cranks prenait enfin tout son sens.
Signé : Cazengler, encore un qui ne change pas de chromerie
The Chrome Cranks. Point Ephémère. Paris Xe. 3 septembre 2013
The Chrome Cranks. Chrome Cranks. PCP Entertainment 1994
The Chrome Cranks. Dead Cool. Crypt Records 1994
The Chrome Cranks. Love In Exile. PCP Entertainment 1996
The Chrome Cranks. Hot Blonde Cocktail. Konkurrent 1996
The Chrome Cranks. Live In Exile. Au Go Go 1997
The Chrome Cranks. Oily Cranks (Early Rare Material). Atavistic 1997
The Chrome Cranks. Diabolical Boogie. Atavistic 2006
The Chrome Cranks. The Murder Of Time (1993-1996). Bang Records 2009
The Chrome Cranks. Ain't No Lies In Blood. Bang Records 2012
The Chrome Cranks. Moon In The Mountain. Bang Records 2013
Avondale Airforce. Avondale Airforce. Beast Records 2012
Sur l'illustration, de gauche à droite : Bob Bert, Willam Weber, Peter Aaron et Jerry Teel.
THOURY FEROTTES / AU THOURY
/ 07 -09 - 2013 / THE JALLIES
Ce n'est pas dans la jungle birmane, mais juste à côté. Quelque part, pas très loin du confluent de la Seine et de l'Yonne, en un de ces endroits perdus où la main de l'Homme n'a jamais mis le pied, si peu fréquenté que les Ponts-et-chaussées se sont abstenus de le signaler par des panneaux indicateurs à moins de deux kilomètres à la ronde. Peut-être vous demandez-vous ce que je fais dans cette obscure campagne perdue au milieu de nullepart alors que guidé par les mille feux de Disney, je pourrais me diriger en toute tranquillité vers le festival rock du Billy Bop's afin d'admirer les Obscuritones. D'autant plus que dans sa pénultième chronique ( livraison 153 du 29 aôut dernier ) le Cat Zengler nous a mis l'eau à la bouche avec leurs trois minettes aguichantes à souhait, dont deux qui se servent de leur tambourin comme d'un volant, un truc dont la teuf-teuf mobile me rabat les oreilles depuis quinze jours.
Oui, mais moi je suis fidèle en amour – j'enlève les nombreuses exceptions qui confirment cette règle intangible – et pourquoi courir après trois donzelles anglaises qui ne baragouinent pas un seul mot de français quand je sais que je vais être accueilli par trois minois souriants les plus réjouissifs de la Seine & Marne. C'est que ce soir les Jallies font leur concert de reprise, le premier de la saison, après ces interminables mois d'été durant lesquels nous avons été privés de leur lumineuse présence.

Apparemment, suis pas le seul à courir au rendez-vous, la rue principale du village – il y en a tout de même deux – est encombrée de voitures. Suis obligé de me garer chez l'habitant dans une cour intérieure. De la lumière fuse de l'entrée du Thoury, une maison avec porte et fenêtres transformée en café. Z'ont rajouté un mini marabout par devant pour abriter tout le monde. Ambiance sympa, familiale et plutôt jeune. Consos pas chères et assez de viande dans mon sandwich pour nourrir la chienne toute une semaine.

Julios est là, tout heureux d'être un instant débarrassé de ses trois harpies qui se changent. L'est tellement soulagé qu'il a même un sourire pour m'annoncer la mauvaise nouvelle du futur CD qui prend du retard à cause de la pochette. Surprise, les trois grâces surgissent de la cuisine et tout le monde se précipite pour une bise... Vous fais grâce des retrouvailles. L'on devrait leur interdire de partir en vacances.
Au Thoury, ils ne font pas les choses à moitié, ils ont dégagé l'équivalent de deux pièces de telle manière que le groupe ait un peu d'espace, de même que la foule qui se presse devant les stars.
PREMIER SET
C'est parti. We are the Jallies qu'elles chantent avec cette perverse candeur qui les caractérise. On le sait, alors en profite pour les zieuter de près. Toutes souriantes et pétillantes. Ceux ou celles qui vous raconteront qu'ils se sont avant tout intéressés à la Gretsch d'Ady sont des menteurs ou des menteuses. Car Ady Blue arbore un de ces décolletés mirifiques, que nous qualifierons d'estival, une échancrure à fondre la banquise ! Et lorsqu'elle entonne Be Bop a Lula elle y met tant de fougue et de foudre que l'on sent que c'est parti pour une bonne soirée.
Le piou-piou blond qui tape comme une délurée sur sa caisse claire, c'est Vanessa, l'a ébouriffé ses cheveux qui frimoussent autour de son minois comme une couronne d'or. Espiègle et taquine, la mignonnette pétille comme les bulles d'un champagne millésimé. Contraste parfait avec la raucité de sa voix.

Suis devant en plein milieu – le meilleur endroit pour l'acoustique de la salle – à égale distance des deux miss, la brune vénéneuse et la blonde boppante, juste en face de Céline. Qui me subjugue. L'a jeté sa robe rouge aux orties, lui a préféré un jean corsaire et un foulard de pirate savamment noué sur sa tête. Trois fois rien, mais d'un chic inimaginable. Sveltesse de gabier virevoltant sur les haubans. Frégate de combat qui file trente noeuds, prête à l'abordage, elle caracole sur les partitions, se moquant de toutes les difficultés.
Elles nous en mettent plein la vue pour pas un rond – aurais-je oublié qu'aucun droit d'entrée n'était exigée – par bonheur il y en a un par derrière qui bosse. Ne s'est pas fait une crête à l'iroquois lui, n'a pas emprunté le boa de sa grand-mère, lui – a simplement emmené son outil de travail, et il stakanovise comme un malade, de toutes les manières peut pas faire grand-chose d'autre, les trois chipies - du genre tais-toi et travaille - lui ont chipé son micro et il n'a plus qu'à plancher sur le bois de sa contrebasse, pourrait aussi se pendre de désespoir à ses cordes qu'elles ne s'en rendraient pas compte. Mais l'on sent bien qu'il y trouve son paradis à fréquenter ces trois Cruella d'Enfer.
Nous aussi. Leur faut encore une victime supplémentaire. Voici qu'elles appellent Jérôme sur scène. Troisième fois qu'il apparaît dans nos chroniques. Le pauvre sait ce qui l'attend. Hurle qu'il n'a pas le temps et se précipite vers le bar car l'alcool aide à oublier les situations les plus terribles. Bonnes filles elles lui laissent le temps d'un morceau pour boire le verre du condamné. Mais nul n'échappe à son destin, et le voici de nouveau rappelé à l'ordre. Le relèguent tout de suite au fond, à côté de Julien. Ce n'est pas parce qu'il joue de la trompette qu'il faudrait qu'il se la pète un peu trop.

Elles en rajoutent un peu. Juste une. Une copine, avec un adorable sourire – quatre filles maintenant sur scène – et la nouvelle venue qui fait les choeurs. Belle voix, très rhythm and blues, du punch et de l'ampleur contenus. S'éclipse sous les applaudissements, avec Jérôme qui n'a pas démérité. L'on comprend pourquoi Imelda May a un trompettiste dans son band, tout compte fait cet instrument souligne le côté swing du rockabilly.
Et le show continue. De la petite bière. L'on sent qu'ils sont contents de se retrouver et de s'amuser ensemble. Particulièrement sur leurs propres créations. Retrouvent leurs marques sans coups fourrés. Se glissent dans leur musique avec délectation et le public en est le premier bénéficiaire.
ENTRACTE

Discussions à tout rompre devant le café car dedans officie, coupe rasta et paumes virevoltantes, un virtuose du djembé. Sait ne pas être ennuyeux sur son instrument, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'amateurs. Captive toute une partie du public.
DEUXIEME SET
Nouvelle recrue. Thémis, un peu impressionnée de sa propre audace au début, l'est vrai qu'elle est bien jeune du haut de sa dizaine d'années et qu'elle esquisse quelques mouvements de danse avec timidité. Nos trois furies l'accueillent – elle détient l'insigne privilège de ne pas être un garçon – avec une telle délicate attention qu'elle finira par s'enhardir jusqu'à reprendre les choeurs au micro sur Whole Lotta Shakin' goin' on. Une future clapper girl. Bon sang ne saurait mentir.
Ne nous laissons pas distraire. Nos trois Jallies sont en forme. Ady a quelque peu évolué dans son jeu de guitare, nous propose un son légèrement moins clair et un peu plus appuyé, une veine bleue de blues noir qui bat sous la peau blanche du rockab-swing. Quand elle chante, elle saisit les morceaux à pleines dents comme un chien enragé qui ne veut plus lâcher le gigot qu'il vient de voler. Muddy Waters criera-t-on dans le public et à son sourire l'on comprend qu'Ady aime patauger dans les eaux boueuses du blues.

Du côté noir de la force les Jallies nous offriront un classique de Hank Snow – chantre du country – mais annoncé selon la version de Ray Charles. Un des plus forts moments de la soirée, qui n'en a pas manqué. Faudra se souvenir aussi dans la série rural blues redynamisé de la version de Goin'up to the country, la partie de l'harmonica remplacée avec brio et imagination par la trompette de Jérôme. Un plaisir rare.
Les filles ne pensent qu'à ça – je pense qu'il s'agit de la recette de la sauce à la béchamel – nous annonce Céline et elles s'aventurent dans une interprétation particulièrement leste et enlevée de Shave Your Pussy – en l'honneur des Spunyboys qui ont l'air d'avoir marqué l'esprit de ces demoiselles.
Un set classique, avec deux pépites de Gene Vincent chères à mon coeur, mais vitesse grand V, un tourbillon endiablé de rythme et de bonne humeur. Julios qui s'escrime sur sa contrebasse par derrière et les trois belles par devant qui vous enfilent des perles de rockab à en-veux-tu, en-voilà. Vous font perdre la tête, mais elles maintiennent le cap au nord les trois sirènes toutes pimpantes qui bondissent sur les vagues de notre bonheur.
Ne doivent pas avoir de maire dans le village, car personne ne vient s'entremettre pour dire que les musicos font trop de bruit, pourtant les fenêtres sont ouvertes, et les Jallies font leurs derniers rappels pépères ( je n'ose pas dire mémères ), épuisées mais aussi heureuses que nous.
Gros succès.
END OF THE ROAD
La Société veille. Un voisin compatissant vient à temps nous apprendre que la maréchaussée tend un guet-apens alcoolémique à la sortie du village. Citoyens, dormez sur vos deux oreilles, le rockabilly ne passera pas ! Pour sûr on est tous partis du côté où ils ne nous attendaient pas.
Damie Chad.
DOGS !
TOO MUCH CLASS...
DOGS, L'HISTOIRE
CATHERINE LABOUBEE
( Avril 2013 / www.la belle saison.fr )
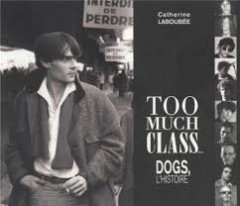
Longtemps j'ai connu les Dogs avant même de les avoir entendus. Savais qu'ils existaient et cela réchauffait le coeur. Des groupes de rock, les étagères de ma chambre en était pleines, pour la plupart britons et amerlocs. En 1974 les Dogs n'avaient même pas encore enregistré un disque, gîtaient à Rouen à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, mais ils avaient l'incomparable mérite d'être français. Ce n'est pas que je fusse particulièrement nationaliste mais à l'époque en 1974, accrocher un wagon à la loco Variations était un enjeu problématique. Pour ceux qui ne le sauraient pas les Variations jouèrent en première partie des New York Dolls aux Etats-Unis... Bien sûr après 1968 l'on avait assisté à un renouveau rock en douce France, mais enfin quand on consentait à enlever le sonotone de l'indulgence franchouillarde des groupes comme Triangle et Ange étaient loin du compte... Elèves appliqués mais peu brillants. Leur manquait l'essentiel ce que possédaient les Dogs, l'esprit rock.
Leur faire-part d'existence je l'ai reçu comme tout le monde, par Rock & Folk, le premier envoi de Philippe Manoeuvre à la revue que vingt ans plus tard il dirigera. Assez convaincant pour lui faire confiance les oreilles vides. Incroyable mais vrai, il existait donc de par chez nous un gang de provinciaux qui s'inscrivaient dans le sillon des Stooges, des New York Dolls, de Doctor Feelgood, saut qualitatif sans précédent de tout jeunes gens se branchaient directement et sans équivoque sur la planète électrique qui orientait nos rêves les plus furieux.
Et puis la vie a suivi son cours. La mort aussi. N'ai jamais eu la chance d'assister à un concert des Dogs, les disques, les articles, les notules qui faisaient régulièrement le point sur le devenir du groupe dans les revues idoines, oui. Jusqu'à ce jour de 2002 où la radio a annoncé la disparition prématurée de Dominique aux States. Coup d'oeil malicieux du destin six ans plus tard Petit Pois des Variations décèdera aussi aux USA...
Il y a quelques années de cela j'avais remarqué dans Rock & Rolk la courte bafouille de Catherine Laboubée demandant à toutes les personnes qui avaient rencontré ou croisé son Dominique de lui envoyer leur témoignage afin de travailler à une bio de son frère... Là encore le temps a passé, et quel plaisir d'apprendre encore une fois dans R & F que le livre était enfin en vente... Bel objet rectangulaire, dominantes de photos en blanc et noir qui collent à l'esthétique du combo, documents rares, belle écriture, un objet hommagial composé avec ferveur.
LA CAT’ HERINE

Pas vraiment une passionnée de rock. C'est Mais la petite soeur a admiré le grand frérot cela se sent. C’est elle qui se chargera de la paperasse du groupe. Secrétaire de direction et pesez bien le sens des deux mots. Son truc à elle, il est en plumes mais de celles que l'on applique sur les feuilles de papier. Historienne qui s'est spécialisée dans les bios savantes comme celles des parents de Charles le Téméraire ( qui finit mangé par les howlin' wolwes ) mais aussi des contemporains, plus humbles, qui ne veulent pas quitter cette vallée de larmes sans laisser, en ultime témoignage à leur proches, la relation de leur vie à transmettre aux petit-enfants et plus si continuation génétique...
S'est aperçue un jour que de s'occuper des inconnus c'était bien mais que l'existence de son propre frère et des Dogs n'interpellaient plus beaucoup de monde. Les rééditions de disques se faisant rares, hormis des groupes de fanatiques, et la région natale de Rouen, la saga des Dogs est désormais en passe d'être versée dans la colonne pertes et profits du rock'n'roll français. Aussi a-t-elle pris son bâton de pèlerin afin de ranimer la flamme du souvenir...
NAISSANCE
Pour une fois les chats accouchèrent d'un chien. Parents pharmacien et toubib, Dominique est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Avait tous les atouts pour finir jeune cadre dynamique. Ne se départit jamais d'une certaine nonchalance attentive, d'une aisance naturelle, d'une discrétion injonctive à entraîner les autres dans son sillage. Le reste d'une éducation bourgeoise – le gros mot qui fait peur - assumée. Une grande maison de vacances au bord de la mer à Saint-Valery-en-Caux, des parents compréhensifs qui laissent porte ouverte – la table et le lit aussi – aux copains et qui n'exigeront pas de leur fils qu'au sortir de ses vingt ans il renonce à ses rêve d'adolescent et songe à se préparer un avenir sérieux... Dominique s'inscrira en licence de lettres, mais même s'il est attiré par la littérature symboliste, sa vraie vie est ailleurs. Dans la musique. Dans le rock'n'roll.
1973 – 1975 / UN GROUPE DE ROCK
La meute des chiens se rassemble très tôt. De tout jeunes chiots qui s’en vont jouer dans le grand jeu de quilles du rock’n’roll. En 1973, en France et à Rouen, ils ne gênent personne. Lubies de gamins qui leur passera avant que ça ne reprenne à d’autres. Même Rimbaud l’a dit, l’on n’est pas sérieux lorsque l’on a dix-sept ans. Ou même seize. Sont quatre, Michel Gross l’ami d’enfance qui délaissera la guitare pour la batterie, François Camuzeaux le parisien en vacances surnommé Zox à la basse qui en 1974 ramène de la Capitale un pote à lui qui sait jouer de la guitare ( tout de même ! ) Paul Péchenart. Dominique Laboubée le grand catalyseur d’énergie. Ce début à trois puis cette conjonction à quatre se retrouvera par la suite dans l’histoire des Dogs. Il est difficile d’échapper à son karma comme disent les hindoux.
Un groupe de rock sans influence, ça n’existe pas. Même Elvis s’est inspiré de Roy Hamilton. Les Dogs ont déjà en ces jeunes temps du rock’n’roll l’oreille dans le rétro. Branchés sur les sixties, les Kinks et le Velvet Underground, plus un groupe américain californien qui eut à l’époque pour le réveil des consciences rock autant d’importance que Dr Feelgood quelques années après eux, les légendaires Flamin’ Groovies. Dans un premier temps les Groovies remontèrent aux pionniers pour saisir l’essence rebelle du rock originel. Mais dans un deuxième ils se convertirent au son anglais, moins de rugosité, moins de violence brute, ou du moins une brutalité sous contrôle, mais une intelligence esthétique du moindre morceau repris ou original. Un cheminement à l’encontre du tout rentre dedans des Stooges et des New York Doll. Le plus anglais des groupes français de rock est une étiquette qui colle encore aux Dogs.

En deux ans les Dogs vont sortir de leur anonymat provincial. Suivent la route rectiligne du rock français empruntée par des milliers de groupes à cette époque qui mène de la sortie du lycée au Golf Drouot. A part qu’ils sont meilleurs que la moyenne, que leurs prestations leur amènent ce premier agrégat de fans sans lequel toute future carrière est inenvisageable pour un combo venu de nulle part. Bénéficient aussi d’un entourage régional positif, l’ouverture en de Mélodies Massacre à Rouen même. Minuscule boutique de disques tenue par Lionnel Hermani branché sur les courants les plus marginaux du rock’n’roll, imports anglais et américains, rares et introuvables. Et puis l’exemple tutélaire de Little Bob Story, le groupe havais de combat rock par excellence.
Le bouche à oreille fonctionne à plein. Encre faut-il savoir résister aux sirènes. Dominique Laboubée n’entend ni brûler les étapes, ni perdre le contrôle de sa création. Les parisiens Zox et Paul, quittent le groupe début 1976, sont récupérés par Larry Martins Factory qui bénéficia grâce à l’entregent de son leader Larry Martin ( rien que le nom du groupe en dit long sur son égo ) d’une bonne programmation radio et d’une belle couverture médiatique, mais qui disparut plus vite qu’il ne l’espérait. C’était ce que l’on appelle un groupe de faiseurs, des gens assez doués pour donner l’illusion aux non-initiés, mais trop peu authentiques pour séduire les connaisseurs.
1976 – 1980 : UN GROUPE DIFFERENT
Le groupe qui vient d’imploser lèche ses blessures. Un copain du lycée Hugues Urvoy de Portzampac – un nom lautréamontesque par excellence – s’installe à la basse. L’année suivante ce sera Jean-Yves Garin qui viendra seconder Laboubée à la basse. Période cruciale pour le groupe qui enregistrera pratiquement en auto production ses deux premiers 45 tours – trois morceaux sur le premier, cinq sur le deuxième, décidément les Dogs trouvent toujours le petit truc pour se distinguer – et pour le rock en général puisque nous sommes dans les années de la grande explosion punk.

Les Dogs ne cèderont pas aux vertiges du punk. Ne jettent pas le bébé du rock avec le tsunami pistolien. Même si les chiens filent un sacré coup de main aux Olivensteins – que nous qualifierons de joyeux plante-merde urticants alliant le vieux fonds d’indiscipline gauloise à la virulence punkoïde -, ils s’accrochent à leurs valeurs. Resteront par exemple fidèles à leurs covers de Gene Vincent, ce qui les inscrit indéfectiblement dans l’historicité du rock’n’roll français.
En 1979, ils signent chez Philips et enregistrent leur premier album, non sans mal – le producteur ne voyant pas plus loin au niveau musical que Michel Sardou ! – Different. Un disque différent qui ne cède pas à la mode du concassage british-punk, mais qui délibérément sonne comme très sixties garage et qui s’offre le luxe d’une pochette de Jean-Baptiste Mondino, photographe rock mode un peu surfait à mon avis, car incapable d’une véritable création. Un artisan mais pas un artiste.
Téléphone bénéficiera lui aussi d’une pochette Mondino, mais ce qui différencie Different de Téléphone, ce sont les accents sur les E. Les Dogs utilisent la langue naturelle du rock. Celle de Shakespeare. Bye bye Molière. Un choix idéologique qui pèsera très lourd dans la diffusion de leur musique en douce France.

Chez Phonogram, filère de Philips, l’on tique un peu sur cette volonté de chanter en français. Walkin’ Shadows sera bien enregistré en anglais mais après moultes tractations le 33 tours sera accompagné d’un simple qui proposera deux titres en français. L’on aura coupé la poire en deux mais Phonogram ne renouvellera pas le contrat. L’on imagine la trombine des grands responsables quant l’on compare les chiffres de vente des Dogs avec ceux de Trust, de Téléphone et de Bijou, qui tous les trois rockent en bon vieux françois… Quant au contenu du disque plus sombre et plus teigneux, ce n’est pas là un argument qui puisse attendrir un décideur…
1981-1989 : LA DECENNIE PRODIGIEUSE
Ne croyez pas aux miracles. Les Dogs capitalisent leurs dix années de galère passées. Nombreuses tournées en France mais aussi en Europe qui attirent du monde. Pourront enregistrer pratiquement un trente-trois tours chaque année, seront couverts d’éloges par les revues spécialisées, mais resteront toujours pour le grand public des marginaux. Ne font pas dans la recherche du consensus mou.

Leur premier album chez Epic / CBS, celui que l’on cite toujours comme une référence absolue du rock français, affirme dès son titre sa différence. Too Much Class for the Neighbourhood, trop classe pour le voisinage, ça sonne comme une claque, cela aurait pu être compris comme une déclaration de guerre. Avec ces six mots – très politiquement incorrect – il y avait de quoi alimenter une campagne de de haine et de dénigrement systématiques. Mais non cela passa comme une lettre à la poste. Tous ceux qui n’aimaient pas les Dogs s’inclinèrent devant cette évidence. Le groupe était à part et malgré de nombreux changements de personnel – l’on remarquera la venue du futur Tony Truant membre émérite des Wampas – l’aura de la formation était trop prégnante pour ne pas arrêter la moindre critique à son encontre. Les Dogs bénéficièrent toujours d’un total respect dans le milieu rock.
Les tournées et les disques s’enchaînent par la suite. Sur leur quatrième album Legendary Lovers ce sera la reprise du Bird Doggin’ de Gene Vincent. Rien que pour cela l’on se doit d’aimer les Dogs. S’en tirent très bien sinon qu’à leur place j’aurais beaucoup plus accentué les lignes de basse, ce fabuleux morceau de Gene Vincent étant construit sur le contraste d’une basse très grave et d’une guitare suraiguë. La Rickenbaker de Dominique offre bien une solution pour exalter les pleurs souverains produits par Al Casey, mais rien n’a été rajouté à la noirceur des profondeurs. L’ouverture et la reprise finale n’ont par contre rien à envier à celle de Gene. L’on en trouvera sur You Tube plusieurs versions live plus ou moins réussies. Pour mémoire nous rappellerons que Noël Deschamps en a aussi offert une adaptation française qui n’est pas à dédaigner, et ce dès 1967.

De 1884 à 1987 les Dogs sont approchés par une des figures essentielles du rock français, Marc Zermati le créateur légendaire du label Skydog, et pièce essentielle de la diffusion du punk en nos contrées retardataires. Les albums se suivent, Shout, More, More, More and A million Ways of Killing Time chez New Rose. Tout semble marcher comme sur des roulettes mais en fait le groupe patauge en ce que l’on pourrait appeler une dépression. Plus de vingt ans que les Dogs courent après les lampadaires du succès… sans succès. Si ce n’est d’estime. Un peu comme quand une fille déclare : “ Je t’aime… bien, tu sais”, et vous comprenez que c’est râpé pour vous.
Comme par hasard en 1987, Hugues quitte le groupe et en 1989, c’est Michel, l’ami, le Mimi de toujours qui s’en va. Entre ces deux dates Dominique a composé Tomber sous le charme pour une jeune égérie de Rouen, Louise Féron. Son 45 se vendra mieux que les disques des Dogs… Le groupe navigue à vue.
1990 – 1999 : DECENNIE DECADENCE
Seuls les empires entrent en décadence et certains historiens assurent que ce sont des années de fastes artistiques. Cherchez l’erreur : les Dogs enregistrent avec John Cale, le violon Trafalgar de White Heat, White Ligth du Velvet Underground pour le futur album de Louise Féron.
Les nouvelles du front sont mauvaises. Le rock se meurt. Les goûts du public sont à l’image des reculades sociales du pays, ils ne se modernisent pas, ils régressent. Cette décennie peu fabuleuse sera celle de l’émergence triomphatrice du rap pour les milieux populaires et le public rock qui se réduit comme une peau de chagrin change le fusil d’épaule. Le rock alternatif prend la relève. Se présente comme un mouvement festif anarchisant ouvert à toutes les musiques du monde. C’est un rock qui a perdu son ancrage originel, il ignore les pionniers et se détourne du blues décidément peu joyeux.

Les Dogs sont redevenus un trio qui durera jusqu’en 1996. Sont partout et nulle part. Sur tous les Tributes élevés à la gloire de la génération punk perdue… Bye bye Johnny Thunders. Sur scène, ils sèment des graines. Nombreux qui les verront en ces époques de reflux rock en garderont le souvenir impérissable d’un groupe qui brûle ses dernières cartouches avec une classe folle. Le rock meurt mais ne se rend pas.
Dominique s’intéresse à deux groupes locaux de par chez lui, Césium et Chainsaw. En octobre 98 et 99 sortent les Volumes I et II de 4 For a Kind qui réalimentent le buzz autour du groupe. La traversée de la mer des Sargasses est terminée.
2000 – 2002 : THE END, BEAUTIFULL FRIEND
Et la roue tourne, le rock redevient à la mode via les Libertines… Les Dogs ont pratiquement trente ans dans le buffet. Question longévité ils sont les Rolling Stones français. La télé se souvient de leur existence. Le titre du double live sorti en août 2001 est à entendre comme un bilan prémonitoire : Short, Fast and Tight. La reconnaissance arrive de tout côté mais il se fait tard dans le jour du monde des Dogs. La mort survient comme l’esprit, sur des pattes de colombes. Au moment où l’on s’y attend le moins, au moment où on a le moins besoin d’elle.
Les Dogs ont tourné un peu partout en France, même dans la perfide Albion avec Dr Feelgood, mais voici que le rêve américain se concrétise. Les voici partis pour dix dates aux USA, le pays du rock’n’roll. Premier concert le 25 septembre 2002, au Lucky Dog Music Hall de Worceter. Dominique Laboubée s’écroule à la fin du premier morceau Death Lane. Simple malaise ? Non, cancer foudroyant. Maintenu en coma artificiel il décèdera le neuf octobre. Le groupe accomplira la tournée sans lui, selon sa volonté…
DOMINIQUE

Si un maître sans son chien n’est plus un maître, les Dogs sans Dominique Laboubée ne sont plus les Dogs. L’histoire s’arrêta là. Catherine n’a pas la force de quitter son frère si vite. Suivent quelques pages de témoignages qui s’attardent non plus sur le musicien mais sur l’homme. Attentionné, simple, disponible et généreux sont les mots qui reviennent le plus souvent…Avant de refermer le livre nous avons encore droit à quelques lyrics. Dominique était musicien et homme de lettres. Important words disait Gene Vincent.
Un beau bouquin. Je ne parle pas des photos – les plus élégantes sont en noir et blanc – mais du travail fourni par la soeurette pour amalgamer les témoignages et les articles découpés dans la presse d’époque. Le livre n’aborde pas l’aspect musical des Dogs. Catherine insistera à plusieurs reprises, elle n’est pas spécialisée es rock’n’roll et refuse de se risquer sur un tel terrain. Rassurez-vous à part un morceau de Bo Diddley attribué à Gene Vincent elle ne commet pas d’erreurs et ses analyses ne sont pas dépourvues de sagacité.
Dominique Laboubée est mort à quarante cinq ans. Assez vieux pour avoir vécu beaucoup de ses rêves, trop jeune pour les avoir tous accomplis. Les Dogs sont en train de devenir le groupe culte du rock’n’roll français. S’imposent sans bruit, leur aura n’en finira pas de grandir dans les années à venir. Un groupe qui a su percer sans appui de la grande presse nationale, n’ont jamais misé sur le scandale pour s’imposer. Point trop de groupies, une accoutumance modérée aux produits, en contre partie aucun affichage de moraline, mais un maximum de rock’n’roll. Les Dogs nous ont laissé un os que nous rongerons toujours.
Damie Chad.
STORIES OF THE DOGS
HISTOIRE POUR DOMINIQUE
( Avril 2013 / Nouvelles Editions KRAKOEN )
22 AUTEURS RENDENT HOMMAGE AUX DOGS
LUC BARANGER / JOSE-LOUIS BOCQUET / THIERRY CRIFO / ALAIN FEYDRI / DENIS FLAGEUL / GEKKO HOPPMAN / JEAN-NOËL LEVAVASSEUR / JEAN-LUC MANET / PIERRE MIKAÏLOFF / MATHIAS MOREAU / MAX OBIONE / JEAN-HUGUES OPPEL / MICHEL PELé / GILLES POUSSIN / JEAN-BERNARD POUY / FREDERIC PRILLEUX / PATRICK RAYNAL / EMMANUEL RIMBERT / ANNELISE ROUX / ROMAIN SLOCOMBE / ERIC TANDY / MARC VILLARD
Réédition d'un livre paru en 2006 et réédité trois fois aux Editions Krakoen. Un projet sympathique. Une espèce de coopérative littéraire initiée par Max Obione qui regroupe des auteurs amateurs de nouvelles et romans noirs. L'idée de base était d'en finir avec l'angoisse de l'écrivain face à la solitude du compte d'auteur. De l'auto-prod au multi-prod. Mais la réalité économique étant ce qu'elle est Krakoen a été confiée à Gilles Guillon et est devenue Nouvelles Editions Krakoen. NLK s'inscrira-t-elle longtemps dans le sillon libertaire de Krakoen ?... Quant à Max Obione il s'en est allé fonder SKA EDITIONS, exclusivement sur le net. A la noirceur du polar de sa première ligne éditoriale il a rajouté le rose érotique, vend ses e-books à des prix compétitifs comme 1 euro.
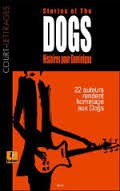
L’idée de départ est toute simple, que chaque auteur s’empare d’un titre d’un des morceaux des Dogs à partir duquel il nous livrera sa vision dogsienne, non pas des Dogs, ou de Dominique Laboubée, mais du monde. Un monde selon les Dogs certes, mais sans limitation territoriale trop limitée. Une moyenne d’une dizaine de pages par participant. Classement par ordre alphabétique pour éviter tous les conflits de préséance qui pourraient surgir.
N’allons pas les chroniquer une par une, mais en élire quelques unes. Comme les rockers sont des gens courtois envers les dames nous évoquerons tout d’abord Mon cœur bat encore d’Annelise Roux la seule fille de la bande. Ne fait de cadeau aux rockers. Les belles idoles morflent un max. Se ruinent la santé à coups de drogues, d’alcools, d’abus divers. Se conduisent comme des enfants gâtés et finissent en adultes pourris. Le pire ce n’est pas le public qui aime cela. Tout le monde adore les films d’horreur. Annelise pensent à la gent féminine qui fait partie de l’entourage intime des vedettes. Les partenaires, les copines, les mères, les sœurs qui supportent tout avec la patience de la Madone. Se contentent pas de prier les mains jointes. Saintes peut-être mais y touchent très gravos. Le rock est-il un monstre froid qui broie ses proies sans rémission ? En tout cas elle évoque le drame antique, inventé dans ces temps bénis où l’on n’avait pas encore inventé la rédemption christique.
Une petite préférence toute personnelle pour Death Lane d’Alain Feydri, pas un hasard, l’a rédigé les monographies des Kinks, des Cramps et des Flamin’ Groovies, univers dogsien par excellence. Vous laisse deviner ce que Charly fera de son premier disque des Dogs. Vous donne un indice, vous serez déjà mort que l’on lira encore Les Fleurs du Mal.
Je terminerai – c’est aussi la dernière du recueil - par un auteur que l’on a déjà rencontré, Marc Villard lorsque nous avons chroniqué Sharon Tate ne verra pas Altamont ( livraison 49 du 22 / 04 / 11 ) et La vie d’artiste ( livraison 51 ), Back from nowhere, un trip adolescence voie sans issue, glauque à souhait, au-delà de la mort. Mais c’est Max Obione qui remportera la couronne funéraire avec Poisonned Town il joue une histoire parallèle au plus près de la mort de Dominique.
Vous en reste une bonne vingtaine à découvrir. Belles, mais acérées. Mais au fait quelle était la couleur noire des Dogs ?
Damie Chad.
LUMAN POWER
Kilgore, 1955. C'est là, dans ce bled texan, que le jeune Bob voit Elvis sur scène pour la première fois. Pouf ! Il trouve sa vocation. Il décide qu'il fera le métier de rock'n'roller, comme Elvis. Quand on cherche sa vocation, il vaut mieux tomber sur Elvis que sur Sœur Sourire, pas vrai ? Enfin, ce n'est qu'un avis personnel.

Et hop, roulez jeunesse ! Il part de zéro : il faut apprendre des chansons, quelques accords de guitare, trouver des copains pour monter un orchestre, trouver un local de répète puis des engagements pour jouer en public. On croit que c'est facile de monter un groupe de rock. Ho mais pas du tout ! Même ceux qui n'ont pas fait l'armée appellent ça le parcours du combattant. Énormément de travail, d'espoirs et d'énergie investis pour le plus souvent un résultat lamentable. Le principe nietzschéen de la sélection naturelle s'applique dans le petit monde du rock avec plus de violence que dans n'importe quel autre domaine.
Pendant tout le début de sa carrière météorique, Bob Luman aura beaucoup de chance. Mais beaucoup moins ensuite.
L'un des meilleurs potes de Bob s'appelle Mac Curtis. Le pote Mac a pris des tours d'avance puisqu'il est déjà signé chez King Records, le label légendaire de Syd Nathan sur lequel on trouvera Charlie Feathers, James Brown et des dizaines d'autres grands pontes du rockabilly et du r'n'b. Mac et Bob jouent un peu ensemble au Texas. Mais chacun doit suivre sa voie.

Puis Bob rencontre James Burton, un petit branleur de quinze ans qui joue de la guitare. On fait un groupe, môme ? Oh yes Bob ! James Kirkland les accompagne à la stand-up bass. Et hop, tournées au Texas, renommée grandissante et un impresario les envoie enregistrer chez un pote à lui, en Californie. Les Texans débarquent dans le prestigieux studio d'Imperial Records, à Los Angeles, pour enregistrer quatre titres.

Pas de doute, Bob allait conquérir le monde. Pourquoi ? Parce qu'il avait du génie rockab. Il faut l'entendre pincer sa voix sur «Whenever You're Ready». Il faut l'entendre glapir sans prévenir dans «Red Cadillac And A Black Moustache». Mais il avait surtout derrière lui le meilleur orchestre de rockab des États-Unis, avec les deux James aux manettes.
Et c'est là, à Los Angeles que la chance va le quitter. Ricky Nelson passait dans les bureaux du label et quand il entendit le barouf qui filtrait à travers la porte du studio, il demanda la permission d'aller voir les musiciens. Il fut tellement impressionné par la vitalité des deux James qu'il leur proposa de venir jouer dans l'émission de télé hebdomadaire de ses parents, Harriett et Ozzy. Le père de Ricky manœuvra ensuite habilement pour faire un pont d'or aux deux James qui du coup sont restés en Californie. Ils devinrent donc le backing-band de Ricky Nelson. Ozzy avait une fois de plus gâté son fils. Et pour couronner le tout, les frères Burnette, fraîchement débarqués à Hollywood, refourguaient des hits à Ricky. Mais ceci est une autre histoire.

Le pauvre Bob est rentré tout seul au Texas. Sa carrière venait de prendre du plomb dans l'aile. À partir de là, il s'éteindra petit à petit, passant du statut de légende rockab à celui moins enviable de chanteur de variétés chiant comme la pluie. Un vrai désastre. Le tout bien imbibé d'alcool, comme on l'imagine. D'ailleurs, le foie du pauvre Bob finira en bouillie.
Quand on connaît les disques de la période enchantée (1956-1957), on sent l'énorme potentiel du groupe qu'il avait monté. Pour Bob, le destin fut particulièrement cruel. Mais il sut rester aimable et les gens l'admiraient pour ça. Pour lui, ça semblait normal que ses collègues aillent tenter leur chance à Hollywood. James Burton tentera de se faire pardonner en revenant jouer de temps en temps avec le pauvre Bob, mais le mal était fait.
Trouver un nouveau guitariste pour remplacer James Burton ? Non, vous rigolez ? Ce n'est pas possible. Eh bien si. Roy Buchanan aura le privilège d'accompagner Bob lors de quelques séances d'enregistrement.

Justement, le seul moyen d'y voir clair dans cette sombre histoire, c'est d'investir dans le coffret Bear Family «Let's Think About Living» qui couvre les années 1955 à 1967. Richard Weize et ses amis ont tout passé au peigne fin. On peut écouter tous les morceaux enregistrés par Bob dans l'ordre chronologique. Chaque séance d'enregistrement est bien documentée. Quand on admire un artiste, on ne peut guère espérer mieux. Et je ne parle même pas de la qualité du son. Incomparable. Si on écoute ça au casque, on grimpe directement au septième ciel.
Ce coffret ne fait que confirmer ce qu'on savait : seul le disk 1 est bon. L'écoute des trois autres fait hélas bâiller d'ennui. N'oublions pas que la vague rockab telle qu'on la vénère n'a duré que deux ans aux États-Unis. Par la suite, les artistes se sont ringardisés ou sont passés à la country. L'arrivée de la beatlemania fut pour beaucoup d'entre eux le coup de grâce. Jerry Lee dut aller mettre le Star Club de Hambourg à feu et à sang pour relancer sa carrière.

Sur le disk 1 se trouvent quelques morceaux datant de 1956 comme «Hello Baby», où l'on entend James Burton s'énerver et faire péter des séries d'arpèges texans qui ont dû faire baver d'envie Hank Marvin. Puis on l'entend jouer en cocotte. James Kirkland fait des prodiges sur des morceaux comme «Jumping With The Shadows» ou «The Creep». Si on aime bien entendre de belles lignes de basse voyageuses, alors il faut écouter ces deux fascinantes splendeurs d'un autre temps.
En 1957, les Texans passent à la vitesse supérieure, avec des morceaux comme «All Night Long» où l'on entend James Burton jouer les virtuoses au fond du studio. Il s'amuse à bricoler une cavalcade hallucinante, un truc à faire baver d'envie Adrian Gurvitz.
Violente montée en température avec «Wild Eyed Woman». Derrière Bob, on peut dire que ça joue. Burton pique sa crise. On se retrouve avec un mid-tempo slappé à convenance, un de ces heavy blues dont les Texans ont le secret. Burton prend une saleté de solo punkish, un truc à faire baver d'envie Jesse Hector. Affolant ! Burton nous fait l'effet d'un véritable voyou du manche. Jusqu'à la fin du morceau, il en rajoute. On se demande comment Bob s'y est pris pour le calmer, à la fin du morceau.

La version de «Red Cadillac And A Black Moustache» qui date de mars 1957 est forcément la huitième merveille du monde. Pur génie et je pèse mes mots. La version de Warren Smith est bonne, mais elle n'atteint pas la cheville de celle de Bob qui est swinguée à outrance et derrière, ce démon de Burton envoie la purée. On ne peut pas rêver d'une version plus spectaculaire.
Le film Carnival Rock date aussi de 1957. On le doit à Roger Corman, personnage légendaire du cinéma de série B américain. Justement, le film démarre avec Bob et les deux James. On est aussitôt effaré par la classe de James Kirkland, par sa façon de tenir le manche de sa stand-up. Il est carrément reptilien. Il fait corps avec le slap. Il faut voir ce film rien que pour le numéro de James Kirkland. Trois couples dansent. L'intrigue du film brille par son inconsistance, comme c'est souvent la cas dans les films de série B tournés à l'époque. Mais ça nous donne le privilège de voir Bob interpréter deux morceaux, «This Is The Night» et «All Night Long», accompagné par les deux James.
On peut réentendre «This Is The Night» sur le disk 1 et c'est wild, comme dirait Oscar ! Le morceau est littéralement hanté par le jeu de James Burton, tout en montées subites de température. Ça baigne dans une liqueur de notes infâmante. Burton ? Un vrai diable. Et le slap de Kirkland ? Une bénédiction. Aucun équivalent dans toute l'histoire du rockab. «The Creep» fut ré-enregistré lors de la session Carnival Rock et c'est probablement la perle qui cache le tas d'or : voilà une chose slappée jusqu'à l'absurde, un instru wildissime qui a dû faire baver d'envie Jet Harris.
La dernière session d'enregistrement de Bob avec les deux James date d'octobre 1957. Ce sera le chant du cygne de la sauvagerie, en ce qui concerne le pauvre Bob. «Whenever You're Ready» est cette belle pièce de swing vrillée dans l'os par un solo enragé de James Burton et qui une fois encore frise le pur génie. Dans «Your Love», Burton redevient fou dans le studio, fou de virtuosité, fou de feeling, il frôle l'apoplexie en permanence, il bat tous les records du monde de picking. On commence à réaliser que le pauvre Bob n'aura en fait servi que de faire-valoir à James Burton. Personne n'avait encore entendu un solo aussi dément. On comprend mieux pourquoi Burton a fini par jouer avec Elvis.
On trouve à la suite deux versions d'un même morceau : «Make Up Your Mind Baby» : la version normale et la version wild (wild one, est-il précisé). Eh bien, écoutez la wild one et vous allez voir trente six chandelles. Bob attaque ensuite une reprise de «Red Hot» qui comme on l'imagine bat tous les records de fournaise rockab. Comme à son habitude, Burton en rajoute. Avec «Guitar Picker», on tombe sur un invité de marque : Eddie Cochran.
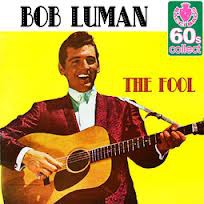
Avec les trois autres disks, les choses se compliquent. Bob va tomber dans les pattes de producteurs qui vont le transformer en crooner à la petite semaine. On entre là dans la pire époque du rock américain, celle de la variété frelatée. Mais Bob sauve les meubles, car il dispose d'un bel atout : sa voix. C'est en 1959 que Roy Buchanan commence à accompagner Bob. On se réveille un court instant avec un morceau comme «Loretta». Le père Roy joue comme un dieu. On le retrouve dans «Buttercup». Roy y va de bon cœur. Bob semble enfin reprendre goût à la vie. C'est quasiment le seul morceau punchy de l'année 1959. On sent à l'écoute des deux disques suivants que les années 60, 61 et 62 durent être un vrai calvaire pour le pauvre Bob. On lui faisait chanter de la variète sucrée et bien mièvre, des horreurs à l'eau de rose complètement insipides, de la petite pop malencontreuse et des slows super-frotteurs. Même un poids lourd de la compo comme John D. Loudermilk ne parvenait pas à relancer la carrière du pauvre Bob.
À plusieurs reprises, il se prend pour Johnny Cash. Il tape aussi dans Lee Hazlewood avec une reprise de «The Fool» et réussit son coup, mais c'est une goutte d'eau dans un océan de mièvrerie. Il chante un truc terrible avec Sue Thompson, la reine des pipes sucrées : «Too Hot To Dance». En 63, Bob semble coulé. Artistiquement, il n'a plus rien à dire. Il fait des disques pour rombières en bigoudis. En 64, on lui fait chanter du country-rock. Trop tôt. Il faut attendre 1966 pour redresser l'oreille. Et là, grosse surprise, Huey P. Meaux reprend la carrière de Bob en main. Ouf ! «The Best Years Of My Wife» est du pur rock tex-mex, digne des grandes heures du Sir Douglas Quintet. On sent tout de suite un retour de la substance. «So Happy For You» est monté sur un fond de guitares sauvages. Merveilleuse ambiance et fantastique énergie. Un vrai retour de manivelle. On croit rêver. N'oublions pas que le Crazy Cajun est un grand sorcier. Mais un producteur merdique nommé Wesley Rose repasse derrière et nettoie le son des enregistrements. C'est foutu. Ce connard va couler Bob définitivement. Voilà le fin mot de l'histoire. Wesley Rose replonge le pauvre Bob dans une mer de guimauve. Il le condamne à patauger dans la mélasse de la médiocrité.
Pas de chance, mon pauvre Bob. Sorti de la nuit du bayou, tel un Zorro sonique, Huey P. Meaux avait réussi à te sauver, l'espace de deux morceaux. Puis Bear, sorti de la nuit allemande, tel un baron de Munchausen supersonique, a réussi à arracher tes deux fabuleux swamp-rocks aux mâchoires de l'oubli grimaçant. Enfin, Damie Chad, sorti de la nuit des bloggers, tel un bopping cat héroïque, permet que l'info circule sur internet.
Pauvre Bob, on te devait bien ça.
Signé : Cat Zengler, lumanitaire.
Bob Luman. «Let's Think About Living» - His recordings 1955 à 1967 - Coffret 4 CD au format LP. Livre de 100 pages au grand format, magnifique, bourré de photos plein pot du pauvre Bob. Bear Family.
ROCK & FOLK N° 552. ( Août 2013 )
L’ont sorti en avance. Voulaient prendre des vacances. On les comprend. Mais j’aurais préféré ne pas savoir. Deux mauvaises nouvelles. En toutes petites lettres dans la rubrique condoléances qui égrène chaque mois le nom des disparus : Bobby Blue Bland. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais l’un des plus grands chanteurs de rhythm and blues, entre BB King dont il fut fut l’homme à tout faire et Otis Redding. Vous ai déjà causé une fois de sa version de Saint James Infirmary. On espère un article de fond dans le numéro de rentrée.

Un article sur les Dogs pour saluer le livre de la sœur de Dominique Laboubée, attendu. Mais la double-page consacrée à Pierre Lattès parti ce premier juin, me fait encore plus mal au cœur. Pour toute une génération Pierre Lattès fut l’Initiateur. Officiait sur France Inter dans le Pop Club l’émission de José Arthur. Avait l’œil sur la programmation, et était responsable de la séquence rock et de de la séquence blues. C’est là où en 1966 l’on a tout appris… En 1967 il crée Bouton Rouge, la première émission consacrée au rock sur la TV; a été vite supprimée après mai 68... Dans les années 80, il participe à l’éclosion des radio-libres mais retire ses billes lorsque les grands groupes de communication rachètent les fréquences…

L’article d’Olivier Cachin laisse entendre une fin désespérée, celle d’un homme blessé, laissé sur le bas-côté de la route, sa musique et sa personne ayant été évincées des média.
Pour finir sur une note moins triste, les quatre concerts de Johnny pour fêter ses soixante-dix ans. Et le dernier très rock ‘n’ roll, très pionniers hommagial, avec la participation de Brian Setzer, et la promesse d’une tournée des vingt salles mythiques des States…
Damie Chad.
FEUILLETON HEBDOMADAIRE
CHRONIQUES VULVEUSES
DEUXIEME EPISODE
Résumé de l'épisode précédent : L'agent Damie Chad 009891 du SSRR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) est envoyé de toute urgence en Ariège afin d'enquêter sur l'inquiétante entreprise terroriste de déstabilisation psycho-culturelle surnommée La Conjuration Vulvaire.
Tous les faits rapportés dans cette oeuvre narrative à enrobage littéraire affirmé sont tirés de la réalité la plus triste, les documents officiels de la justice et de gendarmerie sont là pour en apporter la preuve définitive.
4
Nous – tous les trois, la fidèle teuf-teuf mobile, Molossa ma compagne, et votre serviteur, avons roulé toute la nuit à tombeau ouvert. Pour nous tenir en éveil nous avons passé en boucle un enregistrement pirate des Jallies, leur phénoménal Shave Your Pussy, qui me semblait de circonstance. Au petit matin blême nous arrivâmes enfin dans la paisible bourgade du Mas d'Azil.
Molossa qui dormait les quatre pattes en l'air sur la banquette arrière se réveilla brutalement et à la manière dont elle remuait la queue, je compris qu'un relent de vulve conjurante, indiscernable à toute narine humaine, avait chatouillé sa truffe aguerrie. Je levai le pied gauche ( celui de l'accélérateur ) et les sens aux aguets j'inspectai les environs. Rien de bien phénoménal, une longue rue sans prétention bordée de maisons basses. Je traversai le village de part en part lorsqu'Elle apparut à l'horizon.
5

Un éperon rocheux coupait l'horizon. La teuf-teuf s'en approchait quand brusquement au détour du tournant nous L'aperçûmes, prête à nous avaler. La fameuse grotte du Mas d'Azil, célèbre depuis le néolithique ! Une vulve parfaite, l'abyssal trou génital par excellence, géante, Victor Hugo l'aurait qualifiée de bouche d'ombre, mais il était trop tard pour faire demi-tour, et la teuf-teuf s'engagea sans faillir dans la fente abyssale. Enorme, à droite la rivière aux remoux étourdissants, au milieu la route à deux voies par laquelle nous nous enfoncions dans le tunnel sinueux, à gauche l'on avait construit un large bâtiment bétonné afin d'accueillir les touristes.
C'est alors que les yeux me sont sortis de la tête. Je m'attendais à tout sauf à cela. Sur le coup, je le confesse à ma grand honte, j'en ai oublié ma mission. J'ai cru que je devenais fou, que j'étais victime d'un AVC foudroyant, mais non, je l'ai reconnu tout de suite, avec ces rayures noires et blanches concentriques. Le tromboscope d'Hauwkind ! Restait plus qu'à mettre les amplis et les guitares devant. Une chance inespérée, être en mission commandée et tomber sur un concert d'Hawkind !

Je savais que le groupe était en tournée mais de là à les retouver au fin fond de l'Ariège, ça m'a foutu un choc, me fallait vite trouver la date et l'heure précise du concert. Plus de quarante ans que je ne les avais pas vus, à l'époque - en 1974 - avec Lemmy Kilmister le futur fondateur de Motörhead et leur tromboscope spiralé blanc et noir qui tournait, tournait, tournait, indéfiniment, à vous faire vomir votre petit déjeuner, tripes et boyaux compris, en trois minutes. Un régal.
Me fallait une affiche illico ! La teuf-teuf est sortie de la grotte en trombe et l'on est retourné au village inspecter les murs, une fois, deux fois, trois fois, rien ! On a scruté à s'en décrocher les orbites En désespoir de cause, je me suis arrêté et ai appelé le Service Archive sur mon portable.
6
“ Ici agent 009891.
-
Vous recevons cinq sur cinq.
-
Besoin de savoir la date du concert d'Hawkind au Mas d'Azil, rappelez-moi tout de suite !”
N'aie même pas eu le temps de me saisir de mon sky dans la boîte à gant :
“ Agent 009891, aucun concert d'Hawkind prévu au Mas d'Azil !
-
Quoi ?
-
Sont actuellement en tournée au Canada, peux vous filer les dates !
-
Non pas la peine, par contre j'aimerais savoir pourquoi leur tromboscope se trouve dans la grotte !”
Une douce fragrance de Coronado N° 4 s'est subitement insinuée dans l'habitacle de la Teuf-teuf, et une nouvelle – toutefois reconnaissable entre mille - voix s'est emparée de la ligne :
“ Ecoutez-moi bien agent 009891, il n'y a pas dix minutes j'avais le ministre au bout du fil, vous savez ce qu'il m'a dit le ministre ?
-
Oui, euh, non Chef...
-
Je vous le répète texto : l'en a ras-le-cul de la vulve ! Alors vos histoires de tromboscope, vous pouvez vous les mettre où je pense !
-
Oui chef !
-
N'oubliez que vous êtes payé pour neutraliser le sieur Claudius de Cap Blanc, le plus vite possible, exécution immédiate.
-
Tout de suite chef !
-
Attendez douze secondes les archives ont un dernier renseignement à vous communiquer !
-
Agent 009891, votre tromboscope ce n'est pas un tromboscope, mais une oeuvre d'art contemporain, côté culture vous êtes déficient !”
Et la communication a été coupée.
7
Lourd silence. Molossa a agité sa queue de droite à gauche, signe de grande perplexité. Nous n'avons pas besoin de parler, nous nous comprenons à demi-aboiement. Certes j'avais totalement déraillé avec Hawkind, mais nous partagions tous les deux une même intuition. C'est le propre des agents chevronnés, sans cesse sur le terrain, de développer un sixième sens auquel seuls les plus fins limiers de la sûreté nationale peuvent atteindre. Malgré ses énormes capacités décisionnelles un Chef rivé à son bureau vingt quatre heures et demie par jour est en quelque sorte déconnecté de la subtilité analytique toute subjective de l'agent en mission. L'imminence du danger, la proximité quotidienne du péril, repousse les limites du cerveau humain, l'on arrive à savoir avant même de savoir.
Apparemment nous étions très loin de la Conjuration de la Vulve, mais il y avait un rapport ( rien de sexuel, rassurez-vous ) entre la vulve et le tromboscope. Difficile encore de le définir, mais l'instinct a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'affaire était à coup sûr plus complexe qu'il n'y paraissait. Comme on dit au FLNC, quand la situation se tend, ça se corse !
En attendant j'avais besoin de quelques informations suplémentaires. J'aurais pu rappeler le Service Archive, mais je n'aime pas que l'on me traite de déficient culturel. Me débrouillerai seul comme un grand. Comme le loup solitaire qui surgit de la nuit et dont les mâchoires se referment sur la gorge de sa proie pantelante ! J'étais un affranchi, un free lance, un franc-tireur, au-dessus des lois et du droit. Molossa a remarqué la lueur des commandos de la mort qui dansait dans ma pupille. Si Claudius de Cap Blanc avait vu sa queue qui remuait de gauche à droite, il aurait eu peur.
8
N'ai même pas eu besoin de tourner la clé de contact, la teuf-teuf mobile a pris la direction de Foix ( préfecture de l'Ariège, 9885 habitants ), désormais rien ne nous arrêterait plus. ( A suivre )
FIN DU DEUXIEME EPISODE
22:28 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.