27/06/2013
KR'TNT ! ¤ 150. JALLIES / METEORE / J.C. SATAN / STONES
KR'TNT ! ¤ 150
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
27 / 06 / 2013
|
SWINGUM / JALLIES / METEORE / J. C. SATAN / ROLLING STONES / MIDNIGHT ROVERS / KING PHANTOM / LITTLE LOU |
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 / 06 / 2013
LE BE BOP / MONTEREAU

Avec l'autorité d'une cheftaine scout habituée à se faire obéir la teuf-teuf mobile se range en épi face à la Seine qui roule des flots aussi boueux que le Mississippi, ne reste plus qu'à regagner le Be Bop au travers du lacis de ruelles qui mènent au centre ville. Pour une fête de la musique, la cité est bien muette, à part une mémé qui promène son chien personne dans la rue. On ne peut pas dire que la municipalité ait investi dans l'évènement... Au détour d'une place platanophorienne déserte je dresse l'oreille ( la gauche ), ne serait-ce pas le lointain écho d'une rengaine jazz qui serait venu frapper ma membrane tympanique ? C'est alors que le miracle s'opérât.
Certes je possède l'esprit subtil d'Ulysse mais n'en partage point la profonde sagesse. Aussi lorsque soudainement éclata le chant de la sirène je me portai vivement en avant. Je puis certifier que les copines qui me suivaient, jalouses comme des poux, n'auraient pas refusé d'obtempérer, mais loin de suivre l'exemple du divin Odysseus, l'idée ne m'aurait jamais effleuré de demander à ce que l'on m'attachât au premier arbre venu pour ne point succomber aux redoutables charmes de la voluptueuse raucité de la voix de La - on emploie l'article comme pour les cantatrices enchanteresses – Vaness.
Non, nous n'étions point en retard pour le dernier des concerts de la saison des Jallies mais depuis trois mois Vanness la mutine se plaît à fredonner quelques standards avec Swingum un groupe de jazz ami. Sont d'ailleurs en train de se lancer dans un tutti ( pas frutti mais fruité ) lorsque nous parvenons devant le Be Bop. Bises à Ady, Céline, installées à une table juste en face de la scène. Nous les imitons aussitôt.

Le Be Bop a carrément squatté la rue, l'a installé des barrières, sorti tous ses meubles et monté un mini-barnum de toile blanche. L'est même pas vingt heures et le public est encore maigrelet, mais le bar ne va pas tarder à être pris d'assaut. Pour le moment nous écoutons Swingum.
SWINGUM

Un quintet de mecs, rajoutez-y au milieu une super nana comme Vanessa et tout de suite c'est beaucoup plus sex...tet. Elle trône là-dedans comme une petite reine, tiens c'est moi qui chante maintenant, et encore une que j'aime bien, je vous laisse les deux autres, faut que j'aie le temps de jouer au ballon, je vous rassure, de rouge. Sont gentils les gars, lui passent tout, et assurent le tempo derrière.

N'ont qu'un seul défaut, jouent du jazz. Nous les rockers... Ne soyons pas injustes, Alain à la guitare s'enfile de ces soli pas dégueulis, un jeu très clair que je qualifierais d'espacé, il y a du rythme et du rebond. Pas l'effervescence New Orleans ou le hachis phrasé manouche, plutôt l'élasticité à la Charlie Christian, qui se prolonge et s'étire dans l'entre-temps du beat sans jamais outrepasser le point de rupture qui le ferait basculer dans les explosions du bop.

Suis mal placé pour juger du jeu de Cyril sur sa guitare rythmique, mais quand il prendra un morceau en main je le pressens beaucoup plus direct, pas rock mais un peu roll. Fabrice est à la contrebasse, la fait claquer avec prestance. Met la gazoline dans le moteur du combo et ça gaze à fond les manettes. S'amuse à des duos à contrechamp avec Alain. L'on dirait qu'ils font la course dans des escaliers d'un HLM, toujours un étage de plus à rattraper sans jamais donner l'impression de tirer la langue. Avec le sourire fraternel d'accompagnement.

Dans le coin l'en reste un qui nous en bouche un. Le jazz sans trompette c'est un peu comme une trompe sans éléphant. Ca buccine comme un cirque et ça tintamarre sans retard. Jérôme – Jéjé pour les intimes – en grande forme, dès qu'il peut glisser son cuivre dans un morceau il ne se gêne pas pour pousser sa fanfare. Le public doit aimer car il applaudit chacune de ses fracassantes irruptions. Fait autant de bruit à lui tout seul que trois bandas mexicaines.

Parfois il se la joue modeste. Promis, pas plus de bruit qu'une souris et il empoigne le premier objet venu comme s'il voulait enfoncer un bouchon dans son pavillon de foire. Evidemment, au dernier moment il soulève le couvercle et telle une cocote minute qui relâcherait sa vapeur en douce il éructe d'infects glapissements de renard pris au piège. Un peu comme si vous aviez marché sur la queue d'un alligator dans un bayou de Louisiane. Couleur grand orchestre Ellington garanti.
Derrière Eric chalerstone sur sa caisse claire. La scène n'étant surélevée que de quelques centimètres, question voyeurisme, il passe un peu à la trappe. L'on entend tout de même ses ondulations rythmiques distendues si caractéristiques de la frappe trad jazz. Avec le jazz, même quand ça va très vite, il semble que les musicos en ont encore sous la pédale, tout un paquet de nerf qu'ils se retiennent de jeter.
Ce côté ne te pousse pas de là, je n'ai pas envie de m'y mettre est accentué par la nonchalance du vocal. C'est une musique qui est née dans la chaleur étouffante du Sud, l'est empreinte d'une sourde fainéantise, d'une lassitude infinie, dont rien ne viendra à bout. Ca peut swamper et jumper à souhait, surviennent sans cesse de grandes plages d'apaisement, des moments de plénitude stagnante qui vous enserrent la gorge à mourir de désespoir. Le vieux fonds de blues, la tâche sanglante inaltérable qui réapparaît sans cesse, auriez-vous cent fois lavé les lattes du parquet.

Mais Vanessa se plante devant le micro. Poussez-vous les marlous, vous swinguez trop bluezy et sa voix canaille cingle l'auditoire comme la cruelle lanière du fouet qui s'abat sur le dos des esclaves. Le plus terrible c'est que tout le monde en redemande. Encore, encore ! Fais-nous mal, Vaness, l'on aime cela ! et Swingum explose comme un feu d'artifice. C'est vraiment la fête. Du jazz.
INTERMEDE
Petit entracte. J'en profite pour ravitailler ma tablée. Me suis pas accoudé sur le comptoir depuis quinze secondes pour passer ma commande qu'une douzaine de gamins entrent en force dans la pièce. Emmènent deux étuis mous à guitares qu'ils portent religieusement, à croire qu'ils transbahutent le Graal et la Sainte Lance, déposent le tout au fond de la salle et ressortent illico après avoir échangé quelques mots avec le patron. J'espère de tout mon coeur que ce ne sont pas de gentils folkleux qui sont venus s'assurer auprès du patron qu'après les Jallies ils pourraient jouer Santiano. Vous savez, mon bon Monsieur, avec cette jeunesse dépravée, il faut s'attendre à tout. Mais uniquement au pire.
Tiens, des figures connues, Mumu, Billy, et Jean-Luc que nous invitons à squatter notre table. Mumu donne dans la nostalgie du futur. Nous étions présents au premier revival des années 80, nous sommes en train d'assister au second, mais nous ne serons plus ici pour le troisième. En effet quand les Jallies seront bien vieilles... mais arrêtons ces projections de cauchemar, de toutes les façons elles seront toujours aussi belles dans notre coeur.
LES JALLIES

Enfin les voili, les voiçà. Presque un mois que je ne les avais vues, et je suis arrivé à survivre. Incroyable miracle ! Sont alignées dans leurs petites chaussures rouge père Noël toutes les trois, Vanessa, Céline and Ady comme des madones. Mal donne, ne tardent pas à se transformer en furie pour entonner leur hymne introductif, We Are The Jallies. Dans le vif du sujet dès la première mesure.
Julien est derrière, placardisé. N'a qu'à bosser comme un chameau de caravane dans la terrible solitude infinie du désert stérile. Lui tournent le dos une bonne fois pour toutes et ne se préoccupent plus de lui. Ne le plaignez pas, mes copines le trouvent beau, il a l'air gentil, il est sympa, il joue comme un dieu sur sa contrebasse renchérissent-elles. Je commence à comprendre pourquoi les Jallies le cachent. Sont pas prêteuses pour deux sous nos fourmis rouges.

En tout cas et en attendant les trois cigales s'en donnent à coeur joie. Elles chantent et elles dansent. Toujours l'irrésistible ballet des instruments – souvent femme varie, nous a avec raison prévenu le poète – les fofolles batifolent de guitares en caisse claire. Sur cette dernière chacune possède son propre style, Céline dans son fuseau de velours cerise frappe bas avec des sourires d'enfants heureux qui illuminent son visage comme étonnée et ravie de faire tant de bruit avec si peu matériel, Vanessa lève les bras vers le haut avant de les rabattre avec des gestes emplis de la gracieuse maladresse d'un chaton qui s'étire. Ady refuse de jouer au sergent major. La guitare ou rien. Et quand elle prend le micro et qu'elle nous envoie quelques rock'n'roll sur la figure comme des boules de pétanque chauffées à blanc, on perçoit que ce soir elle bouillonne de colère. Est-ce pour cela que son décolleté n'est pas aussi échancré que d'habitude ?

A la fin du set, Ady ne se contentera pas des remerciements de rigueur. Fera remarquer que le Be Bop remplace en quelque sorte la municipalité peu empressée à offrir un spectacle gratuit à la population. Le monde qui s'est massé derrière les barrières applaudit à la mise au point. Pas besoin pourtant de colossales sommes d'argent pour s'amuser.

Suffit pas de le dire, faut encore le prouver. Jéjé ne se fait pas prier pour ouvrir sa valise lorsque nos demoiselles font semblant de le supplier. Le rockabilly swing des Jallies supporte allègrement les deux chorus de trompette qu'il dispatche avec vigueur sur son instrument. Un deuxième larron s'empare d'autorité des balais pour marteler le tempo sur la boîte à peau. Lui vient l'originale idée de marquer la syncope en cognant de temps en temps sur l'armature métallique qui soutient la toile. Sur le Stray Cat Trust l'on imagine sans forcer un trio de chats en goguette tapant en rythme sur le zinc des gouttières.

Me souviens plus du prénom de l'individu qui vient brancher sa guitare sur l'ampli et qui restera sur les trois derniers titres. Tout de suite l'ambiance prend une tonalité beaucoup plus rock. Je ne sais si c'est un amateur qui en connaît autant qu'un pro ou un pro qui a su garder la flamme de l'amateur, mais il se débrouille comme un chef. Il est inutile de préciser que les Jallies font un triomphe. Une fois de plus. La sono n'était pas merveilleuse mais devant la fougue qu'elles ont déployée on l'a vite oubliée. Beaucoup de morceaux originaux de leur futur CD, une version swing de Amy Winehouse quasi parfaite, et un Train Kept a Rollin qui fit rugir la foule de bonheur. Ont réussi à rendre les morceaux swing encore plus swingants que d'habitude et leur répertoire rock encore plus rock.

Elles ont du talent et savent s'adapter à la situation. Ce n'était pas un concert comme les autres mais une grande récréation festive que par leur énergies, leurs réparties et leur bonne humeur elles ont su rendre populaire, sans jamais baisser ne serait-ce que d'un cran leur prétention et leur identité musicale. La grande classe.
INTERLUDE
Suis allé au ravitaillement auprès du bar. L'on s'affaire autour de la scène, mais je n'y prête guère attention, ce sont les gamins de tout à l'heure qui installent leur matos. Je surveille le remplissage des gobelets en plastique lorsque un superbe vlan vindicatif de guitare me cloue sur place, ce n'est qu'un essai pour s'assurer de bonne marche de la sono, mais tellement prometteur que je laisse mes verres sur le comptoir pour zieuter d'un peu plus près les ostrogoths qui se permettent une si belle entrée en matière.
METEORE

Je comprends mon bonheur, trois guitaristes ( pas possible se prennent pour le Blue Oÿster Cult ! ), un à droite, deux à gauche avec un bassiste en prime, le batteur au centre, les retours ont été avancés sur la chaussée afin de libérer la place au chanteur. Cheveux blonds et un semi-pied de micro dans la main, il annonce la couleur : « Nous sommes Météore et nous allons commencer par une compo ! ».

L'a de la présence et du charisme le lead singer, s'incruste dans son texte et le ressort par tous les pores de sa peau, balance sur lui-même et ne tarde pas à trouver son propre rythme, n'est pas de trop quand il laisse la place à l'orchestre, ne s'aplatit pas, ne se fait pas tout petit, ne sait pas se faire discret, semble mener le groupe alors qu'il n'est plus sur la brèche en première ligne. L'a tout compris. Les visages du public convergent sur lui, durant ces temps morts où les guitares officient dans la pointe du son. Figure de proue, face aux embruns qui suit le mouvement ascendant des vagues sonores qui le portent en avant.

Il ne crache pas ses lyrics, il les habite, les joue, les met en scène, les interprète, texte de colère et de condamnation. Campe sur les grands mots de la révolte adolescence – et je rappelle pour ceux qui s'y méprendraient que le rock'n'roll est par essence une musique adolescente, dont les plus doués ont su préserver la flamme et l'esprit d'intransigeance même lorsque l'âge les a rattrapés, voire dépassés. Cause en français de la démocratie et de la liberté qu'on ne lui a pas donnée, mais on comprend qu'il est déjà assez grand pour aller la prendre tout seul.

Reprise de Téléphone, nous voici transportés trente ans en arrière, plus tard pour enfoncer le clou ils offriront Antisocial de Trust. Des jeunes gens qui s'inscrivent dans une certaine tradition qui n'est pas pour nous déplaire. Nouvelle génération de rockers qui ne laissent pas aux rappeurs le monopole de la colère sociale. Pratiquement un morceau sur deux sera une composition originale. Ce n'est pas pour cela qu'ils ignorent l'anglais, nous donneront par exemple une très belle reprise de Saxon.

N'y a pas qu'un chanteur, ont aussi un superbe bassiste. Remarquez que ce genre de corbeau de mauvais augure est indispensable pour les ambiances lourdes. Faut tout surligner en noir. Chaque morceau se doit d'être entouré d'un sombre liseré comme un faire part de deuil. L'ombre ténébreus du danger qui plane sur les expériences borderline n'est que le sel de la vie. L'on appuie là où ça fait le plus mal. Bassiste mais qui fait jeu égal avec les solistes.
Sont trois dont un qui se détache, vous donnerai son prénom le jour où ils détailleront le personnel sur leur facebook, les deux autres jouant plutôt à contrepoint, essayant de s'immiscer partout où ils trouvent de l'espace plutôt que de tenir une véritable rythmique. Le résultat en est un mur de son compact mais pas monolithique. Peut-être grâce au batteur qui suit plus l'allant des copains qu'il ne crée son propre champ d'expérimentations. N'écrase pas tout sur son passage. N'est pas l'alter égo de la basse qui creuse le sillon, lui il claque et rebondit.

Ont drainé leur public à eux, ce qui est toujours un très bon signe pour un groupe. Une masse d'amis et de camarades stockés contre les barrières qui ne ménage pas ses encouragements. Sont vite rejoints dans leur ferveur par toux ceux qui ne les connaissaient pas, comme moi, et qui en redemandent. Trois rappels. Un triomphe.
Prometteur ce Météore. Espérons qu'ils continueront sur cette lancée. Ont la jeunesse et la fougue. Groupe local de hard rock'n'roll qui devrait en toute logique monter les échelons territoriaux.
Damie Chad
( Pour les photos de Swigum l'on a pris sur leur facebook, les photos des Jallies sur le facebook des Swingum pour les deux premières et sur celui des Jallies pour les dernières qui ont été prises la veille au Gambrinus ; pour Météore photos de répétitions sur leur facebook + photos d'un précédent concert au Be Bop, le 06 avril 2012 )
ROCK'n'ROLL CIRCUS
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT BRIAN
S'il est un document légendaire pour lequel des millions de kids se disaient prêts à vendre leur âme, c'est bien « The Rolling Stones Rock And Roll Circus», spectacle filmé le 11 décembre 1968, époque où les Stones - faut-il le rappeler ? - régnaient sans partage sur la planète rock.
Pendant presque trente ans, il fut impossible de voir ce film. Les Stones s'opposaient à sa commercialisation. Ils prétextaient qu'il régnait une mauvaise ambiance au sein du groupe et que leur prestation était médiocre.
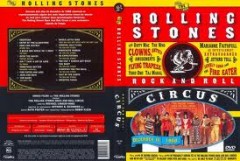
«The Rolling Stones Rock And Roll Circus» obsédait les fans des Stones. Ils en connaissaient la trame et le casting de rêve, car les journalistes avaient évidemment tout révélé : Jethro Tull, les Who, Clapton, Lennon et les Stones. À cette époque, tous ces artistes étaient encore particulièrement excitants. Jethro Tull venait de créer l'événement avec son premier single, «A Song For Jeffrey», les Who étaient encore un groupe à singles magiques, Clapton venait tout juste de quitter Cream et John Lennon n'avait pas encore pris ses quatre balles dans le buffet.
Les Stones bloquaient donc l'accès au film. Blessés tant de cruauté, nombre de fans transis sombrèrent dans l'alcool et finirent avec de gros nez rouges. D'autres, tout autant affectés, cessèrent brutalement toute relation avec le rock pour se réfugier dans le football. Les plus endurants prirent leur mal en patience, attendant qu'une décision favorable leur permît de voir enfin «The Rolling Stones Rock And Roll Circus». Grand bien leur en prit. Les Stones finirent par céder et le film parut sur VHS en 1996. Ce fut la seconde ruée vers l'or. Dans toutes les plaines du monde, les fans furent invités à se ranger derrière des lignes de départ. Au coup de feu, il fallait écraser le champignon. Les premiers arrivés obtenaient non pas une concession, mais une VHS, et ils rentraient chez eux avec le précieux boîtier serré contre leur cœur.
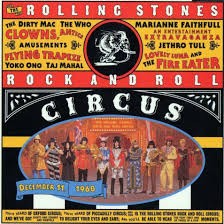
Ça valait vraiment la peine d'attendre trente ans ?
Indubitablement, mon cher Watson, même si le film avait pris un coup de vieux. Mais il nous plongeait au cœur de la période la plus prolifique du rock anglais. Ce film avait sensiblement le même impact que Woodstock, car il permettait de mesurer la réalité de ce que furent tous ces grands artistes au faîte de leur gloire.
L'honneur de présenter ce spectacle mythifié revient au trublion du rock anglais, Mick Jagger : «This is the Rolling Stones Rock And Roll Circus. You've got sight and sounds to delight your ears and eyes !» En gros, il annonce qu'on va bien se régaler. Le premier groupe à faire feu de tous bois, c'est Jethro Tull, avec justement «A Song For Jeffrey», premier single de ce groupe atypique à cheveux blancs (leur premier album s'intitulait «Living In The Past» - rappelons que nos quatre amis n'avaient rien trouvé de mieux à faire pour se distinguer que de se grimer en vieillards - concept entièrement original que personne d'autre n'osera réutiliser). «A Song For Jeffrey» en accrocha plus d'un à sa parution. Même s'il avait un petit côté beefheartien, ce single semblait sortir de nulle part. Un parfum de mystère capiteux se dégageait de ce morceau trépidant et saturé de slide-guitar. Le côté rocailleux rappelait l'imparable «Sure Nuff n' Yes I Do» de Captain Beefheart.

Jethro Tull est le groupe idéal pour démarrer un tel spectacle. On connaît tous les frasques de Ian Anderson drapé dans son grand manteau de clochard, se perchant comme le héron sur une patte et crachant dans sa flûte comme un vieux pervers. Mais qui se souvient de la prestation effarante de Glenn Cornick, ce hippie surexcité qui fouette sauvagement les cordes d'une basse inversée ? Il souffle en plus dans un harmonica monté sur un support, à la manière du Dylan de la période électrique. Au moment du tournage de «The Rolling Stones Rock And Roll Circus», Jethro Tull n'a plus de guitariste. Martin Barre n'est pas encore arrivé dans le groupe. Mick Abrahams vient de quitter Jethro Tull pour monter Blodwyng Pig. Tony Iommi (guitariste du groupe Earth qui va devenir Black Sabbath) et Davy O'List (Nice) sont testés, mais c'est Tony Iommi qui fera l'affaire. On lui enfoncera un chapeau cloche en feutre sur la tête pour dissimuler son visage et le tour sera joué.
Keith Richards apparaît alors à l'écran, un patch de pirate sur l'œil. «And naow, dig the Who !» On voit tous ces Who aux yeux bleus se démener, mais on entend surtout la basse de John Entwistle. Daltrey porte déjà l'une de ses affreuses chemises en daim à franges. Pour le malheur des amateurs, ils jouent «A Quick One While He's Away», un mini-opéra dont la mauvaiseté est impardonnable. Ils sont déjà trop ambitieux et perdent ce qui faisait leur charme, la spontanéité explosive. Quel gâchis ! Il n'y a que le final qui bouge un peu, «You're Forgiven». Keith Moon bat dans l'eau. Bientôt, il fera sauter des bombes.
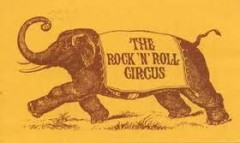
Taj Mahal prend la suite, accompagné d'un petit orchestre sage comme une image. Il se fend d'un «Ain't That A Lot Of Love» (tiré de son premier album) qui sonne exactement comme «Gimme Some Loving». Dommage qu'il ne joue pas le «Statesboro Blues» qui donne son titre à son second album, un disque absolument remarquable édité en plein cœur du british blues boom.
Perdu dans les gradins, Charlie Watts annonce Mariane Faithfull, puis Keef présente un cracheur de feu, assisté par la lovely Luna. En fait, le cracheur de feu avale le feu.

On arrive enfin à l'objet de toutes les attentes : The Dirty Mac, le super-groupe composé de Mitch Mitchell au battage, Keef à la basse, Clapton période Cream à la guitare, et John Lennon, belle demi-caisse Gibson blanche et chant. Lennon tape dans «Yer Blues», un des titres phares de l'album Blanc (qui ne contient que des titres phares). C'est l'occasion de voir jouer cet immense guitariste qu'est Lennon. Mais les choses vont se dégrader considérablement avec l'arrivée de la fée Yoko Carabosse sur scène. Les pauvres musiciens vont devoir accompagner cette poufiasse pendant dix bonnes minutes. L'immonde prestation s'intitule «Whole Lotta Yoko». Elle ne chante pas, non, pas du tout, elle pousse des espèces de cris perçants qui sont une véritable atteinte à l'intégrité intellectuelle de l'auditeur. On ne comprend pas pourquoi un personnage aussi brillant que Lennon est allé se fourvoyer dans cette incurie. Le violoniste Ivry Gitlis se joint au festin et nous glace d'épouvante.

Les Stones se sont réservé la part du lion. Jagger se présente à la caméra en tunique rouge. Il est encore au cœur de sa période androgyne. Voici enfin Brian Jones, l'incarnation des sixties, l'égal des dieux ! Il porte un trois-quart de velours mauve et un pantalon jaune bouffant passé dans des bottes. Il joue sur une Gibson Les Paul dorée. On sent la star. Son visage paraît glabre. Il porte du rouge à lèvres. Les Stones démarrent leur set avec «Parachute Woman». Le son est étrangement plat. On détecte un léger flottement dans les enthousiasmes. Brian Jones semble totalement absent. Il sourit bizarrement. Keef prend le solo en bas du manche. On ne voit pas du tout ce que fait Brian. Comme si on avait donné des consignes au cameraman. Brian change de guitare pour le morceau suivant, «No Expectation». Il s'empare d'une Gibson Firebird inversée. Il joue la mélodie au bottleneck pendant que Keef bâtit une solide rythmique sur une guitare acoustique. Brian assure, mais on voit qu'il se limite au minimum syndical. C'est à ce moment-là qu'on sort les billets pour parier :
-- 500 euros qu'il est complètement défoncé !
-- Tu crois ?
-- Tu veux parier ? T'as combien sur toi ?
-- C'est vrai qu'il a les yeux en trous de pine !
-- Au moins, avec toi, on ne risque pas de sombrer dans l'excès de délicatesse.
Brian sent sur lui les regards obliques des autres Stones. Quelle épreuve ! Gérer à la fois la défonce et l'hostilité. Ces quelques plans révélateurs nous donnent une petite idée de ce que Brian Jones a dû subir. Ni assez costaud, ni assez cynique, Brian ne pouvait affronter ses persécuteurs.
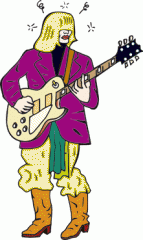
Les Stones sont gonflés. Ils s'attaquent à «You Can't Always Get What You Want», un morceau phare et très orchestré de «Let It Bleed». Et pourtant, ça a l'air de marcher. «Je l'ai vue aujourd'hui à la réception/ Elle tenait un verre de vin/ Je savais qu'elle devait rencontrer son dealer/ Le mec était aux petits soins pour elle/ On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut, baby/ Mais si tu cherches/ Tu finiras par trouver ce que tu veux». La rythmique est sacrément nerveuse. Brian Jones remue un peu, voilà qui rassure ses admirateurs. Keef fait un boulot énorme sur sa Les Paul noire. Il est au four et au moulin, l'animal. Il n'a pas usurpé sa réputation. Wow ! et voilà «Sympathy For The Devil» ! Brian Jones démarre aux maracas, mais d'une façon qu'on pourra juger aléatoire. Un gros plan sur son visage montre que ça ne va pas bien du tout. Dans le monde entier, des millions de kids se sont levés d'un bond à cet instant précis : pourquoi ne lui vient-on pas en aide ? Les percussions arrivent derrière, comme un régiment de cavalerie accourant au secours du pauvre soldat Brian. Le morceau tient avec très peu choses : Charlie Watts sur les bas-flancs, le percu black, Keef sur sa Les Paul, Nicky Hopkins au piano. Pauvre Brian, il ne sert plus à grand-chose. Il s'en va au vent mauvais qui l'emporte deçà delà, pareil à une feuille morte. Keef nous sort son killer solo exacerbé de légende, l'un des plus hargneux de tous les temps, sachez-le bien. Soudain, Jagger ôte sa tunique, exhibe son torse d'androgyne et pique sa petite crise, oooh-oooh, ooooh-ooooh ! Le morceau devient hypnotique. C'est vrai qu'à cette époque-là, les Stones sont encore le plus grand groupe de rock du monde, ils brassent les atouts, Satan, les guitares, les outrages, les bracelets de cuir cloutés. Jagger explose le dernier couplet avec un numéro de screamer hystérique ! Il embarque tout le monde dans un délire épileptique. Il est tout simplement renversant de puissance démoniaque.

Pour conclure, on retrouve les Stones dans les gradins, mélangés au public. Keef chante «Salt Of The Earth». C'est limite. Tout le monde sait que Keef chante faux. Par chance, Jagger prend le relais. La caméra cadre le pauvre Brian. Avec son regard éteint, il paraît frappé de décadence shakespearienne. Quelle horrible tragédie ! Il sait qu'il va être viré du groupe qu'il a fondé.
Même shooté à mort et haï par ses collègues, Brian Jones restait un Rolling Stone jusqu'au bout des ongles. On le haïssait tellement que sa mort fut certainement très appréciée. Mais sa disparition ne portera pas chance aux Stones qui entamèrent alors leur interminable déclin. Comment n'avaient-ils pas compris que sans lui, les Stones allaient perdre tout leur éclat.

Croyant bien faire, Andrew Loog Oldham raconte dans ses mémoires comment il avait œuvré pour écarter Brian Jones du devant de la scène. Il voulait re-centrer le groupe sur Keef et Jagger. Il ne pouvait pas supporter Brian. Fatale erreur, puisque Brian Jones ÉTAIT les Rolling Stones. Deux autres épisodes montrent à quel point les Stones furent odieux avec le pauvre Brian. Keef lui piqua sa fiancée (Anita Pallenberg) en 1967. Et dans «One Plus One», Godard filme les Stones en studio pour l'enregistrement de «Sympathy For The Devil». Non seulement, Brian est mis au rencart dans un box avec sa guitare acoustique, mais quand il demande une clope à Keef, il reçoit quasiment le paquet dans la figure.
Le concert des Stones à Hyde Park organisé pour saluer la mémoire de Brian fut l'un des sommets de l'histoire de l'hypocrisie anglaise. Ni Keef ni Jagger n'avaient daigné se présenter à l'enterrement. Seuls Charlie Watts et Bill Wyman assistèrent à la cérémonie.
Après ces épouvantables péripéties, nombre de fans (dont je fais partie) ont décroché des Stones pour aller traîner dans des zones plus respirables.
Signé : Cazengler l'inconsolable
The Rolling Stones Rock And Roll Circus. Michael Lindsay-Hogg. DVD Re-mastered 2004
J. C. SATAN
THEIR SATANIC MAJESTIES
Dans le temps, il fallait armer une frégate pour aller à l'Abordage. On trucidait l'Espagnol et on plongeait ensuite les bras dans des coffres remplis de doublons et de pierreries. De nos jours, on va à l'Abordage en teuf teuf mobile (encore merci Damie pour ce mot-valise digne de Raymond Roussel). On ne trucide plus l'Espagnol et on paie des impôts.
Eh oui, les amateurs de piraterie se sont motorisés.
L'Abordage est une petite salle de concert dont le seul défaut est de se trouver à Évreux, à la fois proche et loin de tout, c'est-à-dire de Paris (ou de Rouen). Pendant un temps, la qualité de la programmation y était telle qu'on y cavalait couramment. Frank Black, Jon Spencer, Andre Williams et les Demolition Doll Rods sont tous venus honorer les planches de cette petite salle paumée au fond du département de l'Eure, l'une des contrées les plus mal dégrossies de notre beau pays.

Puis les temps ont changé, la programmation aussi. On déplie chaque trimestre le joli dépliant programmatique de l'Abordage dans l'espoir d'y trouver de la substance, et on tombe systématiquement sur des choses qui semblent destinées aux lecteurs des Inrocks, c'est-à-dire les autres, pas nous. C'est un peu comme le New Musical Express. Jusqu'à une certaine époque, on le dévorait chaque semaine, de la première à la dernière ligne. Et chose alors impensable, le canard a changé de format et surtout de teneur, il y a de cela quelques années. Il s'est pour ainsi dire vidé, comme s'il avait chopé la colique. Pour survivre, un organe de presse doit dit-on viser large, et en visant toujours plus large on tombe fatalement dans le bourbier de la médiocrité. Le NME (Zi Ènêmi, on le bêlait ainsi, avec un petit zeste de gourmandise dans le ton) s'est auto-parodié, avec des couvertures exhibant des groupes tous plus insignifiants les uns que les autres. Intrigué, j'étais allé voir les Razorlight en concert, à cause du buzz entretenu par la nouvelle formule - ils en faisaient tout un plat de la crêpe Johnny Borrell - et j'étais ressorti du Nouveau Casino en courant, effrayé par l'affreux spectacle que je venais de voir. Ce groupe n'avait absolument rien à dire. Les malheureux puaient l'ennui et l'indigence. Comme le NME d'aujourd'hui.
Il existe pourtant d'excellents groupes de l'autre côté de la Manche, comme par exemple les 1990s, un trio glammy de Glasgow, ou encore les Len Price 3 de Medway qui ont vraiment l'air de bien aimer les early Who. Ces deux groupes pris au hasard auraient semble-t-il le tort d'enregistrer d'excellents albums (3 pour les Len Price 3 et deux pour les 1990s) (D'ailleurs on ne sait même pas s'ils existent encore).
À une époque, des gens comme Greg Shaw, Yves Adrien ou John Peel avaient sans doute mis la barre très haut. Simplement, ça nous convenait. Ce qui ne nous convient pas, c'est qu'on mette la barre très bas, comme c'est le cas dans la rockitude contemporaine, celle qui a pignon sur rue (les fanzines ont réussi à conserver leurs défauts de jeunesse, ce qui les sauve de l'académisme, cette sclérose qui s'attaque à un art pourtant vivant, le rock).
Un exemple. Pourquoi J.C. Satàn n'est pas en couverture de tous les magazines, à la place de Neil Young ou des Stones qui de toute manière vont bientôt disparaître ? J'ai un autre exemple, avec un groupe que l'indifférence a réussi à couler, corps et biens : les Klim de Rouen. Ils méritaient au moins une couverture et des grands articles dans la presse. Pourquoi ? Parce que sur leur premier album certains morceaux sonnaient comme des outtakes de l'Album Blanc des Beatles. Je n'exagère pas. Leur disparition est une injustice terrible. (J'y reviendrai) Ils avaient un potentiel dont ne disposent malheureusement pas les groupes français de la scène actuelle : ils savaient écrire ce qu'on appelle des chansons.

L'autre exception de la scène française, c'est J.C. Satàn, bien sûr. Voilà un groupe bien franchouillard (même plutôt franco-italien) qui sait écrire des chansons et qui vient d'enregistrer trois albums en trois ans. Bonne vitesse de croisière. Ce qui surprend le plus chez eux, indépendamment de la jeunesse des effectifs, c'est l'aisance naturelle. Ils dégagent cette candeur qu'on retrouve dans les photos des Pixies à l'époque de leurs débuts. Et ce n'est pas un hasard si j'évoque les Pixies. On retrouve dans certains morceaux des petits Satàn la même ardeur novatrice, le même sens de l'escalade vers des pics vertigineux, le même goût pour les petites virées dans les zones mélodiques encore inexplorées. Ils savent aussi très bien marier les voix d'homme et de femme pour provoquer l'éclosion de brouets incestueux, prendre l'amateur au dépourvu, épicer une pièce de sensualité ou de pure insanité. Ils connaissent toutes ces arcanes du baroquisme impavide, ils flairent le tortueux des jeux interdits, ils percent les secrets d'alcôves de très longues notes effilées, ils fabriquent des univers de mots lunes. Chose troublante, les Pixies étaient à l'époque de leur zénith le seul groupe capable d'autant de prodiges. «Faraway Land» tiré du troisième album pourrait très bien sortir du cerveau en dérangement perpétuel de Frank Black. Eh non, il sort du cerveau tout aussi dérangé d'Arthur Larregle, chanteur et guitariste du groupe. Puissance mélodique et fracas des armes sont au rendez-vous, soyez-en sûr. On plonge avec eux dans une mer de félicité. Quand ils jouent «Faraway Land» sur scène, on sent très nettement un souffle. Sur le disque, le morceau est plus scintillant, comme s'il se constituait de mille facettes octogonales clignant chacune à leur tour comme des yeux noyés dans l'ombre et puis, outrage suprême, c'est arrosé d'une purée de solo absolument répugnante.

J.C. Satàn jouait à l'Abordage, en février dernier. Non pas dans la grande salle, mais dans la petite, en haut. Il faudra patienter, les gars, pour la grande salle. Mais qu'on se rassure, Frank Black a fini par remplir l'Olympia avec les Pixies, qui n'étaient pas le groupe le plus commercial du monde. Simplement, ils avaient des chansons, et certaines sont devenues des hits aux États-Unis. C'est exactement ce qui pend au nez des petits Satàn.
C'est dans Dig It ! qu'on a commencé à dire le plus grand bien d'eux, avec une chronique de concert particulièrement élogieuse. Puis leur réputation a grossi très rapidement. Chez Born Bad, les deux premiers albums frétillaient dans les bacs et le troisième, «Faraway Land», trônait au mur, parmi les nouveautés. Séduit par la pochette (reproduction d'une toile quasi-expressionniste qui rappelle les heures noires de Christian Schad et qui montre une brune capiteuse au regard dur et mystérieux caressant la tête d'un galant-pendu posée sur ses genoux) et intrigué par le bien qu'en disait Dig It !, j'ai acheté «Faraway Land» et là j'ai vu trente-six chandelles. Enfin un album de rock français digne des grands albums de rock US. Ce disque s'ouvre avec une horreur heavy qui s'appelle «Legion». Un vrai bloc de Stoner. Ils démarrent aussi leur set avec cette abomination rampante. Dante n'aurait jamais pu imaginer une telle horreur. Tony Iommi non plus. C'est comme enfoncé à coups de pilon (basse et grosse caisse). Puis ça se met en route comme une machine de guerre moyenâgeuse, avec des riffs de basse qui pèsent des tonnes. S'il vivait encore, Dickie Peterson aurait adoré ça.

C'est Ali, une petite blonde d'origine italienne, qui ponctue cette horreur tentaculaire de notes de basse. Comme les autres membres du groupe, elle raffole des tatouages et elle a plutôt fière allure sur scène, bien campée sur ses jambes, multipliant les glissés de manche et cognant ses cordes avec la régularité d'un soudard occupé à défoncer le crâne d'un ennemi.
L'autre fille du groupe, Paula Horror, vient aussi d'Italie. Brune, tatouée, elle aussi petit rock'n'roll animal parfait, Paula partage le chant avec Arthur. On ne la quitte pas des yeux, car elle semble transfigurée dans les moments d'apocalypse. Tout au moins sourit-elle au cœur de la tourmente et c'est quasiment sans effort qu'elle grimpe au sommet de son registre pour aller chercher des contre-chants sublimes. Elle est incroyablement juste. On voit rarement des chanteurs ou des chanteuses se percher aussi aisément.
Arthur se trouve au centre. Petit et présent. Il a cette dégaine de lycéen qu'avait Frank Black avant de doubler de volume. Derrière eux se trouvent Romain aux fûts et Dorian aux claviers.
Sur l'album «Faraway Land», les morceaux se visitent comme les objets d'un cabinet de curiosités : «Dragons» salement offensif, lancé comme un toupie et fuselé comme un affront, «Damnation», satanisme orientalisé digne de Rosemary's Baby et pour les accès de fureur contrôlée, digne du Frank Black de «Debaser». Sur «Psalm 6», on entend rouler sous la peau du morceau une belle ligne de basse hendrixienne, sertie de notes doublées à certains endroits névralgiques. Avec «Faraway Land II» qui ouvre le bal des vampires de la face B, Arthur nous jette dans la tourmente d'une insanité digne d'une autre époque, celle des clameurs issues des caves de la Sainte Inquisition, une horreur digne du temps où courraient sous les voûtes de corridors humides et noircis par la fumée des torches les ululements des victimes de démonologues passés maîtres dans l'art d'arracher de faux aveux. Pour «Men Power», Arthur nous fait la grâce de chanter par dessous un riff garage fuzzy. Le morceau est parsemé d'explosions infimes et de petites giclées innocentes. Avec «Song», un morceau qu'ils reprennent aussi sur scène, ils montrent qu'ils savent très bien jouer sur les deux tableaux, le chaud et le froid, l'impact et l'impie, le corsage et le corset, le trépied et le tripode, ils combinent tout cela avec malice et sans malice. Ils savent monter les mélodies comme des pièces montées chantées à l'unisson et qui n'ont pas d'autre fonction que celle d'embraser la plaine de notre imaginaire. On redevient fébrile, comme on l'était au temps des très grands albums. Ils referment le bal de cet album interpellateur avec un morceau intitulé «The Last Paradise». Paula Horror sait faire miroiter le paradis, avec le même charme insolite que Kim Deal. Le parallèle, une fois de plus, n'est pas innocent. Rien ne vaut cette molle échappée biaisée par tant d'espoir incertain. L'opacité s'opiace alors qu'au loin s'organise un orgasme.

Sur scène, ils donnent à la plupart de ces morceaux une seconde vie. C'est ce qu'on pourrait appeler la dimension organique des superbes chansons de J.C. Satàn. Ils n'hésitent jamais à nous plonger dans des vertiges, comme par exemple avec cette version de «Hell Death Samba», morceau tiré de leur second album. Ils nous emmènent dans leur volcan. Paula chante mais Arthur hurle comme un damné, alors que s'écroulent les falaises de marbre, dans un épouvantable fracas. On croit assister à une absolution méphistophélique, bardée de grattages d'accords intermédiaires, enfer sonique de sang et de péché mêlé de cris et de bave et de croix et de boue et de crasse et de bris d'os et de craintes et d'éclats de bois. Ils vont aussi nous balancer une merveille nichée sur leur premier album, «Adventure Boat», une chanson singulièrement ensorcelante chantée à deux voix et vraiment digne du Velvet de «The Murder Mystery» et là on ne rigole plus. On tape dans le haut de gamme. Arthur et Paula (qui écrit les textes) ne se connaissent pas de limites. Arthur chante qu'il veut voyager avec Paula, aller dans la jungle avec elle pour rencontrer les cannibales. Tous ceux qui écouteront ce morceau tomberont sous le charme. Même quand on se croit blasé, on crie au génie. Il suffit simplement d'entendre Paula placer d'une voix indécente de nonchalance ses «Together on the boat» dans le refrain, juste au cul du I wanna See/wanna go/wanna be d'Arthur. Voilà un morceau d'une élégance imparable. Il existe encore une place au sommet des charts pour des groupes de ce calibre.

Du coup, on a rapatrié les deux premiers albums, le premier grâce à un revendeur espagnol qui heureusement l'avait encore en stock, et le second, juste après le concert. Il se trouvait sur la petite table qu'Arthur et Paula avaient installée dans le hall. À l'écoute de ces deux disques, les soupçons se sont confirmés. «Sick Of Love» (leur tout premier album et donc pour eux saut dans l'inconnu, avec une pochette dessinée par Paula) est bourré de chansons vraiment dignes du Velvet, comme «Your Place», qui a le charme subtil d'un standard comme «Pale Blue Eyes». Avec «You Are Good», on sent l'étoffe des héros, car avec son beat heavy, le morceau se révèle terriblement persuasif. La face B grouille de serpents mortels, comme «Superhero» ou encore «Endless Fall», dont le venin monte directement au cerveau. Mais le vrai choc vient de ces deux merveilles, «Together After Love» et «Adventure Boat», grâce auxquels ils semblent renouer avec la magie du Velvet. Rien de moins. Ceux qui ont adoré les ambiances intimistes et légèrement déviantes des morceaux lents qu'on trouve sur les trois premiers albums du Velvet («The Gift» et «The Murder Mystery», en particulier) vont se régaler. Rien n'est plus difficile que de créer de telles ambiances. Depuis le Velvet, peu de gens se sont risqués dans ces zones ténébreuses. En duo avec Isobel Campbell, Mark Lanegan s'y est aventuré. Par contre, les Only Ones n'épiçaient pas leurs rengaines envoûtantes de voix féminines et les Pixies naviguaient dans d'autres régions de l'espace sonique.
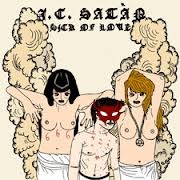
On retrouve cette veine velvetienne sur le second album des petits Satàn, «Hell Death Samba», notamment avec un morceau intitulé «Dear Dark J», insidieux et taillé en biseau comme «The Murder Mystery». Alors que «Misunderstood» renvoie, par le chemin biscornu serpentant au pied du gibet de Montfaucon, aux manies du grand Frelaté, c'est-à-dire Frank Black. «Blasted» évoque la trogne d'un démon colérique, cette peau noire, luisante et chiffonnée par mille courroux inavouables. Avec «In The Light», on constate une fois de plus qu'Arthur maîtrise à la perfection l'art de concocter d'atroces musicalités essentielles comme le sont les huiles de palmes olivâtres bercées d'alizés zoophiles. La chose coule sur la peau comme une poisseuse bénédiction, comme une langue d'octave perlée d'azur marmoréen. Avec cette véritable punkisherie ahanante qu'est «The Crystal Snake», et les clameurs de soudards qui l'accompagnent, les petits Satàn stompent dans le flic et le floc de la viande hachée d'après bataille. Avec cette pièce fulminante de trash, on a une nouvelle fois l'occasion de penser aux Pixies. Avanie dégringolée, degrés glissants vers des gouffres...
Dans «Abandon», Arthur explore des corridors chimériques. Comme Frank Black et Robert Pollard, il y rencontre sans cesse de belles idées ingénues et seyantes à demi nues et impubères qu'il féconde délicatement de ses dix doigts. Le tempo est si décontracté qu'on songe aux Byrds de la cinquième dimension. Avec «Junkie Knight», Arthur s'amuse à rentrer dans le lard du morceau, sans crier gare. Il se délecte du texte et trafique sa petite mélodie biscornue.
Ils referment le cortège de cet impressionnant album avec un truc qui s'appelle «Rhythm Of Sex» et qui sonne comme un long chemin de croix, comme une progression malaisée vers des gouffres de paradigmes parangonniques. Survient une éruption de crème chantilly qui s'arrête brutalement.

Les semaines se sont écoulées depuis, mais je garde un souvenir très vivant de ce concert. Le public assez peu nombreux s'était montré chaleureux. Une dame d'origine africaine s'était même risquée a essayer quelques pas de danse, juste devant la scène. C'était assez courageux de sa part, vu la teneur du set. Sur scène, Arthur et ses amis densifiaient systématiquement les ambiances et savaient faire exploser certains morceaux. Sur le moment, je me disais que je n'avais pas vu un vrai groupe de rock depuis une éternité. Celui-ci dégageait une vraie animalité. On sentait qu'ils avaient du répondant et puis la qualité des chansons ne trompait pas. Ils ne jouaient pas de reprises, comme allait nous le confirmer Arthur après le concert. Paula s'est quelques fois retrouvée à genoux, et Arthur réussissait miraculeusement à garder le contrôle de sa guitare malgré ses contorsions. C'est là qu'on voit les grands groupes. Vous avez ceux qui savent plonger dans l'enfer de la fournaise et ceux qui restent plantés sur scène comme des figures de mode.
Comme Kid Congo ou King Khan, Arthur établit assez facilement le contact avec le public. Il a très bien compris qu'il était nécessaire de parler aux gens. Allez le voir après le concert, vous verrez, c'est quelqu'un de charmant et de très simple. On peut discuter de musique, de projets avec lui. On le sent extrêmement motivé.
Un grand reporter de Dig It ! avait fait le déplacement, lui aussi intrigué par cette réputation grandissante qu'on voyait courir comme le furet. Il profita de cette conversation à bâtons rompus d'après concert pour poser les bases d'une interview à paraître dans le prochain numéro de Dig It ! Et comme ce fanzine sait vraiment coller à l'air du temps, il n'est pas impossible que nos petits Satàn se retrouvent en couverture de ce prochain numéro. Et là les choses reprendraient tout leur sens.
Pour finir en beauté, nous allâmes au Mata-Hari siffler de capiteuses Carmélites avant de nous jeter tous phares éteints dans les ténèbres de la campagne normande.
Signé : Cazengler, le possédé de Loudun
J.C. Satàn. Sick Of Love. Slovenly 2010
J.C. Satàn. Hell Death Samba. Slovenky 2011
J.C. Satàn. Faraway Land. Teenage Menopause Records 2012
Sur l'illustration de gauche à droite : Paula, Romain, Arthur, Ali et Dorian.
CROCKROCKDISC
MIDNIGHT ROVERS
ROCKIN'CLASS
Nico Liner ( Chant / Harmonica / Guitare Folk ) / Cidou Basta ( Guitare / choeurs ) / Manu Billy ( Contrebasse / choeurs ) / Torz Rovers ( Batterie / choeurs )
JUNGLE ROCKABILLY / LOST SOLDIER / A MAN IN HARMONY / HONEY DON'T / ELLE / BE A GOOD GIRL / CRUEL LIFE / TATTOOS / SUBURB OF PAIN / BLVD VINCENT AURIOL /

Pas besoin de chercher le Harrap's pour traduire le titre. Mais si vous n'êtes pas habitué aux mots à doubles entrées la pochette vous aide à comprendre : un Hot Rod avec un rocker gominé appuyé dessus au premier plan pour la classe rock, et des cheminées d'usines fumantes par derrière pour la classe des exploités. Le tout est dessiné avec de gros a-plats rouges et noirs pour annoncer la couleur. Un parfait résumé des Midnight Rovers un pied dans le rockabilly et l'autre dans la conscience sociale.
Jungle Rockabilly, peut-être pour vous rappeler que le monde est une jungle sans pitié mais que les combos de rockabilly sont là pour panser les plaies et vous redonner de l'énergie. Un instrumental, superbe avec les cris d'animaux en fond sonore et la guitare de Cidou qui tisse des lianes de riffs entre les branches et tout le reste du combo qui scie les arbres à coups d'harmonica et les abats à coups de section rythmique. Si bellement touffu que vous aurez du mal à passer sur le morceau suivant.
Ce serait dommage d'en rester là surtout que pour Lost Soldier ils restent dans la même harmonie musicale, l'harmonica à peine un poil plus bluesy mais le tout enlevé au pas de course. L'histoire d'un black GI qui s'en va crever pour son pays. N'en rajoutent pas à vous de réfléchir sur la valeur du possessif. A Man in Harmony débute par un vocal rap pour verser rapidement dans une pure orchestration rockab, mais dans les toutes les cités la vengeance est un plat qui se mange froid et aux cris de joies que l'on entend l'on comprend que l'on va en redemander une assiette pleine. Voix de clergyman et rafale de bastos pour conclure. Le morceau le plus féministe du record.
N'ont pas peur d'afficher leurs goûts musicaux. Honey Don't de Carl Perkins, un classique du rock de Memphis. A se faire traiter de réactionnaire par les imbéciles. Le moment de goûter au son, de fermer les yeux et d'écouter, équilibre parfait de l'orchestration, parti pris d'une couleur musicale qui sera tenue sans tergiverser d'un bout à l'autre du disque. L'on termine la face A sur un titre en français. Encore un tabou rockab ( et même rock ) que beaucoup de groupes français n'osent briser par les temps qui courent. C'est Elle la fautive. Peut-être pas celle à qui vous pensez mais chacun rencontre la sienne comme un reflet de ses propres faiblesses.

Be a Good Girl, commence doucement mais le malheur accélère les choses et vieillit les petites filles avant l'heure. Rythme entraînant et thème à vous gélifier sur place. Le morceau joue sur cette ambiguïté qui est l'exact reflet de notre quotidien, vitrine sourire par devant et réalité sordide par derrière. Les Midnight Rovers utilisent le rockabilly comme un produit d'exploration médicale que l'on vous injecte dans le dos. Moins brutal qu'un scalpel, mais plus insidieux. Cruel Life, le constat vire au noir. Pas celui de l'anarchie, mais du désespoir. Difficile de sortir de soi-même lorsque la guitare limite votre espace vital et que l'harmonica condamne les sorties de secours. Avec Tattoos le rythme bondissant vous peint le jour selon des teintes plus vives. Affichez vos propres mots d'ordre, mais n'oubliez pas qu'un jour tout cela ternira. Subburb Of Pain, les Midnight Rovers ont définitivement décidé de vous casser le moral, la contrebasse et la guitare grimpent sur les murs, mais ce sont ceux de nos prisons citadines. A chaque instant la société de consommation vous offre la cigarette du condamné. Pour vous échapper suffit d'escalader l'arbre de la liberté rock'n'roll. Boulevard Vincent Auriol, en plein Paris-misère, Paris-révolte-dérisoire, à des milliers de kilomètres de la patrie du rockabilly, et vous n'avez que votre rébellion intérieure à opposer au rouleau compresseur du Système qui vous broie.
Pas gai si l'on y réfléchit, mais les Midnight Rovers ont compris que soixante après l'on ne peut pas continuer à pleurer sur la baby qui vous a quitté ou à s'acheter une cadillac rose pour draguer les filles. Inoculent des hormones de croissance au vieux rockab des familles pour lui procurer une cure de jouvence. Malmènent les mythes et ouvrent les portes en grand à des thématiques sociales d'aujourd'hui.
Evidemment les puristes les attendent au tournant. Pas pour rien qu'ils reprennent du Carl Perkins, une façon de s'approprier les chasses gardées – qui entre parenthèses appartiennent à tout le monde – ils ne cherchent pas à restituer le son d'origine. Essaient avant tout d'en extraire l'énergie dans le but de s'en servir en faveur de causes actuelles. Auraient pu imiter les Angry Cats, qui sont un peu sur les mêmes traverses idéologiques, en gonflant le son afin de lui donner une ampleur pratiquement pro hard rock. Mais ils ont préféré jouer plus finement, rester plus près de l'original – et chacun d'eux y concourt en faisant attention de ne pas trop s'éloigner des tables de la loi tout en n'hésitant pas à les manier sans ménagement.
Z'auraient pu tomber dans une certaine naïveté qui aurait consisté à interpréter, voire à orchestrer, chaque morceau selon le thème traité. Ont eu l'intelligence de procéder autrement : ont créé d'abord leur son – prédominance d'une guitare claire, présence de l'harmonica – auquel les sujets abordés ont dû s'adapter et se couler. Au lead singer de se débrouiller pour ne pas se complaire dans un pseudo yaourt approximatif mais d'afficher chaque mot pour en faire reluire la signification. Nico a su trouver la voie étroite et y poser la voix juste, nécessaire à cette acrockbatie vocale qui n'était pas donnée d'avance. En contre-partie la contrebasse de Manu Billy a servi de point rockabillien d'ancrage non fixe, alors que Torz sur sa batterie prend soin de systématiquement de pulser avec force le début et de clore en redondance la fin de toutes les séquences rythmiques dont un morceau est composé.
Le résultat est à la hauteur des prétentions. Les titres défilent à vitesse grand V et s'enchaînent sans accroc. C'est un album que l'on prend plaisir à remettre du début à la fin. Point de plage malvenue qui s'en vient heurter le rythme et qui vous oblige à manoeuvrer le bras du tourne-disque. Un disque de rockbellion rockabilly. Une pièce rare sur le marché national. ( et international aussi ).
PS : Le vinyl ( pochette intérieure photos couleur ) est livré avec le CD, douze euros. Avec de telles pratiques, ils ne vont pas enrichir les actionnaires.
Contacts : www.facebook.com / TheMidnightRovers
www.facebook.com / AppelAuxLuttes
www.ladistroy.net
LITTLE LOU
HOLY MACK'REL / BIG ROCK INN
( Rydell's Records )
Bastien Alzuria ( Lead Guitar ) / Pascal Freyche ( Upright Bass ) / Jean-Pierre Cardot ( Piano ) / Gaël Pétetin ( drums )
ROCKABILLY QUEENS SERIE ( III )

Maniaquerie de collectionneur, me suis dépêché de mettre la troisième reine sur l'étagère à côté des deux autres, puis je l'ai oubliée. Durant trois semaines, pas très poli sur ce coup-là, je me hâte de présenter mes hommages et mes excuses aux pieds de la Little Lou. Surtout qu'elle n'a pas choisi la facilité, Holy Mackerel est un de mes titres préférés de Little Richard ( Part I et Part II ), alors quand je l'entends cracher son vocal à la manière du petit gars de Macon, les tripes en avant, les nerfs en boule et l'énergie en jet continue, je craque. Bien sûr elle s'inspire plutôt de la version de Prentice Moreland – plus richardienne que ce qu'en fera plus tard notre grande folle préférée – mais elle déménage si bien que l'on en oublie d'écouter Jean-Pierre Cardot sur son piano.
Vais sûrement passer mes vacances à l'auberge du gros rocher dès que j'aurais trouvé l'adresse parce que sa reprise de Big Rock Inn ( interprétée par Dolly Cooper en 1956 ) ne vaut pas le détour mais une station prolongée. Encore une fois Cardot pète les cardans et les trois autres le suivent les yeux fermés mais la voix de Little Lou ricoche sur les murs et effrite le crépi des façades. Hélas voici un disque qui s'usera trop vite, car qui trop passe trépasse. Le meilleur de la série. Et pourtant les deux autres sont loin d'être mauvais.
Little Lou, mais grande dame. Je regarde sur rockaroky par où elle passe près d'ici.
Damie Chad
Livré avec un sticker et flyer pub pour la production des Rydell's Records / 14 Rue de la Gare / 37 110 Le Boulay /
KING PHANTOM
GHOST RIDER / DESTROY AT SIGHT
GOLDSEEKERS / CRAZY GIRL
( Perkins Records / 2012 )
Johnny Rival ( guitar, vocals ) / Rumble Tom ( drums ) / Patclash ( basse ) / Jay Holster ( guitar )
A écouter les fenêtres fermées pour le seul plaisir de faire éclater le double vitrage. Le roi fantôme est sur la route et ça fait mal. Ricane méchamment dès les premières notes de Destroy At sight, préfère ne pas vous dire ce qu'il a fait sur la première plage. C'est comme dans un manga mais sans couleur avec le scénario en accéléré. Quant à l'autre face l'on a l'impression que les Goldseekers cherchent plutôt le carnage. Crazy Girl pourrait être encore plus folle et le morceau un peu plus long.
Sacré boulot de Rumble Tom sur tout le disque, les guitares remplissent les vides opérées par chaque break et Johnny vous offre l'explication de texte. Commentaires non autorisés exclusivement. A vous de vous faire votre propre film, dans votre tête. Si votre cerveau a résisté à l'électro-choc. Si ce n'est pas le cas, King Phantom ne peut plus rien faire pour vous. Nous non plus.
Damie Chad.
00:35 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.