04/02/2015
KR'TNT ! ¤ 221. ERVIN TRAVIS / JACK BRUCE / JOAN BAEZ / CHARLEY PATTON
KR'TNT ! ¤ 221
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
05 / 02 / 2015
|
ERVIN TRAVIS / JACK BRUCE / JOAN BAEZ / CHARLEY PATTON |
ERVIN TRAVIS

Nous le répétons, Ervin Travis ne va pas bien. Miné depuis longtemps par la terrible maladie de Lyme, il est actuellement dans une phase d'évolution critique qui nécessite des soins coûteux qui ne peuvent être dispensés qu'en Allemagne. Nous sommes de tout coeur avec lui dans ce combat. Mais par rapport à la semaine dernière, la donne a changé, les messages de solidarité affluent sur le facebook Lyme – Solidarité Ervin Travis - et déjà sont prévus deux concerts de soutien dont nous avons mis une affiche ci-dessus. Toutes les initiatives seront biens reçues. Amis rockers, à nous de jouer. Toutes nos sympathies à Ervin.
BRUT DE BRUCE
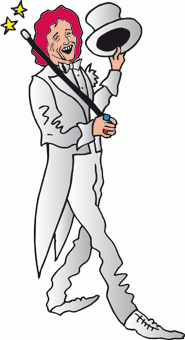
— Ça n’a pas tenu ?
— Non.
— Pas de chance, Jack...
— Tu l’as dit...
— À tous les coups, ils t’ont greffé un foie pourri...
— J’en sais rien, mec. Par contre, je sais que j’en avais assez. J’avais constamment la gerbe. Avec la vie que j’ai menée, c’est normal qu’un truc ait fini par lâcher. On est bien peu de chose, mec, c’est mon amie la rose qui me l’a dit ce matin.
— Tu as commencé à te shooter de bonne heure, d’après ce qu’on raconte...
— Comme j’étais fasciné par les jazzmen qui étaient tous des junkies, y compris Charlie Mingus, j’étais forcément fasciné par les drogues. À mes yeux, c’était un style de vie. Je voulais faire partie de ce monde-là. Je vénérais Charlie Haden et Scott LaFaro, junkies notoires. Tu sais par qui Ginger fut initié à l’héro ?
— Phil Seaman ?
— Non, Dicky Devere. C’était facile de se procurer de l’héro à Londres jusqu’en 68, car les docteurs la prescrivaient, notamment Lady Isobel qui signait ses ordonnances sur la banquette arrière de sa Bentley. Ginger faisait partie de ses patients, comme d’ailleurs Chet Baker et Dexter Gordon quand ils étaient de passage à Londres. Je me suis toujours shooté direct, je ne la sniffais pas comme le faisaient Eric, Leslie West ou Corcky Laing, je voulais le vrai truc, celui de Charlie Parker, de William Burroughs ou d’Anna Kavan, tu vois ce que je veux dire ? Ginger disait tout le temps qu’il ne pouvait pas bien jouer s’il n’avait pas pris un hit. Même chose pour moi. J’avais une vision purement romantique de tout ça. Je voyais un monde et je ne pouvais l’explorer qu’à la lumière d’un shoot d’héro. Avec Leslie West et Corky Laing, on a battu tous les records ! Tu vois, nous avions deux priorités. La seconde était la musique et la première l’héro.
— C’est l’époque des deux albums de West Bruce Laing ?
— Oui. Le cirque a commencé en 1972. Je m’étais pointé au studio au volant de mon Adams Probe, le coupé sport qu’on voit dans «Orange Mécanique», un modèle unique. Je remplaçais Felix qui était trop stoned.
— Pappalardi ?
— Oui. On a signé pour un million de dollars avec Clive Davis chez CBS. On tournait partout dans le monde. Leslie se goinfrait d’héro et de pâtisseries. Et moi je buvais comme un trou, en plus du reste. Dans l’avion, Leslie pétait. Il lui fallait deux sièges pour s’asseoir. Ce porc était ingérable. Mais sur scène, on s’entendait bien, car c’est un guitariste très mélodique, avec une vraie niaque.

— À mon sens, West Bruce Laing fut l’un des plus gros power trios de l’histoire du rock, certainement bien meilleur que Cream ! J’ai adoré «Why Dontcha», ton premier album avec Leslie et Corky. Ça fourmille de hits terribles là-dedans, notamment «Out In The Fields» que tu chantes. Tu y développes une vision spectaculaire du mélopisme ambitieux et on entend Leslie glisser quelques giclées dans l’effroyable embrasement crépusculaire. Et dans «The Doctor», on t’entend lâcher des triplettes cavaleuses au gré d’invraisemblables dérives actives. Tu as une façon de jiver la jam qui m’en a bouché un coin. Toi et Leslie êtes vraiment deux furibards ! Et en écoutant «Pleasure», j’ai toujours eu l’impression que tu inventais des gammes qui n’existaient pas ! C’est dingue, non ? Et tu as cette façon de croiser tes lignes cavaleuses avec celles de Leslie, et ça, on ne l’entendait jamais dans Cream, où chacun semblait jouer dans son coin. Dans ce boogie dévasté qu’était «Pleasure», non seulement tu ramenais tout le feeling du monde, mais tu y shootais en prime une dose de folie virtuose. J’avais l’impression d’entendre le plus gros morceau de basse de tous les temps. Oh, il y a aussi ces riffs de piano et de guitare qui donnaient à «Scotch Knotch» une sourde atmosphère originale. Leslie y prenait un solo salace et toi tu glissais des lignes de basse ahuries ! Et puis «Pollution Woman» aurait très bien pu se retrouver sur «Disraeli Gears», non ?
— Normal, Pete Brown l’a co-écrit avec moi, comme tous les hits de Disreali.
— Cette façon que tu as de chanter ça, décalée, à contre-pied. Ce cut est d’une modernité qui défie toute concurrence. Tu la dotais de tous les parements d’une ambition démesurée. J’ai aussi adoré le deuxième album.

— J’ai fini «Whaterver Turns On You» tout seul à Londres. Leslie et Corky avaient quitté le groupe, épuisés. Ils étaient rentrés à New York.
— Ah bon ? Pourtant l’album sonne comme celui d’un groupe au sommet de sa forme ! J’adore la puissance et la heavyness de «Token», ce cut bovin, gras et muddy qui vire à la jam informelle. J’étais aussi subjugué par «Sifting Sand». L’incroyable de cette histoire, c’était que Leslie et toi vous pouviez vous entendre sur des terrains aussi aventureux. L’étrangeté y prédominait de manière endolorie, l’écho se chargeait de nappes égarées et de bribes mélodiques oubliées de Dieu. C’était incroyable d’entendre un truc comme ça dans l’album d’un power trio sur-puissant. Et tu continuais à filer dans les eaux molles de la nature morte avec «November Song». Tes manèges faisaient bon ménage avec les pachydermeries de Leslie et tu nous chantais ça de ta voix perchée. Et puis Leslie aimait bien revenir à ses routines montagnardes, comme avec «Rock And Roll Machine». Il retrouvait ses vieilles tendances défenestratrices, son jus sortait par tous les orifices du morceau, et toi tu multipliais les retours de manivelles, les départs de gammes insensées, les déviances impardonnables, les allers secs et tu finissais par rejoindre le thème comme si de rien n’était. C’est vrai que Ginger te reprochait d’en faire trop ?

— C’est une vieille histoire qui remonte à l’époque où on jouait avec Graham Bond. Il me disait que mes basslines étaient trop «busy». Il me reprochait d’en faire trop. Mais je ne faisais que jouer la mélodie, comme la jouaient tous les grands bassmen de Motown et James Jamerson en particulier ! Comme j’avais réponse à tout, Ginger ne pouvait plus me schmoquer, alors il m’a collé une lame sous le nez et m’a dit de dégager. J’ai dû quitter le groupe. C’est Eric qui m’a fait venir dans Cream. Je croyais que Ginger s’était calmé. Pas du tout. Il me reprochait tout le temps de jouer trop fort. Il s’en prenait toujours à moi. Je me souviens de lui avoir sauvé la vie, un nuit où il avait overdosé. En revenant à lui, il m’a remercié en me disant d’aller me faire enculer. Pas mal, hein ?

— Eric et Ginger peuvent te remercier, car sans toi, Cream serait resté un groupe de blues-rock ordinaire. Il n’y a qu’à écouter «Fresh Cream», le premier album, pour voir que c’était mal barré. Vous repreniez «I’m So Glad» de Skip James. Il a touché des royalties ?
— Je m’en suis occupé personnellement. Quelques années plus tard, on faisait une balance pour un concert de West Bruce Laing aux États-Unis. Une petite bonne femme noire attendait dans un coin. Elle voulait me voir. Et tu sais pourquoi ?
— Euh...
— Elle voulait me remercier. C’était la veuve de Skip James. Elle venait me dire que grâce à cet argent, Skip James était mort dans la dignité.
— Bon d’accord, mais il n’empêche que «Fresh Cream» n’était pas très bon. À la même époque, Peter Green et Alvin Lee faisaient de bien meilleurs albums ! Par contre, avec «Disraeli Gears», on a eu l’impression très nette que tu ramenais dans le groupe une sorte d’exigence mélodique. Les chansons que tu composais avec Pete Brown...
— Pas Pete, Pit !
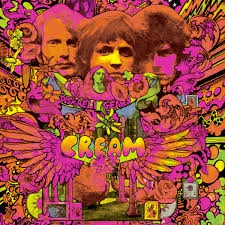
— Oui, Pit Brown, les chansons que tu composais avec lui s’élevaient comme des montagnes à travers les brumes psychédéliques. Ces chansons étaient d’une effarante modernité ! C’est quasiment le seul album où Clapton a su tenir son rang de God. Mais il bénéficiait d’une conjonction idéale puisqu’il liait son destin au tien. Il suffit de ré-écouter «Strange Brew» pour réaliser à quel point tu étais bon. On entendait tes notes de basse voyager à travers le velouté bien gras que sortait Clapton sur sa SG - Strange brew killed what’s inside of you - Ce hit fa-ra-mi-neux a bercé mon adolescence, au moins autant que «Helter Skelter» ou «Strawberry Fields». Tu incendiais les plaines infinies de mon imaginaire. Tu me faisais découvrir l’onctueux. «Sunshine Of Your Love» est devenu le hit de Cream, mais ce n’était pas forcément le meilleur morceau de l’album. Le vrai hit de «Disraeli Gears» se trouve en face B. C’est «Swchllbbrrr». Jamais réussi à le prononcer. Comment tu prononces ça ?
— Swlabr !
— Swchllbbrrr ?
— Non ! Swlabr ! Ça veut dire She Walks Like A Bearded Rainbow !
— Bon, bref, tu démarrais sur une grosse attaque - Come to me in the morning leaving me at night - et ça prenait aussitôt l’allure d’un hit parfait, tenu par des liants bien gras. Clapton envoyait un solo racé et fin comme une anguille, puis tu reprenais à l’onctuosité du chat perché - So many fantastic colours makes me feel good - Alors le trio décollait comme l’hydravion d’Howard Hughes ! On trouvait d’autres merveilles sur cet album parfait, par exemple «World Of Pain», où le gras de ton chant se mêlait au gras de la guitare, ou encore «Dance The Night Away», qui est une pure élévation de mad psychedelia. Vous faisiez monter la sauce tous les trois avec un art consommé et ça filait dans le ciel étoilé comme un tapis volant. «Blue Condition» était un véritable chef-d’œuvre de laid-back - No relaxation no conversation no variation/ In a very dark blue blue condition - On sentait bien les abus. Il y avait encore plus léthargique : «We’re Going Wrong», que tu portais à l’harmonie vocale du navigateur en solitaire, mais avec une énergie considérable.
— L’enregistrement de cet album ne s’est pas très bien passé, en vérité. J’avais amené d’autres chansons en studio et notamment «Theme For An Imaginary Western», mais Ginger et Eric n’en voulaient pas. On a fait une démo, mais elle a disparu. Mystère et boules de gomme. En plus, Ahmet Ertegun voulait absolument qu’Eric soit le leader et qu’il chante. Pour lui, la star, c’était Eric. Moi, je devais rester dans un coin. Heureusement, Eric n’avait pas la grosse tête et il a insisté pour que ce soit moi qui chante.
— On retrouve «Theme For An Imaginary Western» sur ton premier album solo, non ?
— Oui, ça et «The Clearout» que j’avais aussi amené à la session de Disraeli.

— J’ai adoré «Songs For A Taylor». C’est avec cet album qu’on a commencé à te suivre à la trace, nous autres les petits Français. J’étais dingue de Theme et ce côté mélopif mélodique à deux paliers qui va se perdre dans les lointains impétueux...
— C’est Chris Spedding qui jouait sur cette version.
— Wow ! Tu choisissais les meilleurs ! Avec Theme, tu semblais dominer le monde. Tu devenais une sorte de héros à l’Anglaise. «Weird Of Hermiston» impressionnait encore plus, sans doute à cause de cette veine jazzy et de ces tempêtes climatiques. Et «Never Tell Your Mother She’s Out Of Tune» aurait très bien pu se retrouver sur Disraeli, non ?
— Pour sûr ! Derrière, j’avais George Harrison et toute l’équipe de Colosseum, Dick Heckstall-Smith, Jon Hiseman...
— Tu chantais ça haut perché avec une sorte d’élégance byronienne et tu faisais brouter ta basse. On sentait en toi une sorte de détachement, comme d’ailleurs avec «Boston Ball Game». Avec les copains au lycée, on disait que ce morceau était très décollé de la routine, tellement il allait à contre-courant des tendances d’alors. La cerise sur le gâteau était bien sûr «To Isengard» que tu chantais à la glotte perchée et que tu dotais d’un final jazz-rock éblouissant. On détestait le jazz-rock, mais bizarrement, on admirait le tien. L’album suivant fut aussi un bon régal. On s’est jetés sur «Harmony Row» comme le Comte Orloff sur une famille de paysans du Danube. Je me souviens d’avoir écouté à longueur de temps «Escape To The Royal Wood», d’avoir navigué au long de ce poème fleuve, sous les hautes falaises silencieuses. Ça avait même par son baroquisme un petit côté dada. J’aimais bien aussi «Morning Story» que je trouvais admirablement torturé. Je me disais qu’une chanson devait être fière d’être torturée par toi. Une sorte de démesure s’élevait de ce tas de notes. Tu n’as jamais su faire les choses comme les autres ! «Post War» était encore plus étrange !
— J’adore fondre trois chansons en une seule. C’est mon principe de surenchère.
— Et «Victoria Sage» ! Il semble que tout Mansun vienne de là. Mélodiquement c’est parfait et tu chantes ça d’une voix de castrat. Ensuite tu nous a bien roulé la gueule avec «Things We Like» ! Belle pochette, avec ta Ferrari et tes chiens, on est tous tombés dans le panneau et on s’est retrouvés avec un album de jazz dans les pattes !

— Oui, je voulais faire un album de jazz. Ginger et moi on n’a jamais réussi à prendre la pop au sérieux. On venait du jazz. C’est la raison pour laquelle on était tellement à l’aise quand on jouait sur scène avec Graham Bond ! Mais la grande différence qui existait entre nous et les autres groupes anglais de la même époque - indépendamment du niveau technique - c’était l’attitude. Les rockers anglais des années 63 et 64 étaient appliqués. Ils s’ingéniaient à singer les artistes noirs qu’ils admiraient. Même les Stones et les Pretty Things s’appliquaient. Nous on ne s’appliquait pas. On swinguait. Aw mec, qu’est-ce qu’on a pu swinguer au Klook’s Kleek ! Ce n’est pas pour me vanter, mais on avait facilement dix ans d’avance sur tous les autres groupes de la scène anglaise. On était les hommes libres de la scène anglaise.
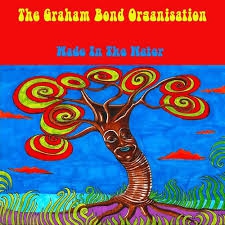
— Sur les photos de l’époque, on aurait pu vous prendre pour des gangsters de l’East End. Vous aviez des mines patibulaires et vous portiez des costumes stricts. Ce fut exactement la même chose pour les Flamin’ Groovies qui préféraient swinguer, alors que tous les autres groupes californiens se convertissaient au psychédélisme. Il y a deux ans, je me suis offert le coffret «Wade In The Water» du Graham Bond ORGANization et je peux bien t’avouer que je suis tombé au moins vingt fois de ma chaise en écoutant les quatre disques de ce coffret. Quand on écoute la version de «High Heel Sneakers», il ne reste plus qu’une chose à faire : recommander son âme à Dieu. Car cette version fusille les sens. Vous étiez vraiment des fous dangereux ! Ça tirait à boulets rouges. Tu étais le pire des quatre à cause de ton omniprésence dévastatrice. Tu sous-tendais tout. Tu portais le chaos. Tu semblais sortir d’une messe noire du chanoine Docre. Plus maléfique encore, Ginger faisait scintiller ses cymbales. Et Graham Bond était un screamer dément, le premier punk anglais. Il suffisait d’écouter «Half A Man», ce heavy blues cuivré qu’il chantait du gras de la glotte. Ce vieux Graham avait du génie ! On allait de surprise en surprise, même quand on avait la prétention de bien connaître les morceaux. Exemple : «Farewell Baby» était une pop-song, mais derrière, c’était l’enfer sur la terre : on entendait le beat souterrain du géant Ginger et tu claquais les boyaux de ta stand-up. Franchement, ça n’arrêtait pas. Déluge de swing sur déluge de swing. TOUS les morceaux sans exception relevaient de la monstruosité. Par exemple, «So-Ho», tellement typique de l’année 1964. On avait là un hallucinant festival de swing et tu partais en vrille. Du jamais vu alors, et du jamais revu depuis. Dans «Cabbage Greens», on trouvait les bases de ce qui allait devenir «Walking In The Park», la compo de Graham Bond qui allait rendre Colosseum célèbre. Le disk 1 du coffret était overdosaïdal, mais le disk 2 était encore pire ! On tombait sur une version punk de «Green Onions». «Long Tall Shorty» ? Monstrueux. Désolé, Jack, mais il n’y a pas d’autre mot pour qualifier ça. Vous souffliez le roof, comme vous dites en Angleterre. La version de «Long Legged Baby» était bourrée d’astéroïdes. Ça partait à fond de train. En comparaison, les punk-rockers de 1977 étaient des petits rigolos. Graham balayait tout sur son passage. Il aurait dû s’appeler Attila Bond. Il cavalait en tête. Absolument stupéfiant !
— On jouait rarement deux fois la même chose. Comme on était des musiciens de jazz, on improvisait en permanence.

— Oh et puis cette version de «Hoochie Coochie Man» que Graham noyait sous ses grosses nappes d’orgue. Il yeah-yeah-yeahtisait à outrance et pilonnait le vieux classique de Muddy Waters. Et toi tu envoyais les chœurs. C’était tellement chauffé à blanc que ça semblait hors de contrôle. Il y avait aussi le fabuleux album «Live At Klook’s Kleek» dans lequel on t’entendait prendre un solo de basse sur «Big Boss Man». Ton solo sonnait comme un solo de guitare ! C’est à mon sens le plus grand solo de basse de tous les temps. Tout y était, l’invention, le jus, la jute, l’excuriation des abîmes collatéraux, l’impénitente épistémologie du beat métrique. Tu jugulais le jus, tu jouais avec le jive, tu gérais les génomes, tu ne jurais que par le jus !
— Il y a vraiment des moments où tu m’énerves un peu avec tes phrases ronflantes. Tu ne pourrais pas essayer de dire les choses plus simplement ? Parfois, j’ai l’impression que tu racontes des conneries aussi grosses que toi...
— C’est de ta faute, Jack, c’est toi qui m’inspires toutes ces déblatérations ! Que veux-tu, la fréquentation intensive des génies me fait perdre les pédales. Et encore, je t’assure que je fais des efforts pour ne pas trop m’éloigner de la quincaillerie des signifiants, mais ce n’est pas facile ! En tous les cas, j’espère que je ne porte pas ombrage à ton génie...
— Tu te fous de ma gueule ?
— Vous autres les Écossais vous êtes des gens bizarres. Je comprends mieux pourquoi Ginger avait tant de mal à te situer.
— Occupe-toi de tes oignons. Bon, tu commences vraiment à me fatiguer. Je vais aller faire un tour. Il y a un pub, dans le coin ?
— Mais Jack, tu es au paradis ! Tu ne trouveras que des rivières d’eau claire et des bois enchantés.
— Pas de salles de cinéma ou de clubs de jazz ?
— Non. Par contre, tu vas faire des rencontres intéressantes. Tu vas revoir des gens que tu connaissais et d’autres que tu admirais. Et la seule chose que tu puisses faire, c’est raconter ta vie, ou développer une pensée philosophique, si tu en as les moyens intellectuels. Mais avant que tu ne partes, j’aimerais bien te dire que j’ai a-do-ré toute l’époque où tu enregistrais avec Robin Trower !
— Oui, Robin et moi on s’entendait bien. Il avait un vrai son, comme Leslie, mais moins mélodique. Il était à la fois funky et hendrixien. Unique en Angleterre. Brillantissime ! J’ai toujours admiré ses albums, même au temps de Procol, et chaque fois que je le pouvais, j’allais le voir jouer sur scène.

— «Truce» était un bel album, en effet. Dans «Gone Too Far», on vous entendait vous amuser tous les deux comme des fous, Robin partait en solo et toi tu tricotais une bassline infernale. Le gros cut de cet album était «Fall In Love». Robin y tirait bien la caravane des rois mages au clair de lune. Après Leslie West, c’était pour toi le guitariste idéal, non ?
— C’est sûr. Dans «Shadows Touching», on jazzait à l’harmonie de la dérive. J’adorais jouer du funk avec Robin, comme dans «Fat Cut». Et Robin embarquait «Little Boy Lost» derrière le comptoir. Il n’avait pas oublié ses racines blues-rock.

— «BLT» était aussi un bel album. On voyait bien qu’un cut bien gras, bien potelé comme «Into Money» avait été nourri à la ferme ! Et sur «No Island Lost», on sentait que vous vous entendiez comme deux larrons en foire ! Vous sortiez même le meilleur heavy blues d’Angleterre. Ah quelle tarpouillade ! Robin suivait ton chant au gras de guitare, note à note. Il faisait preuve d’une telle mansuétude ! On aurait eu tort de vous prendre pour des bricoleurs du dimanche, car vous faisiez littéralement partie des joyaux de la Reine. Oui, Jack, ce n’est pas la peine de me regarder comme ça, votre rock était du pur brut de prédilection. «Feel The Heat» semblait enthousiasmé de l’intérieur. Vous aviez une vraie santé compositale, en fait. Et au bout de ce disque qui était de nature à édifier les édifices, on tombait sur un heavy blues joué à la gloire du soleil couchant. Robin partait en solo et croisait délicieusement ta basse pouet-pouet. C’est dingue ce que vous saviez vous croiser, alors que dans Cream, c’était chacun pour soi, surtout dans les albums live. Mais l’album le plus dément que vous ayez enregistré, c’est bien «Seven Moons». Robin semblait alors au sommet de son art guitaristique. Et toi, dans «Lives Of Clay», tu semblais perché au sommet de ta grandeur. Tu avais un incroyable timbre de titan, yeah ! Et Robin prenait un solo dramatiquement recroquevillé. «Lives Of Clay» sonnait comme l’un des hits de Disraeli, à cause des solos en suspension de Robin et de ton jeu de basse. Les notes de guitare étaient rondes et belles comme des bulles. Ah quelle énormité ! Et «Distant Places Of The Heart» était encore plus lugubre que «We’re Going Wrong» qui se trouve sur Disraeli - Drift into the distant places of the heaaaart - C’était magnifique et désespéré - Hopeless past - Et l’incroyable solo de Robin était à l’avenant, puissant de noirceur ultimate. Et ça n’en finissait plus de ruer dans les brancards. Je me souviens de «She’s Not The One» dont tu stompais certains passages à la basse. Tous les solos de Robin sonnaient comme des événements telluriques d’une extrême violence, il suffisait d’écouter son killer solo dans «So Far To Yesterday» pour s’en convaincre. Je disais à mes copains : si vous tenez à savoir ce que signifie l’expression Géants du rock anglais, écoutez «Seven Moons». Mais ça les faisait rigoler. «Just Another Day» était un morceau lent, et forcément, Robin y plaçait un solo de rêve. Et toi tu mordais dans ta mélodie à pleines dents, enfin celles qui te restaient. Vous étiez vraiment deux pépères héroïques. Vous faisiez trembler les colonnes de la maison de retraite, pas vrai ?
— T’as vraiment un problème, hein ? C’est plus fort que toi, tu ne peux pas t’empêcher de te foutre de la gueule des gens !
— Mais enfin Jack, t’as plus vingt ans ! T’as vu ta bouille ? Regarde-toi dans un miroir ! T’es un vieux croûton, et c’est tout à ton honneur de rocker comme ça ! Aucun groupe anglais ne peut aujourd’hui sortir le son que vous sortez sur «Just Another Day», sauf peut-être les Wildhearts. Toi et Robin êtes des géants de l’âge d’or et c’est normal qu’à un moment on vous retrouve dans la salle des fêtes de la maison de retraite ! On va tous y passer, il n’y a rien de moqueur là-dedans. Tu as la gueule qui tombe, tu ronfles en dormant et tu fais chier ta poule qui ronfle aussi, tu perds tes dents et tes cheveux, voilà, c’est comme ça ! Mais ce que vous avez de plus que tous les autres, Robin et toi, c’est votre génie de rockers britanniques. Vos chansons résonnent dans le cosmos, au beau milieu du ballet des lueurs astrales. Et le funk mental de «Perfect Place» ! Robin y glougloutait ! Tu savais de quoi tu parlais quand tu chantais You gonna burn away too fast, pas vrai ? Et tu grimpais dans les octaves ! Et ça continuait comme ça jusqu’à la fin du disque avec des horreurs cataclysmiques comme «The Last Door», embarqué par un drive puissant et Robin balançait son napalm là-dedans et toi, Jack le diable, tu chantais sous le couvert, tout en disposant tes notes de basse cardinales. Vous étiez incroyables de férocité, tous les deux. Et cette ordure de Robin torturait son solo avec un acharnement punkoïde, arrghhh ! C’était à la fois irréel et aveuglant de splendeur. Désormais, on ne peut plus se passer des solos vitrioliques de Robin. Et vous ameniez un blues, oui, un vrai blues magique, un blues des enfers qui se moquait des modes. Pour moi, cet album est resté un diamant pur, un disque irréprochable, l’un des albums classiques du rock anglais - But how would I feel if this was happening to me ? Et «Come To Me» semblait sortir tout droit de Disraeli, avec sa heavyness et ses solos en suspension. Là, tu nous as tous bien bluffés, Jack !
— On a même ressorti cet album en version live, tellement on s’amusait bien à jouer ces morceaux !
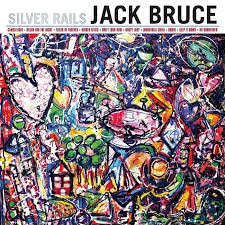
— J’ai bien aimé ton tout dernier album, «Silver Rails», qui s’ouvrait sur «Candlelight», du très haut de gamme mélodique. Et là tu parlais de la mort, comme Dylan dans son dernier album - The sunshine peels your skin/ The dance of death is on its way - Et je disais à mes copains : profitez-en les gars, vous n’êtes pas près de revoir passer un mec comme Jack ! Ils se pâmaient de rire quand je leur disais ça. Dans «Reach For The Night», tu revenais à la mort - You got so many miles/ Can’t just end dead/ Got rollin’ instead - tu pensais que tu ne pouvais pas mourir après tout le chemin que tu avais parcouru, pas vrai ? Et Robin revenait jouer avec toi sur ce fabuleux blues-rock qu’est «Rusty Lady». Sacré Robin, on l’entendait faire la corne de brume vers la fin du cut. L’autre merveille de cet album était «Industrial Child», avec sa mélodie suspendue dans le temps, à peine pianotée. Mais là où tu as encore réussi à nous bluffer, c’est avec «Drone» que tu jouais à la basse fuzz, seul avec un batteur. Alors là, bravo. Car c’était quelque chose de surnaturel.
— Je n’ai besoin de personne en Harley David-son !
— Alors faut-il considérer que «Keep It Down» est ta dernière chanson ?
— Je crois que le compte y est. C’est assez con à dire, comme ça, mais je préfère être mort, car je ne souffre plus. Si tu veux écouter des chansons de Jack Bruce, tu as de quoi faire avec tous ces albums enregistrés depuis cinquante ans, tu ne crois pas ?
— C’est drôle que tu me dises ça... Regarde ! La seule chose que j’aurais voulu ramener ici, c’est ce beau coffret blanc qui s’appelle «Can You Follow».
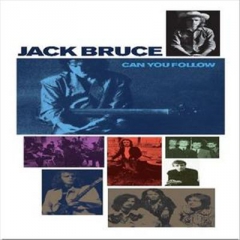
— Ah oui ! J’ai veillé à ce qu’il soit assez complet. Ça commence avec Cyril Davies et le Graham Bond Quartet. Tu as aussi les morceaux chantés par Duffy Power. Shouter extraordinaire ! Niveau Joe Cocker. Ginger, Graham et moi, nous l’avons accompagné à l’époque. Depuis, il est tombé dans l’oubli. Quel gâchis ! Il y a aussi les bricoles que j’ai enregistrées avec John Mayall et Manfred Mann, et bien entendu, les premiers morceaux de Cream, comme «Wrapping Paper». Et à la suite, il y a un choix de morceaux tirés de tous mes albums solo. Et comme tu dois le savoir, Pit Brown est toujours resté dans les parages. À l’époque de Cream, Ginger était très jaloux de notre créativité et de la complicité qui nous liait Pit et moi. Il se prenait pour le patron de Cream, mais il ne l’était pas. Pauvre Ginger, ses compos n’étaient pas bonnes, mais personne n’aurait osé le lui dire.
— Oui, sur le coffret, on trouve tous les morceaux datant des années 77-78. Qui pouvait encore t’écouter à ce moment-là ? Personne, évidemment. Tu étais trop parfait. Chacune de tes chansons en comprenait plusieurs. Alors que «New Rose» et «Pretty Vacant» sonnaient comme de nouveaux classiques. Et tu as joué aussi avec Gary Moore ?

— Oui, BBM, c’est-à-dire Bruce Baker Moore. On a enregistré l’album «Around The Next Dream». Avec Gary, on voulait revenir au son de Cream et voir si on ne pouvait pas donner une suite à Disraeli.
— Oui, mais là, vous êtes peut-être allés un peu trop loin. Il y a trop de son sur cet album. Il est évident que «Waiting In The Wings» sonne comme du post-Cream, mais Moore est beaucoup trop incisif. Et Ginger battait avec une espèce de brutalité, comme un bûcheron canadien, sans doute pour se moquer de vous deux. Mais avec «City Of Gold», on finissait par se faire avoir et à tomber sous le charme du heavy blues. Là vous étiez dans le pur post-Cream et tu saluais les départs en solo de Gary Moore, ce bavard impénitent. Il dévorait tout. Toi et Ginger, les deux vieux, vous sembliez cavaler après lui et tu le rattrapais au chant de ta voix tremblée - My home of sand outside the city of gold - Vous redeveniez un power-trio de rêve !
— C’est le guitariste de blues que j’aimais bien en Gary. Jouer «Can’t Feel The Blues» avec ce mec était un vrai bonheur, tu peux me croire. Il semblait toujours partir à la chasse, il renversait le beat et ça devenait prodigieusement heavy pour Ginger et moi. Et on l’entendait se balader dans les bois, c’était son truc et il n’en finissait plus de faire gicler sa mayonnaise. Les Irlandais ont ça de commun avec les Écossais : l’énergie animale. Quand il faut démolir le mur du son, tu peux compter sur eux.
— C’est vrai que l’énergie qui circule dans «Glory Days» est explosive. Vous frisiez le Swlllbbrrr. On avait là une fantastique leçon de psyché et Moore bardait ça d’accords déglutis. Il chargeait la barque et toi tu amenais tout à l’unisson de la crème de la crème. En plus, Ginger te battait le beurre avec une niaque de vieux briscard. Vous formiez une sacrée équipe ! C’est assez bête à dire, mais on voit passer très peu disques de ce niveau, par les temps qui courent. «Why Does Love (Have To Go Wrong)» aurait aussi très bien pu sortir de Disraeli.

— J’aimais bien Steve Hunter aussi. Très bon guitariste. Il jouait sur «Out Of The Storm» sorti sur RSO en 1974. Les gens du label RSO ne comprenaient rien. J’étais beaucoup trop créatif pour des gens comme ça. À ce moment-là, je ne faisais pas de pop, mais du Monk.
— Je garde le souvenir d’un album jazzifié dans l’air raréfié. Tu cherchais la difficulté, me semble-t-il. Tu semblais te perdre dans «Golden Days», comme si tu avais rompu toutes les amarres. Tu frisais l’admodestation grégorienne et tu ne semblais viser qu’un seul objectif : la beauté plastique. Jim Keltner s’amusait bien lui aussi. On vous entendait faire les fous lui et toi dans «Timeslip» et tu prenais un solo de dingue. Puis tu as monté ce groupe avec Carla Bley et Mick Taylor qu’on pouvait entendre sur l’album «Live 75». Tu y reprenais des classiques deltaïques du genre «Can You Follow» et «Morning Story». Tu allais là où le vent te portait. Comme tous les grands jazzmen, tu donnais l’impression d’être libre. On sentait ta passion immodérée de la fuite, au sens symphonique du terme. Ah bien sûr, on a dû t’accuser de progger, mais tu étais beaucoup moins prétentieux que tes collègues de Yes ou d’ELP. J’aimais bien aussi écouter «Keep It Down» et le jeu d’interventions délicates et sensibles du pauvre Mick Taylor. Mais les autres morceaux avoisinaient la demi-heure et on sentait qu’ils étaient réservés aux gens qui avaient du temps pour ça. Car il faut disposer de beaucoup de temps libre pour écouter des morceaux aussi longs et aussi ennuyeux, pas vrai, Jack ?
— Faut savoir ce que tu veux mon pote. Vous les Français, vous êtes tous un peu comme ça, pas très nets, un peu faux-culs. Dis-toi bien une chose : quand on joue avec le feu, c’est-à-dire le free-jazz, il faut aller au bout de sa logique, mec, qui est la liberté absolue. Rien ne doit entraver ton désir d’expansion.

— Il était bien ton groupe quand tu as enregistré «How’s Tricks» en plein cœur de la vague punk en 1977. Hughie Burns était un guitariste incisif, pas vrai ?
— Me souviens pas...
— Tes compos étaient très jazzées et donc beaucoup trop ambitieuses pour le public rock. Avec «Without A Word», tu lançais un mélopif qui s’étendait jusqu’à l’horizon et en plein milieu tu démarrais un solo de basse frénétique. Franchement, c’était gonflé de ta part. Et comme la basse était bien mise en avant dans le mix de «Johnny B77», on pouvait apprécier ta science des transitions. Tu chantais «Times» très perché, comme si tu étais encore dans Disraeli. Ma chanson préférée sur cet album était «Lost Inside A Song», une chanson étonnamment solide, chantée, composée et interprétée. Tu chantais ça avec une telle ardeur ! Et quel festival tu faisais avec «Waiting For The Call» ! Tu jouais tellement heavy...
— J’adore prendre le heavy blues par les cornes, mec.
— Mais le chef-d’œuvre de cet album, c’est bien «Something To Live For». Tu le tenais sous le boisseau de l’harmonique et tu montais un peu le ton, au fur et à mesure.
— J’adore tirer sur les syllabes. Elles sont élastiques.
— Ce qui est dingue, c’est qu’il se produit sur chacun de tes albums des événements extraordinaires. On croit qu’on va écouter un album de pop anglaise un peu au dessus de la moyenne, mais non, c’est du Jack Bruce ! Ton monde est complètement à part.

— Avec «How’s Tricks» j’ai essayé de me rendre accessible, comme d’ailleurs avec «I’ve Always Wanted To Do This». J’avais récupéré Dave Clemson à la guitare et Billy Cobham à la batterie. Mais ça n’a pas marché, tous les morceaux retombaient à plat. Mes compos étaient sans doute trop pop pour Clem qui était un vrai guitariste de rock et pour Billy qui était un vrai batteur de jazz-rock. Le seul morceau inspiré de l’album était «Dancing On Air»...
— Ah oui, le cut qui sonne comme «Jack’s Talking» de Dave Stewart.
— C’est une coïncidence, mec. Je visais l’espace létal du groove.

— Oui c’est vrai qu’on te voit jouer le morceau dans le film «Golden Days» et tu fais bien dégorger le groove. C’est d’ailleurs cette formation avec Clemson et Cobham qui est filmée au Rockpalast en 1980. Sur scène, les morceaux passent bien. Tu les secoues un peu et tu les fais vibrer. J’aime bien aussi ton récital solo au piano, filmé en 1990, qu’on trouve à la suite sur ce DVD. Mais puisqu’on parle de films, je peux te dire que j’ai adoré le film que Tony Palmer t’a consacré en 1969, «Rope Ladder To The Moon» !
— Ah oui, c’est une vieille histoire ! Il m’avait demandé de marcher à travers les slums de Glasgow et de raconter mon enfance. J’ai connu cette époque où il n’y avait pas de salle de bains ni d’eau courante à la maison et des vitres cassées aux fenêtres. Glasgow était encore une ville sinistrée par les bombardements. Rien n’avait changé depuis la guerre. Le pouvoir central avait complètement abandonné les Écossais. Alors il fallait réfléchir et trouver un moyen de s’en sortir. J’ai fait l’école royale de musique, mais il n’y avait pas de débouchés, alors je me suis retrouvé window cleaner. Je me faisais de l’extra-money en jouant de la stand-up dans un jazzband. Puis j’ai quitté Glasgow, j’ai joué trois ans avec Graham Bond. On jouait tout le temps et on ne gagnait pas beaucoup de fric, mais je t’ai déjà raconté cette histoire.
— Dans le film, tu dis que Cream fut le premier groupe à avoir du succès parce que c’était un groupe de vrais musiciens.
— Oui, je disais peut-être ça par provocation, mais au fond je ne suis pas quelqu’un de sectaire. J’aime tout ce qui est bon, que ce soit dans le classique, le blues, le jazz ou la pop, Bach, Ornette Coleman...
— Un autre guitariste que tu appréciais beaucoup, c’est Vernon Reid de Living Color. On le retrouve sur un bon paquet d’albums, si je me souviens bien...
— Oui, il jouait sur «A Question Of Time». Ginger aussi, d’ailleurs. Je trouvais que Vernon Reid était un guitariste très inventif, bourré d’énergie.
— Dans «Life On Earth», on t’entend traverser son solo à contre-courant. Mais le vrai hit de cet album transgressif, c’est «Hey Now Princess». Tu avais tout là-dedans, le vrai blues rock, le beat fabuleux de Ginger et le solo diabolo de Jimmy Ripp. Il me semble que tu avais aussi Albert Collins sur un morceau...
— Ah oui, sur «Blues Can’t Lose». Mais il est resté assez discret.
— «Obsession» était bien grassouillet, aussi. Encore un cut qui aurait pu se trouver sur Disraeli. Mais le morceau qui m’épatait vraiment était «Let Me Be», il était très introspectif, comme chargé de ton mystère intérieur. Et dans «Only Playing Games», tu nous sortais une mélodie expiatoire relayée par des chœurs de gospel ! Vraiment, tu auras tout fait pour épater la galerie ! Et donc, ça se passait bien avec Ginger ?
— Pour mes 50 ans, j’ai remonté un groupe avec Blues Saraceno et lui. On partait en tournée. Je croyais que ça allait bien se passer. Ginger et moi, on était un peu comme James Jamerson et Benny Benjamin, ou si tu préfères, Sly & Robbie. Mais quand on s’est retrouvés dans le hall de JFK, c’était bizarre. Ginger est arrivé et n’a rien dit, même pas bonjour. Quand je lui ai demandé d’écouter l’album dont on allait jouer les chansons, il m’a répondu qu’il n’en n’avait rien à foutre de ce fucking rock’n’roll. Les répétitions furent catastrophiques et quand on s’est retrouvés sur scène au Bayou, à Washington, on a atteint des sommets. Ginger gueulait pour qu’on joue moins fort, lui, on ne l’entendait pas, Blues Saraceno ne comprenait rien à ce qui se passait et le public commençait à s’énerver. Alors j’ai dit dans le micro à quel point je haïssais Ginger Baker, j’ai posé ma basse et je me suis barré. Fin du set. C’est la raison pour laquelle jouer avec un mec comme Vernon Reid, ça me repose. Il est aussi sur mes albums récents, «Shadows In The Air» et «More Jack Than God». Dr John était là aussi pour quelques morceaux...

— «Shadows In The Air» est l’un de tes meilleurs albums, pas de doute. Tu as des envolées catégoriques dans «Get Into The Fields». On dirait que Vernon Reid vient enflammer la plaine. Son groove funky sur «52nd Street» est un modèle du genre et ton chant dans «Heart Quake» se perd dans les champs. Cet album est vraiment fascinant, car toutes les chansons sont bonnes et captivantes, comme ce heavy blues, «This Anger’s A Liar», que Vernon joue bien gras. Et là où tu m’as le plus bluffé, c’est avec ta reprise de «Sunshine Of Your Love» ! Clapton est revenu le jouer avec toi, mais c’est accompagné aux percus, comme si tu voulais nous faire oublier Ginger, ta bête noire. Ta version est stupéfiante de professionnalisme et Clapton est bien meilleur qu’à l’époque de Disraeli. Pur génie aussi ton «Direction Home», un groove de rêve, et ce «Dark Heart» que tu mènes à la mélodie chant ! Et le coup fatal, c’est le «White Room» que vous reprenez en fin d’album, toujours aux percus et tabassé aux arpèges. Quel son dément !

Dans «More Jack Than God», tu reprends aussi deux vieux classiques de Cream, «We’re Going Wrong» et «I Feel Free». Vernon Reid plonge dans le gros bouillon laid-back de Going Wrong avec un incroyable élan. Vous jouez ça dans une espèce de court-bouillon apoplectique. On dirait que Vernon Reid s’amuse à faire sauter les concepts à la dynamite. Mais il est encore plus diabolique dans «I Feel Free» et ta bassline semble devenue folle. On dirait que tu te venges de l’époque où Ginger se moquait de toi en t’obligeant à porter cet affreux bonnet d’aviateur en cuir.

— Ginger est aussi sur «Cities Of The Heart», un double album live sur lequel joue aussi Clem. On a réussi à sortir une fantastique version de «First Time I Met The Blues». On y retrouvait cette effervescence qui était devenue mon obsession. Ah, on a aussi repris «Born Under A Bad Sign», un hit d’Albert King que j’ai toujours adoré. Maggie Reilly chantait avec moi sur deux ou trois morceaux, comme «Ships In The Night», mais elle n’était pas juste, enfin je veux dire que nos voix ne s’accordaient pas bien.
— Tu reprenais aussi tes vieux classiques comme «Never Tell Your Mother She’s Out Of Time» et «Theme For An Imaginary Western», qui tu tirais une fois de plus à l’infini.
— Oui, et Gary était revenu jouer «NSU» avec Ginger et moi. On a rarement eu une telle puissance de feu !
— C’est sûr, ta bassline sonnait comme la chute d’un chapelet de bombes et Ginger battait ça au tom bass. Et en plein dans la fournaise, Moore partait en solo et toi tu revenais le croiser au sommet des flammes. Vous étiez monstrueux, ça je m’en souviens. Et ça continuait avec «Sitting On Top Of The World» et surtout «Politician» qui était assez ennuyeux sur «Wheels On Fire» et qui prenait avec Gary Moore une drôle de consistance. Il semblait incontrôlable ! Son gras traversait le papier gras. Il en rajoutait des louches et des louches. Quand même à un moment, tu aurais dû le faire taire !
— Impossible. On a aussi rejoué «Spoonful» avec lui, et on l’a cuit à l’étuvée. J’ai fait d’autres albums, à la même époque, «Somethin Els» et «Monkjack».

— Oh oui, je me souviens très bien de «Slouldn’t We», sur «Monkjack», tu y déconstruisais des harmoniques et tu t’amusais à contrecarrer les ambivalences, à la manière d’un Francis Poulenc qui serait subitement devenu cocaïnomane, c’était quand même assez gonflé de ta part ! Et d’autant plus intéressant, car profond comme le néant. Avec «David’s Harp», on se serait cru sur un album de Keith Jarrett, et avec «Time Repairs», tu restais dans le déroulé du dévolu. Tu avais même réussi l’exploit de nous sortir un poème lettriste avec «Laughing On Music Street» ! Tu y pianotais à l’ombre d’une jeune fille en fleur courtisée par Isodore Isou. Et on retombait fatalement sous le charme de «Weird Of Hermiston», ce classique miraculeux tiré à l’harmonique de la désespérance et qui semblait flotter entre deux airs, piano et orgue, véritable chef-d’œuvre d’élégance suspensive.
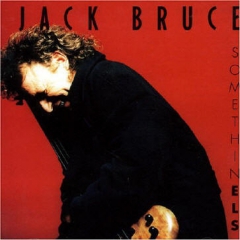
— Eric était revenu jouer sur «Somethin Els», et on avait d’excellents morceaux comme «Will Power». Maggie Reilly duettait à nouveau avec moi sur «Ships In The Night», mais on a une fois de plus raté l’unisson, car elle chantait plus haut que moi, ou l’inverse, je ne sais plus.
— «Close Enough For Love» était terriblement ambitieux, on aurait dit que tu chantais ça depuis la cime de l’Everest ! Il n’y avait que l’épique qui t’intéressait à l’époque !
— Tu aurais vécu comme moi dans les Highlands, tu comprendrais mieux. Ce que tu appelles la dimension épique correspond à ce vertige qu’on éprouve face à l’infini du ciel, par dessus un loch. J’appelle ça le sentiment d’éternité, un moment de perdition pour l’homme moderne, qui réalise subitement qu’il n’est ab-so-lu-ment rien du tout, à peine une ombre de passage sur cette terre. J’ai essayé de traduire ce sentiment musicalement. Le fait de réaliser qu’on est rien est une sorte de délivrance. On se débarrasse alors de tout ce qui ne sert à rien. Je crois même que les gens qui ont la foi débouchent sur le même genre de conclusion. Voilà où mène l’infinie dérive pernicieuse du jazz ! Aux yeux des profanes, tu te perds, mais à la fin de ta vie, tu te retrouves. La mélodie finit toujours par croiser l’étoile polaire, tu comprends ce que je veux dire ?
— Oui, j’entends bien ton petit couplet spirituel, d’autant plus que «FM» qui se trouve aussi sur «Somethin Els» sonnait comme un Gymnopédie d’Erik Satie. Tu t’es toujours arrangé pour subjuguer les gens. Surtout avec ce thème astucieusement déconstruit. On se serait cru dans le salon de Sonia Delauney en 1920 ! Puis tu soufflais le chaud et le froid : le froid avec une version de «The Wind Cries Mary» complètement foireuse et le chaud avec «Lizard On A Rock Rock» qui sonnait comme un fabuleux concassage de Captain Beefheart ! Tu faisais danser les crabes des cocotiers ! Par contre, ton album «Jet Set Jewel» n’a pas très bien marché, n’est-ce pas ?

— J’étais peut-être trop gourmand. Pourtant je faisais des concessions en reprenant «Neighbour Neighbour», un vieux standard qu’avait repris en son temps le Spencer Davis Group. J’adore ce genre de morceau, car il me permet de jouer à la surface des choses. Je ne vis que pour l’empire de la musicalité. C’est devenu une évidence.
— Oui, une fois plus, on sentait que tu jazzifiais dans l’air raréfié d’un ciel tuméfié. Mais tu savais rester incroyablement captivant. Tu y chantais le jazz à la cassure de ton et ta basse côtoyait les accidents de parcours. C’était ta façon de rendre la situation explosive, pas vrai ?
— Et pourtant, en chantant «She’s Moving On», j’avais le sentiment d’être providentiel, au sens où l’était John Len...
— Oh ! Regarde qui arrive ! C’est Saint-Pierre ! Il vient te souhaiter la bienvenue et te donner la clé de ton bungalow. Bon, je te laisse, Jack, à bientôt et encore merci pour tous ces bons disques !
Signé : Cazengler, Bruce de décoffrage
Disparu le 25 octobre 2014
The Graham Bond ORGANization. The Sound Of 65. Columbia 1965
The Graham Bond ORGANization. There’s A Bond Between Us. Columbia 1965

The Graham Bond ORGANization. Live At Klook’s Kleek. Charly Records 1999
The Graham Bond ORGANization. Wade in The Water. Coffret 4 disques Repertoire 2012
Cream. Fresh Cream. Atco 1966
Cream. Disraeli Gears. Polydor 1967
Cream. Wheels On Fire. Polydor 1968

Cream. Goodbye. Polydor 1969
Jack Bruce. Songs For A Tailor. Polydor 1969
Jack Bruce. Things We Like. Polydor 1971
Jack Bruce. Harmony Row. Atco Records 1971
West Bruce Laing. Why Dontcha. CBS 1972
West Bruce Laing. Whatever Turns You On. CBS 1973
Jack Bruce. Out Of The Storm. RSO 1974
Jack Bruce. How’s Tricks. RSO 1977
Jack Bruce. I’ve Always Wanted To Do This. Epic 1980
Robin Trower/Jack Bruce. BLT. Chrysalis 1981
Robin Trower/Jack Bruce. Truce. Chrysalis 1982
Jack Bruce. Automatic. Intercord 1983

Jack Bruce. A Question Of Time. Epic 1989
Jack Bruce. Somethin Els. CMP Records 1993
Jack Bruce. Cities Of The Heart. CMP Records 1994
BBM. Around The Next Dream. Virgin 1994
Jack Bruce. Monkjack. CMP Records 1995
Jack Bruce. Shadows In The Air. Sanctuary Records 2001
Jack Bruce. More Jack Than God. Sanctuary Records 2003
Jack Bruce. Jet Set Jewel. Polydor 2003
Jack Bruce Band. Live 75. Esoteric Recordings 2003

Jack Bruce & Robin Trower. Seven Moons. Evangeline Records 2008
Jack Bruce. Silver Rails. Esoteric Antenna 2014
Jack Bruce. The Anthology. Can You Follow. Esoteric recordings 2008
Harry Shapiro. Jack Bruce Composing Himslef. Jawbone Press 2010
Jack Bruce. Rope Ladder To The Moon. Tony Palmer. DVD 2012
Jack Bruce. Golden Days. Rockpalast 1980 et 1990. DVD Eagle Vision
ET UNE VOIX POUR CHANTER…
MEMOIRES / JOAN BAEZ
( 1987 / 536 pp / Livre de Poche 6881 )

Mémoires mais pas d’outre-tombe. Les a publiées alors qu’elle n’avait pas encore fêté son demi-siècle. Le besoin de faire le point à la mitant de son existence. Mais aussi de rappeler au public qu’elle existait. Les eighties furent terribles pour Joan Baez, trop vieille pour être l’égérie des nouvelles générations et en total porte-à-faux idéologique avec les nouvelles valeurs de ces années funestes qui virent le triomphe du libéralisme financier.
N’ai jamais été trop fan de Joan Baez. A part sa version de The Night They Drove Old Dixie Brown - le dernier disque qu’elle sortit chez Vanguard - que j’ai adorée. Mais Le folk n’étant que le versant nord de cet énorme massif musical montagneux que dans le sud on appelle country, il me sembla nécessaire de ne pas céder à un réflexe sectaire et de tourner fort impoliment le dos à cette grande demoiselle folkleuse lorsque mon bouquiniste me tendit l’exemplaire fort défraîchi -l’a dû longtemps dormir au fond d’une malle dans un grenier humide - de ses Mémoires.
MUSIQUE

Procurez-vous un Greatest Hits de la belle et vous en saurez davantage en lisant les notes de la pochette qu’en étudiant le bouquin. Parle de sa carrière - aucune nuance péjorative dans mon propos - mais très peu de sa musique. S’y étend un peu à ses débuts, lorsqu’elle raconte son adolescence, qu’elle écoute la radio, rhythm and blues et daube variétoche, lorsqu’elle gratte sans arrêt sa guitare enfermée dans le désordre de sa chambre, lorsqu’elle chante pour les copains dans son lycée, et surtout lorsqu’elle découvre qu’elle possède une très belle voix, un soprano de rêve une limpide fluidité à laquelle tout public a envie de s’abreuver quelle que soit la chanson qu’elle interprète. Evidemment ça aide. Deviendra professionnelle presque sans s’en apercevoir. Une montée progressive mais irréversible, passe doucement mais sûrement des petits cachets de quelques dollars au statut de reine du folk sans difficulté majeure.
MILIEU
Provient d’un milieu intello. Le père est une grosse tête, un matheux, un chercheur qui sera entre autres professeur d’université. Préfère sa conscience à son avancement. Travailler à l’amélioration des nuisances de la bombe atomique le met mal à l’aise. Deviendra un pacifiste convaincu. Dans les actes et les idées. Philosophie non-violente qu’il transmettra à sa fille. Cela et la couleur un peu trop bronzée de sa peau. Joan avec sa belle chevelure de jais passe facilement pour une jeune fille noire à la peau claire. Se tient dans l’entre-deux du racisme. De quoi la sensibiliser à la cause noire.
Le paternel lui refile aussi un cadeau empoisonné. Famille quaker, les dimanches aux assemblées de Dieu à faire acte de contrition et d’examen de conscience. Joan ne perdra jamais la foi. Elle est bien la fille de cette Amérique blanche et puritaine que nous n’aimons pas.
CONTRADICTIONS

Cause peu de musique mais beaucoup d’elle. Trois sœurs aînées, une mère aimante, une enfance heureuse. Une adolescence tourmentée. Pas de révolte contre la famille. Tout se passe dans la tête. Dans le corps aussi. Sous forme de somatisations excessives, vomissements retenus, malaises, nervosités… Les hormones travaillent son sang de jeune femelle en mutation. Les sixties sont la décennie de la libération sexuelle. Etrange que pas une seule fois Joan ne fasse le rapport entre sa foi chrétienne peu encline à favoriser les élancements de la chair et cette liberté de l’esprit et du corps suscitée par l’air du temps.
Mettra du temps à se libérer, les quatre ans passés avec son copain, puis plus tard son mariage avec David se révèleront être un fiasco. Joan l’amoureuse se range inconsciemment dans le rôle de la bonne épouse. A du mal à s’y plier. Les désirs sont nombreux et multiformes… Plusieurs années avant d’accepter son autonomie comportementale et d’abandonner son rôle symbolique de chaste épouse au profit de celui de prédatrice clairement affirmé et revendiqué. Folk and sex. Les bons sentiments cèdent le pas aux bons sextiments.
BOB DYLAN

L’enfant terrible et le couple de légende. N’est pas tendre avec son compagnon mythique mais lui pardonne tout. Après en avoir dressé un portrait au vitriol. Dylan le chantre de la contestation sociale. Le premier masque qu’on lui ait posé sur le visage. Certes les temps étaient en train de changer et il existait une concomitance parfaite entre les paroles du barde et la situation de l’époque. Tous ces intellectuels qui participèrent à la lutte des droits civiques et très vite s’engagèrent contre la guerre au Vietnam, et au-delà de ces prises de position politique s’amorçaient déjà la critique virulente de notre société de consommation et les premières sensibilisations écologiques. Une pincée de mysticisme et vous tenez entre les mains les dogmes des futurs hippies.
Dylan était bien conscient de tout cela mais il n’avait pas la fibre militante. Voulait bien écrire la feuille de route mais refusait de s’y conformer. Adoptera une conduite d’égotiste et de malappris. Dans la vie de tous les jours, il ne fera que ce qu’il voudra. Devient totalement étanche à toute proposition qui ne recoupe pas avec la plus grande exactitude ses propres désirs. Son statut de star - et même de gourou pour les idiots utiles qui le vénèrent comme un dieu et qui disent amen à tous ses actes - lui sert de bouclier. L’écrit des chansons. Point à la ligne. Géniales, cela va de soi. L’est sûr de sa valeur. Et de son côté manipulateur, la face sombre de son personnage qu’il assume en toute simplicité. Pour le reste cause toujours, tu m’intéresses. Quant à la cause du peuple ce n’est pas son principal souci.

Joan Baez sera la dernière informée de l’existence de Sara. Dont il aura des enfants. Qui partage avec lui la pochette de Freewhilin’… et dont elle tentera dans la mesure de ses moyens de protéger la douce délicatesse… Elle ne le dit pas, et ne le pense pas, mais à relire ces pages et les scènes qui quelques années plus tard les remettent face à face, se dégage la pénible impression que Mister Zimmerman tambourine à la porte de l’affectivité joanique chaque fois qu’il pense que cela peut être bénéfique à son plan de carrière fantasmatique. Car à proprement réfléchir il n’a plus vraiment besoin d’elle.
POLITIQUE
Peu de musique. Mais beaucoup de politique. Les deux lui paraissent indissociables. Et elle met ses actes en accord avec ses croyances. Chante gratuitement ou laisse son cachet à de nombreuses associations dont elle partage le combat. Elle n’a cure ni des avertissements et des menaces de la police ni des tentatives de déstabilisation et des coups tordus perpétrés à son encontre par la CIA. Courageuse et obstinée. Les différents chapitres du livre sont dans leur plus grand nombre consacrés aux différentes luttes qu’elle soutiendra tour à tour. Un petit côté dame patronnesse et de charité qui déplaît à notre sensibilité de mécréant franchouillard.

Ne s’attarde pas trop sur les Droits Civiques. Portrait un peu rapide de Martin Luther King. Et décapant quand elle nous apprend qu’il s’enferme dans sa chambre avec de jeunes groupies… Pour leur octroyer les connaissances bibliques nécessaires à leur éducation de pècheresse. L’image du saint homme en sort un peu écorniflée. Que voulez-vous, les noirs ne sont pas entièrement blancs. De la lucidité lorsqu’elle décrète que la victoire obtenue sur le chapitre n’est que l’arbre qui cache la forêt des haines raciales et des misérables conditions de vie qui restent l’apanage de la très grande majorité de la population noire.
VIETNAM

Les jeunes générations habituées au peu de manifestations suscitées par les dernières et actuelles guerres en Libye, en Irak et en Palestine doivent avoir du mal à mesurer l’ampleur de la vague de subversion soulevée aux USA ( et ailleurs ) par le conflit vietnamien. Joan Baez soutiendra les mouvements d’insoumission de dizaines de milliers de jeunes garçons qui refusèrent l’incorporation. Le chapitre le plus poignant du livre conte sa visite au Nord-Vietnam aux moments même où son propre Etat bombarde le pays. Ne cache ni sa peur ni sa rage. Son récit des abris surchargés, ses visions cauchemardesques de quartiers détruits et de civils morts par centaines sont assez éloquentes pour comprendre l’effrayante horreur de la guerre.

DERIVES
L’idéologie de la non-violence prônée par notre chanteuse possède ses limites. Ses développements attirent en un premier temps la sympathie. L’on se détourne souvent avec horreur des va-t-en guerre, mais ce consensus de la raisonnabilité anti-guerrière possède un redoutable défaut. Il prête facilement le flanc à touts sortes de manipulations. L’URSS et les USA ne s’en privèrent pas. Faire pression sur le gouvernement adverse en retournant contre lui sa propre opinion publique est de bonne guerre. Les Russes menèrent une vaste campagne politique contre le déploiement des missiles Pershing en Europe. Mais à ce petit jeu la CIA fut beaucoup plus habile puisqu’elle parvint à faire partager ses propres vues aux plus farouches des partisans qui la veille encore s’opposaient à ses troubles menées métapolitiques. Joan Baez - belle prise - tomba dans le panneau, la tête la première, à son insu, en toute inconscience, encore aujourd’hui elle reste dupe de ses errements et les revendique avec fierté.
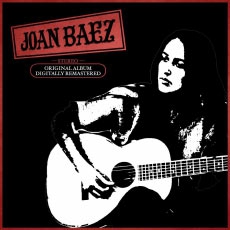
Il faut avouer que la stratégie de la CIA menée de front avec la complicité agissante des groupements économiques fut particulièrement subtile. Beaucoup se laissèrent prendre au piège. Amnesty International fut le sucre destiné à attirer les abeilles de la non-violence. Sous prétexte de défendre des militants emprisonnés, et dans les pénitenciers des régimes despotiques d’Amérique du Sud ou d’Asie, et dans les geôles des pays totalitaires de l’Est, fut menée une vaste opération de déstabilisation idéologique des régimes communistes et par contre coup des forces progressistes des pays européens. Dans les mêmes moments sous couvert de promouvoir les vertus indépassables de la démocratie l’on instilla à fortes doses dans les cervelles des élites et du peuple la croyance que celles-ci marchaient de pair avec les bienfaits du libéralisme économique… L’on connaît aujourd’hui les résultats désastreux de ces préceptes qui ne visaient qu’à une mondialisation accrue de l’accumulation des richesses dans les mains d’une oligarchie dont il faudra bien se débarrasser un jour ou l‘autre. Vraisemblablement pas par un bulletin de vote.
Joan Baez devint un peu la marraine officieuse des révoltés à la réflexion plus courte que leurs idéaux. Après avoir soutenu les dissidents d’Union Soviétique qui dans leur majorité se révélèrent plus tard pour un retour vers l’obscurantisme tsariste et orthodoxe des plus étroits, c’est avec la Pologne de Solidarnosc qu’elle connaît un véritable orgasme idéologique lors de sa rencontre avec Lech Walesha. Défaille de joie devant l’œuvre accomplie par ce suppôt rétrograde du catholicisme, le bras séculier de l’Eglise en sainte mission salvatrice. Ce sont les polonaises interdites du droit d’avorter qui doivent la remercier chaque fois qu’elles font l’amour.
MUSIQUE

Le plus terrible c’est que cette dérive politique se traduit aussi dans ses choix musicaux. Le livre se termine sur la grotesque farce du Live Aid de Bob Gelfof. La bonne conscience du rock and roll. Mille millions de larmes sur les malheureux et par ici les dollars. Est toute fière d’avoir été invitée, elle la survivante de Woodstock, pour ouvrir le festival. Commencera par chanter Amazing Grace, son vieux fond puritano-quakerien indécrottable. Dans ce vaste cirque médiatique elle remarque et tombe en admiration devant le nouveau prêcheur des eighties : Bono de U2. Difficile de faire un plus mauvais choix. Mais quand on se laisse guider par son instinct…
Quelques pages pour les remerciements et les proches. Ne lui reste plus qu’à nous avouer qu’elle se sent maintenant apaisée, a fait son deuil de sa célébrité passée, indique que ce sont encore ses premiers disques qui se vendent le mieux, que par goût et nécessité commerciale elle touche un peu à tout, du meilleur country à des chansons qu’elle aime moins, et le livre se termine.
Depuis l’écriture du livre ( 1985 ) elle a continué son petit chemin de bonne femme, avec des hauts et des bas, pour ceux qui veulent en savoir plus, elle sera à l’Olympia pour toute une semaine à partir du 7 Octobre… Si le cœur vous en dit… Personnellement je serai vraisemblablement à un concert de Rockabilly.
Damie Chad.
( rédigé en juillet 2014 )
CHARLEY PATTON
ELECTRICALLY RECORDED : HIGH WATER EVERYWHERE
HAMMER BLUES ( Take 1 ) / I SHALL NOT BE MOVED ( Alternative version ) / HIGH WATER EVERYWHERE ( Pt 1 ) / HIGH WATER EVERYWHERE ( Pt 2 ) / I SHALL NOT BE MOVED / RATTLESNAKE BLUES / GOING TO MOVE TO ALABAMA / HAMMER BLUES ( take 2 ) / JOE KIRBY / FRANKIE AND ALBERT / MAGNOLIA BLUES / DEVIL SENT ME THE RAIN BLUES / RUNNIN' WILD BLUES / SOME HAPPY DAY / MEAN BLACK MOAN / GREEN RIVER BLUES
CHARLIE PATTON : voice and vocal / HENRY SIMS : fiddle.
All tracks recorded in Grafton, Wisconsin / Octobre 1929.
Monk / BO Box 31 / 50 065 ( Firenze ). Italie.
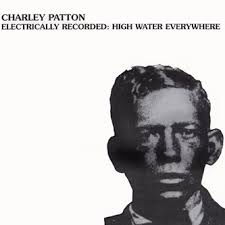
Petit label italien spécialisé dans les rééditions vinyl de blues. Lorgne aussi un peu sur le jazz, notamment notre héros national Reinhardt Django qu'à l'époque on ne considérait pas comme deux roms de frites, et ne dédaigne pas non plus le country puisqu'ils sont aussi fans de la Carter Family. Un catalogue peu épais que nos amis rockers ne manqueront pas de visiter. De la belle ouvrage, du 180 grammes et des pochettes plus ou moins stylées. Celles de Charley Patton, hélas ! légèrement indigentes. L'ai trouvé cet été à Toulouse, dans une petite boutique, facile à repérer, il y avait les Swinging Dice, tels des requins affamés, qui fouinaient dans le bac aux trésors...

Moi aussi je suis Charlie. Patton exclusivement. Un précurseur. C'est qu'avant Charley Patton, n'y avait rien. Plus de trace dans la boue du Delta. L'on ne remonte pas plus loin. Discographiquement parlant. Car avant, à l'origine, les renseignements se font rares. Toutefois Patton n'est pas apparu sur terre par le miracle du Saint Esprit. Il y eut un précurseur qui lui enseigna la guitare. L'on possède le nom. Henry Sloan. Serait né en 1870. N'a jamais enregistré. Du moins l'on n'a rien retrouvé, même si sur You Tuble on lui attribue une reconstitution anonyme. Dans les années trente l'on disait que Charley avait repris pratiquement sans changement quelques morceaux dont le célèbre Pony Blues... L'on ne remonte pas plus loin qu'Henry Sloan, alors certains se sont mis à rêver, ont décidé de lier la silhouette évanescente d'Henry Sloan à une autre, encore plus fantomatique, celle de cet inconnu – un pauvre noir, un chemineau, a lonesome hobo - que W. C. Handy ( 1873 – 1958 ) aurait en 1903 entendu jouer une étrange musique sur le quai de la gare de Tutwiler grattant les cordes de sa guitare avec son couteau et dont revenu chez lui il aurait retranscrit la ligne mélodique de ce qui allait devenir Memphis Blues et Saint Louis Blues, les premiers blues officiels jamais composés... Le professeur de Charley Patton et l'inconnu de Tutwiler seraient donc une seule et même personne. Rien ne prouve cette trop séduisante théorie. Rien ne l'infirme non plus. L'histoire est tentante, une ligne droite parfaitement répertoriée : Henry Sloan, Charley Patton, Robert Johnson, Muddy Waters, Rolling Stones : la ligature fondatrice originelle authentiquement reconstituée... Et quand on pense qu'avant de découvrir Elvis Presley, Sam Phillips avait recommandé aux frères Chess Howlin Wolf, le grand rival de Muddy Waters, l'on se dit que les racines du rock and roll tournent en rond dans le même pré carré... D'autant plus qu'Henry Sloan aurait lui aussi migré vers Chicago, et puis serait mort dans l'Arkansas en 1948 – goûtez l'ironie de l'élève qui devance le maître dans la tombe puisque Patton naît vers 1890 a quitté notre vallée de larmes en 1934. Nous remarquons aussi que Charley Patton et Robert Johnson ont sur leur chemin tous deux trouvé un initiateur au talent, disons diabolique.

Avec Charley Patton nous tenons enfin notre premier bluesman dument répertorié. Son House, et Robert Johnson lui doivent tout. C'est lui qui a leur a servi de modèle. La star que l'on imite. Un homme libre dans sa tête, a refusé de marner sang et eau dans une plantation, tout jeune sur la route avec sa guitare et quelques compagnons d'infortune. Une grande gueule qui aime à se faire remarquer, qui n'a pas peur de faire le coup de poing si nécessaire. N'enregistrera qu'à la fin de sa vie entre 1929 et 1934, notamment pour Paramount et Vocalion, moins d'une centaine de morceaux avant de s'écrouler trahi par son coeur aux alentours de ses quarante ans. C'est qu'il ne l'a pas ménagé son muscle cardiaque. L'alcool, les filles et les concerts. Les bagarres et les cops. Passera par la case prison. N'en ressortira pas calmé. Un showman extraordinaire, une voix de stentor capable de couvrir - sans micro est-il utile de le préciser - les ambiances houleuses des barrel houses, parfois il joue de la guitare, souvent il la frappe. Soigne ses tenues de scène, Hendrix s'est inspiré de sa manière de triturer les cordes de sa guitare derrière la tête... Vous emballe le public et les minettes à la chatte brûlante en moins de deux. Ne joue pas exclusivement du blues, ne dédaigne pas les chansonnettes et tout le reste, rag, jazz, trad, standards, l'important ce n'est pas l'objet, mais ce en quoi votre désir le transforme. Il est la première idole noire du Delta, le rat des champs encore sauvage qui n'a rien renié de son authenticité si on le compare aux souris des villes déjà policées que sont Bessie Smith ou Ida Cox, la face sombre du blues. L'on ne connaît de lui qu'une seule photographie – encore moins que Robert Johnson – un regard brûlant qui n'est pas s'en rappeler celui d'Arthur Rimbaud, mais avec en plus la tranquille assurance de l'homme accompli qui maîtrise son destin de feu.

Henry Sims et Charley Patton fréquentèrent la même école. Sims tourna avec Patton, l'accompagnait au violon et en juin 1929 il participa à la séance enregistrements de son ami, qui lui-même tint la guitare durant la sienne dans laquelleil mit les quatre seuls titres qu'à ma connaissance nous possédons de lui. Sims est un parfait passeur : il joua du violon sur le deuxième enregistrement de Muddy Waters pour Lomax en 1941. Mourut à Memphis en 1958. Le monde du blues n'est guère plus grand qu'un timbre-poste.
Un Hammer Blues, ce que l'on peut appeler une frappe lente, la guitare qui se balade tranquille, toute l'intensité dans la voix dont le grain est picoré par le souffle de l'enregistrement, mais la poisse vous gagne sans que vous y preniez garde. I Shall Not Be Moved, chant de triomphe qui contraste avec la poignante tristesse du précédent. De l'impertinence dans la voix, cette résolution n'est pas sans évoquer les hymnes contestataires folk pour le mouvement des droits civiques, trente ans plus tard. High Water Everywhere, Un pur country blues en ses débuts, mais très vite l'ire vocalique surgit emmenant avec elle un tempo martelé sur le bois de la guitare. Ce n'est pas que le Mississippi qui déborde, c'est la sourde colère impuissante des miséreux qui ont tout perdu qui s'exprime charriant au fond de son lit d'angoisse un courant souterrain de rage qui ne demande qu'à éclater. Blues limoneux. High Water Everywhere, la deuxième partie, la même force mais le rythme est ralenti, l'urgence est partie mais la gravité de la situation n'en est que plus vive. Les témoins racontent que Patton ne jouait jamais cette version en public. Ne devait pas aimer ce sentiment d'impuissance devant la montée des eaux de la désolation, le blues vécu comme une impasse. I Shall Not Be Moved, une version plus posée, débute plus lentement comme s'il prenait son temps, pour affirmer ses prétentions, la suite part comme un refrain entêtant répété à l'infini. Rattlesnake blues, le violon s'insinue et se glisse entre les interventions vocales comme une langue de serpent sifflante, le serpent du blues vous a inoculé son venin et cela vous brûle les chairs à tout jamais. Une voix menaçante qui ne trompe pas son monde sur ses mauvaises intentions. Going To Move To Alabama, presque gai, ça sonne hillbilly à se croire dans les Appalaches, le fiddle d'Henry Sims n'est pas pour rien dans cette cavalcade de country line. Les racines du rock presleysien sont ici évidentes. Hammer Blues, deuxième prise, le rythme reste le même mais la voix a perdu toute trace émotionnelle, comme si c'était un combat perdu d'avance de vouloir arrêter le martellement sans saveur du spleen vénéneux, moins romantiquement poisseux, une voix blanche comme ayant perdu toute humanité avec en prime une pointe accentuée de lassitude sur la fin. Le blues dans sa plus terrible nudité traumatique. Joe Kirby, beaucoup de friture, mais le violon d'Henry Sims fraye le chemin, un véritable duo avec la voix, la tambourinade de la guitare passant en second plan, Patton raconte et Sims commente. Un jeu un peu monotone. Ce n'est pas Paganini, mais l'essence du blues réside peut-être en cette répétition insistante aussi conceptuelle que l'idée la plus lourde de l'Eternel Retour du Même chez Nietzsche. Frankie and Albert, chanté mais presque chantonné, le blues comme un transmetteur de légende, mais c'est la guitare qui parle le plus, le riff joue à cache-cache avec les lignes de basse, une superbe partie de chat perché. Magnolia blues, une voix arrachée, qui traîne les voyelles, un véritable blues shouter, guitare et violon presque discrets sur la première moitié du morceau reviennent en force par la suite, mais Patton va chercher au plus profond de sa gorge pour rester maître de l'histoire. Devil Sent The Rain Blues, ne se promène pas que dans les carrefours, Satan est la matière même du blues, l'Adversaire par excellence au bonheur de l'Homme, l'on touche à la métaphysique, à l'essence de l'être. Runnin' Wild Blues, un peu d'assurance dans ce monde de brute, ce morceau fleure bon l'enthousiasme presque militant, un vocal joyeux, non sans une pointe d'auto-ironie soulignée par les interventions d'Henry Sims, j'espère mais je n'y crois point. Some Happy Day, sonne un peu comme un blues sur ses premières mesures mais l'on retombe vite dans ce folk blues qui est aussi une caractéristique de l'art de Patton, le blues est un creuset et l'on a jeté bien des éléments disparates dans la marmite du Diable pour obtenir la teinte idoine. Mean Black Moan, un blues sans prétention mais d'une efficacité redoutable, Sims fait du Henry et Charley du Patton, sans surprise, mais vous ne ferez jamais mieux. Green River Blues, mouline grave à la guitare, l'on croirait qu'ils sont trois, mais non Patton joue sur trois niveaux différents. Sans oublier de chanter. Peut-être la meilleure introduction pour saisir son jeu et avoir le fil d'Ariane qui permet de le suivre dans les autres morceaux. C'est que Charley Patton ne pose jamais les problèmes, il se contente de les résoudre. Vous file ses solutions comme des évidences. Tellement facile que vous pourriez le cataloguer de gratouilleux à la cool, alors qu'il se livre à d'étranges acrobaties, en gros c'est le genre de gars qui vous range treize oeufs dans une boîte de douze casiers. Pouvez recompter, il y en a bien treize à la douzaine chacun dans son alvéole. Sidérant. Sans tricherie. Sans filet, mais retombe sur ses pieds. Impossible n'est pas Patton. Le mec vous emmène à travers un labyrinthe, vous le fait traverser les yeux grands ouverts, et ce n'est que lorsque vous ressortez que vous vous apercevez que vous avez marché sur la queue de l'alligataure affamé qui vous attendait pour son petit déjeuner sans dommage. D'ailleurs vous a bouffé la jambe gauche, il serait temps de vous en apercevoir.

L'on n'écoute pas Charlie Patton en faisant la vaisselle. Faut prendre le temps, se poser, écouter, analyser, à première oreille, c'est vieillot et mal fagoté. Erreur funeste, c'est du concentré. Sans démonstration. Et puis cette voix grasseyante dans laquelle vous vous engluez comme des mouches sur du papier collant. L'on se prend à rêver à la qualité sonore des enregistrements qu'il aurait pu nous laisser s'il avait vécu jusqu'au blues revival des années soixante...
Damie Chad.
15:40 | Lien permanent | Commentaires (0)


