30/12/2016
KR'TNT ! ¤ 309 : GUITAR WOLF / JUKE JOINTS BAND / NUMBER NINE / NOBODY'S PERFECT / FILLES ELECTRIQUES / BLACK MUSIC
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 309
A ROCKLIT PRODUCTION
29 / 12 / 2016
|
GUITAR WOLF / JUKE JOINTS BAND / NUMBER NINE / NOBODY'S PERFECT
FILLES ELECTRIQUES / BLACK MUSIC |
Howling Guitar Wolf

En mélangeant Johnny Thunders, Link Wray et les Ramones dans une grosse soupe aux vermicelles de distorse stridente, les trois Guitar Wolf ont fini par imposer un style. En vingt ans, Seiji, Billy et Toru ont su bâtir une réputation de power-trio intraitable et sont presque entrés dans la légende du garage, mais pas n’importe quel garage, puisqu’il s’agit du vieux garage à l’ancienne, avec sa fosse à vidange et la crasse sur les poignées de portes. Ce qui leur vaut bien sûr toute notre sympathie. Eh oui, nous vivons dans une monde où l’offre culbute la demande et il faut bien se résoudre à faire des choix. Alors oui, plutôt Guitar Wolf que Stong. Quand on démarre dans la vie avec Jerry Lee, on va plus naturellement vers les bêtes sauvages que vers les meilleures ventes ou les charognards.
Seiji : «Un proverbe chinois dit : Un tigre à la porte de devant, un loup à la porte de derrière (entre le diable et le deep blue sea). Quand j’ai entendu ça, enfant, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Le tigre est certainement plus fort que le loup, mais le loup saura durer plus longtemps que le tigre. Guitar Wolf vient de là.»
Il existe une filiation évidente entre la sauvagerie de Jerry Lee et celle de Guitar Wolf. Les trois Japonais ne laissent aucun doute sur leur nature profonde. Ils ne sont pas là pour calmer le jeu, mais au contraire, pour montrer jusqu’où on peut aller trop loin, comme disait Jean Cocteau. Seiji Guitarwolf, Billy Basswolf et Toru Drumwolf alimentent tous les mythes qu’on aime bien : les frères Dalton, les gangs, le sex & drugs & rock’n’roll, ils rajoutent de la sueur sous le cuir, ils cherchent des noises à la noise et roulent le garage punk dans la graisse caramel, celle qu’on met à la main dans une boîte de vitesse avant de refermer le carter. Seiji : «On était juste trois kids qui traînaient à Harajuku, Tokyo. On aimait les motos, les blousons de cuir et le rock’n’roll.»

La presse leur accorde rarement de la place. Dommage, car Seiji est un mec plutôt rigolo. Il est le premier à reconnaître que Guitar Wolf était mauvais au début, et encore aujourd’hui : «On jouait si mal. C’était un désastre sur scène. Mais il vaut mieux être mauvais que bon - It’s much, much better to be bad thant to be a super technician, because rock is not art - Le rock n’est pas un art - Rock is impulse, urge and drive - Et puis Seiji raconte qu’un jour, il jouait chez un disquaire new-yorkais et qu’il est monté sur le comptoir pour shouter le rock’n’roll : «En sautant du comptoir, ma tête a heurté le gros ventilateur accroché au plafond. Tranchée net, elle a volé en l’air puis elle est retombée à sa place - I just kept playing as if nothing had happened - J’ai continué à jouer comme si de rien n’était. Si ma tête n’était pas retombée à sa place, je serais mort !»
Bien sûr, leurs cuts sont parfois tellement approximatifs qu’on pense à des chipolatas carbonisées, celles qu’on nous sert au barbock du fort d’Aubervilliers, mais ça fait aussi partie de leur charme. Seiji n’est ni le premier ni le dernier à chanter faux. Là n’est pas le propos. Ces mecs-là ont bien le droit de tester la résistance des tympans, après tout. Si on voulait tourner la phrase autrement, on pourrait dire : il faut vraiment être fan pour écouter tous leurs albums.

Leur premier album Wolf Rock paraît en 1993, sur Goner Records, le label de Memphis. Ce n’est pas un hasard, Balthazar, car ce label est probablement le dernier à prendre la défense des empêcheurs de tourner en rond. Guitar Wolf nous saute à la gorge dès «Wolf Rock», un cut de rockab monté sur une bassline infernale. Ça s’appelle un coup de génie. D’autant plus fort que c’est enregistré sur un mini-cassette. D’ailleurs, la suite de l’album va en pâtir, car tous les cuts sont littéralement dévorés par le souffle. La version d’«Apach Leather» se noie dans le désastre du bourbier sonore. Nos trois amis n’ont aucune pitié pour les canards boiteux. Le «Shooting Star Noise» qui ouvre le bal de la B relève aussi de la pure sorcellerie, car encore une fois, c’est monté sur la bassline de Billy, cet admirable guerrier apache qui rêve de mourir au combat.

Un an plus tard, Kung Fu Ramone sort sur Bag Of Hammers, un petit label de Seattle. Bon nombre de cuts de cet album feront leur réapparition plus tard sur Run Wolf Run. Kung Fu Ramone bénéficie comme son prédécesseur des pires conditions d’enregistrement, et c’est là où nos trois héros sont très forts : ils parviennent quand même à imposer des cuts, comme par exemple le morceau titre qui fait l’ouverture du bal des vampires. Ils pulvérisent littéralement toutes les attentes. «Run Wolf Run» est un joli blast de furnace japonaise. Ils jouent avec une énergie qui défie les lois, en termes de nucléus. C’est en B que se joue véritablement le destin de l’album, avec des monstruosités comme «Ryusei Noise», dévoré de l’intérieur par la basse de Billy. Ils deviennent l’espace de deux minutes les maîtres incontestables de l’enfer sonique. Avec deux fois rien, ils créent les vraies conditions de la fournaise, de façon tendue et têtue. Bel hommage à Link Wray avec «Baby Indian», battu tribal par ce démon de Toru, et «Ramble», joué à la distorse maximaliste. Ils bouclent cet album chaotique avec un autre chef-d’œuvre de complexion décomplexée, «Planet Blues», qui jaillit avec un son parasité à l’extrême, mais tellement glorieux. Guitar Wolf devient encore un court instant le power-trio par excellence. Ils sont à la fois superbes de classicisme et grandioses d’inadvertance.

Missile Me paraît en 1996 avec une belle pochette explosive. Ils sont alors au sommet de leur gloire underground. On trouve sur cet album un très beau «Hurricane Rock» zébré d’éclairs de Guitarwolf. C’est un son très japonais dans l’esprit de Seltz, un groove sourd issu de la jungle urbaine et ravagé par des éclairs de rage sonique. La rage sonique est peut-être ce qui caractérise le mieux l’art de nos trois amis. Ils savant aussi jouer les petits rocks énervés et courts sur pattes, comme on le voit avec «Can Nana Fever», ce genre de petit cut qui cavale tout seul sans qu’on ne lui demande rien. Bel hommage à Link Wray avec «Link Wray Man», bien amené à la colère sourde. C’est même excellent, car sous tension et ravagé par des luttes intestines, comme ce fut souvent le cas chez Link Wray. En B, ils créent les conditions du chaos avec «Racing Rock». Rien ne tient debout dans ce cut, rien n’est calé. Seiji gueule son racing rock dans le pire désordre qui se puisse imaginer. Mais tout cela n’est rien à côté de «Jet Rock’n’Roll» qui suit. Voilà du rock’n’roll joué au mépris des règles élémentaires, sans ceinture de sécurité ni freins, c’est du rock de mobylette volée et de blouson en sky, de cheveux gras lavés à la savonnette, du rock de mecs qui ne portent rien sous le jean, du rock de boots sans chaussettes, du rock de pastis au PMU et de père au parti, du rock de tatouages piqués au noir de bouts de talons fondus, du rock de repas de boîtes de sardines et litres de Valstar ou de Montbazillac. Un rock qui se situe aux antipodes de la sophistication. S’ensuit un «Devil Stomp» joué au sourd du possible, admirable d’audace et de j’menfoutisme baptismal.
Seiji rappelle qu’il doit tout à Link Wray : «J’ai voulu arrêter de jouer de la guitare, car j’avais du mal à tenir un Fa. La technique de guitare me semblait trop compliquée. Un jour je suis tombé sur ‘Rumble’ de Link Wray et j’ai compris qu’il faisait de la musique cool en passant simplement du Ré au Mi. C’est le truc ! Ça m’a ouvert les yeux.»

On reste dans le fracas du chaos intersidéral avec Run Wolf Run. Nos trois héros saluent Link Wray jusqu’à terre avec deux cool cuts, «Captain Guitar» et «Baby Indian», montés sur une véritable débâcle d’accords hybrides et joués dans une clameur d’excellence. C’est la meilleure preuve de l’existence d’un dieu Wray au Japon - Baby Indiannn ! - Ils poussent les curseurs dans les orties, même Linkster n’aurait pas osé un coup pareil. Dans ce chaos sonique roulent des boules de feu. Il s’agit du big bang originel du rock. «Jett Rock» a l’allure d’un champignon atomique. Seiji brasse ses accords dans le chaos et la poussière. C’est encore du Wray de Wray, une extension du génie Linky. Ils font sur cet album surchauffé une belle reprise de «Kick Out The Jams». Ils recréent l’énergie du MC5, mais à leur façon. Il est vrai que l’énergie est au rendez-vous et même beaucoup trop au rendez-vous. Ça hurle dans une ville en flammes. Nouvel hommage spectaculaire à Link Wray avec «Rumble». Guitar Wolf est certainement le dernier groupe sur cette terre capable de comprendre l’essence du génie de Link Wray, le rock God par excellence. Guitar Wolf semble réanimer le mythe. Encore une fois, ils nous emmènent loin au-delà du garage. Ils repartent à l’assaut du ciel avec «Thunder Guitar». Toru bat ça comme plâtre. Il aurait dû s’appeler Odin. Il faut l’entendre faire son cirque dans «El Toro». Il entre dans la caste des meilleurs batteurs de rock.

La chose se confirme avec l’album Planet Of The Wolves. Toru pourrait bien être le dynamiteur suprême. Pour s’en convaincre, il suffit d’entendre «Wild Zero». Toru y bat tout ce qu’il peut. Le cut sonne comme une fricassée de mastering dans laquelle les oreilles n’ont plus de repères et Toru concasse le chaos. Il est l’héritier direct des grands batteurs qui ont accompagné Link Wray. Le jeu de Toru ne doit rien ni au punk ni au garage, c’est une powerhouse au meilleur sens du terme. C’est lui qu’on regarde quand Guitar Wolf joue sur scène. Une fois encore, cet album est dangereux pour l’équilibre mental de l’auditeur moyen, surtout quand ça se passe sous un casque. «Kawasaki Rock’n’Roll» siffle dans tous les sens et «Planet Of The Wolfes» balaie la toundra de Dersou Ouzala. Nous voilà de retour dans la tourmente, avec un seul point de repère : Link Wray. Si on voulait qualifier «Invader Age», on pourrait oser une métaphore du type puissante charge de Chevaliers Teutoniques sur le lac gelé. Le black Rider qu’on voit cavaler en tête, c’est bien sûr Toru. L’infernal Toru. C’est lui qu’on aurait dû appeler Mister Dynamite. Seiji chante «Energy Joe» au bord du gouffre de Padirac, et avec leur version de «Satisfaction», ils massacrent Otis à la tronçonneuse. Ces trois-là sont atteints de folie sonique, et c’est une vraie bénédiction.

Quand on demande à Seiji si Jet Genetarion est le loudest CD of all time, il répond qu’il se fout de savoir s’il est le plus bruyant. Ce qui compte à ses yeux, c’est de pouvoir entrer dans le rouge des vu-mètres - In the red zone - Pourquoi ? I just want to be like a jet plane, oui, Seiji veut sonner comme un jet. Il ajoute qu’après sa mort, il aimerait bien se réincarner en jet. Jet Generation est l’un des albums les plus solides de Guitar Wolf. Sans doute à cause de l’ahurissante version de «Summertime Blues» qui s’y niche. Ils sonnent carrément comme les Who, avec la même puissance de powherchords powerhousiens. Les voilà devenus rois du blast suprême. Du blast, on en trouve à la pelle sur cet album indomptable : en B, avec «Roaring Blood», explosé à la gratouille punkoïde. Ça gicle dans tous les coins. Ils jouent comme des fous dangereux et Seiji semble fuir dans le brasier. On peut pas faire mieux qu’eux, en matière de blast. Seiji gueule à s’en arracher les ovaires. Autre énormité, le fameux «Cyborg Kids», noyé de son et zébré d’éclairs. On aura pris «Jet Generation» en pleine poire, dès l’ouverture du bal, un cut sur-saturé de son d’entrée de jeu, mais pas que de son, c’est sur-saturé de tout, de Japon, de cuir, de tattoos, d’accords, de one-two-three-four. Ils en rajoutent tellement que ça finit par s’affaisser sous le poids. Ils saturent plus loin «Kaminari One» de colère et de raunch. Ah ces Japonais ! Quand ils décident de brusquer le choses, ils savent y faire ! Tout est bon sur cet album, au sens du blast. Ils groovent carrément dans «Refrigarator Zero», et ça reste infiniment attachant. Ces mecs ne lâchent jamais la rampe du rampant. Avec «Shimane Slim», ils nous font le coup de trash punk serein, solide, joué avec l’énergie jusqu’auboutiste de purs kamikazes. On est hélas obligé de faire référence aux vieux clichés japonais. C’est malheureux, mais c’est comme ça.
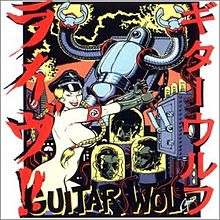
Pour écouter l’album Live paru en l’an 2000, il faut soit faire preuve d’une certaine abnégation, soit s’armer de courage. Certains titres sont en japonais, comme le un qui ouvre le bal des vampires. Alors attention, car Toru y fait un numéro de batteur fou. Chaque fois, Guitar Wolf recrée une ambiance spéciale, un mélange de Wolf et de Wray, le loup et l’Indien. Il n’y a qu’eux pour développer une telle ambiance. Tout leur son et leur conception du chaos vient en droite ligne de Link Wray. La version de «Jet Generation» qui suit est elle aussi complètement dévastée. Avec No Sleep Till Hammsersmith, c’est l’album live le plus ultraïque qui soit ici bas. En contrepartie, ce disque n’a aucune chance de passer sur les radios commerciales. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se noyer dans l’urgence sonique de Guitar Wolf, c’est là, dans le trois. Belle version de «Jack The Ripper» que Toru dynamite. Il n’en finit plus de relancer les cuts. Cet album live est SON album. Le sept est aussi une fournaise évangélique qui dépasse l’entendement. Guitar Wolf ne joue pas du rock. Non, ils s’amusent plutôt à fissurer l’atome du rock. Ils noient Eddie dans l’exaction de «Summertime Blues», ils lui giroflent le clou et dans le douze, Toru fait encore un festival hallucinant. On trouve encore d’autres merveilles comme «Kick Out The Jams» où ils poussent tellement le bouchon qu’ils noient le riff dans leur mélasse et ils terminent avec une version de «Rumble» jouée à la basse.

Avec Rock’N’Roll Etiquette, on prend un nouveau coup de blast derrière les oreilles, et notamment avec «God Speed You», qui ouvre le bal sur le mode terrifico-screamy-distordu, une vraie cour des miracles, l’ultimate des primates. Bienvenue dans l’œil du cyclone. Avec «Jet Virus», on a l’impression qu’ils deviennent de plus en plus imputrescibles ! C’est tellement sur-mastérisé dans le néant du chaos que les oreillettes du casque sautent. En prime, Toru bat comme un triple diable, c’est-à-dire un diable à trois têtes. Impossible de trouver plus psychotique sur le marché, ça n’existe pas. «Murder By Rock» explose sans nous demander notre avis. On se retrouve directement en plein boum. Nos trois héros s’amusent à défier les lois de la physique et à repousser les limites, même celles du killer solo. Toru revient à la charge dans «Venus Drive». Il bat vraiment à la vie à la mort et Seiji passe un solo qui taille dans la boustifaille de la sonicaille. Tiens ! Voilà une cover ! Un classique garage des Royal Pendletons intitulé «Sore Loser». C’est enfoncé la gueule dans la braise dès l’intro. Le jus coule en grésillant. Oh, ça coule de partout ! Voilà encore un cut effarant de blasting et l’admirable Seiji passe un killer solo flash de cinq secondes. Attention à «Drive With Wolves» ! Guitaaaaah ! Le cut s’écroule directement dans la fournaise. On se régale aussi d’«Earth Love» qui explose de base et de rigueur. Aucune pitié pour les canards boiteux et les oreilles des lapins blancs. Toru le damné bat. À côté de lui, Keith Moon et Rat Scabies ne font plus le poids. Nos trois démons favoris terminent cet album exubérant avec un bel hommage à Jack Scott : «The Way I Walk». Seiji n’a pas la retenue de Lux, mais il s’aplatit devant la grandeur de Jack.

UFO Romantics, sorti sur Skydog en 2002, est sans doute leur album le plus connu. On y trouve quatre hits garage, à commencer par un «Zaaa Zaaa Asphalt» de belle tenue parcellaire, un cut qui se tient bien car ponctué au ratatam de batterie. Ça sonne comme un classique doté en prime d’un final éblouissant. Arrive un peu loin l’excellent «Gion Midnite», amené lui aussi au tatapoum japonais. Il s’agit là de leur cut le plus frappant car frappé sec et relancé à coups de gros gion midnite ! En B brille l’éclatant morceau titre, monté sur le vieux riff d’Eddie Cochran, un cut très intéressant par son côté power pop blasté aux powerchords. Ils finissent par s’attirer la sympathie de la clientèle. Le quatrième hit de l’album est le dernier, «Lightning’s Melody», allumé à la folie pure. Ces trois petit japonais jouent comme des démons, mais pas les nôtres, ceux du Japon, tout petits, plus grimaçants et plus espiègles. C’est réellement convainquant car riffé à l’os du genou et joué à la vie à la mort, sur-chargé de distorse de son et ruisselant de fièvre quarte.
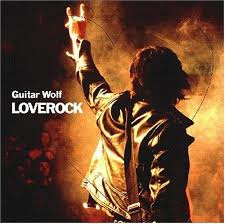
Bienvenue à la foire à la saucisse de blast dans Loverock. On a là le même genre de blast que chez les Hellacopters, un rock qu’on appelait à une époque le rock high energy. «Demon Card» baigne dans un jus de tension extrême. Seiji y passe un solo d’étranglement de notes cisailleuses. On peut bien parler ici d’énergie carnassière. Autre merveille du genre : «Shinkanson High Tension», joli slab de power pop à la Japonaise, vrillé à la pire stridence de solo qui soit. Avec cet album, nos trois héros passent à l’étage supérieur, avec des cuts puissants comme «Universe Youth». Le refrain y sonne comme un hymne. On ne s’ennuie jamais avec eux. Autre cut d’antho à Toto : «Moonlight Boy». Rappelons-nous que la puissance est l’apanage des power-trios. Et comme ça japonise dans les brancards, on imagine le résultat. C’est bardé de bouquet d’accords, hurlé dans l’enfer de la fournaise et même chanté au nah nah nah poppy. Quelle dégelée ! En B, on va tomber sur un «Black Hawk» très vindicatif, très déclaratif, c’est chanté à la colère militaire japonaise hélas bien connue. Avec «Katsumiya Tobacco City», nos trois héros délivrent un joli paquet de trash à la cisaille. C’est presque de la barbarie. C’est tellement criard que ça bascule dans l’extrême violence. «Fire Joe» fait aussi partie des hits de ce disque infernal. Ils nous noient ce cut dans une bouillasse sonique à la MC5, avec en prime un solo flash digne de Wayne Kramer. Mais ce qu’on retient le plus de cet album, c’est le cap qu’ils mettent sur la power pop, avec des cuts comme ce «Time Machine Of Tears» gourmand en décibels, ou encore l’effarant «SF Tokyo». Pour le coup, l’expression power pop prend avec eux tout son sens. Ne faites pas l’erreur de prendre Guitar Wolf à la légère.

Billy Basswolf, celui qui ressemble à Link Wray, casse sa pipe en 2005. Depuis UG le chevelu le remplace. C’est lui qu’on voit maintenant sur scène avec Seiji le loup et Toru le batteur fou. Tiens, justement ! Les Guitar Wolf jouent ce soir au Petit Bain ! Incroyable ! Encore plus incroyable : Toru mange un bon gâteau à la crème à la cantine. Comme tous les Japonais, Toru le batteur fou est d’une gentillesse confondante. Il est aussi svelte que Spooner Oldham et porte un perfecto Guitar Wolf, un pantalon de toile claire et une belle pompadour. Rien qu’à le voir assis là, à côté, on se sent de retour dans le vrai monde, celui des gens qui écoutent les bons disques.

Curieusement, nos trois héros vont jouer dans une salle à moitié vide. Ils arrivent sur scène coiffés de têtes de tyrannosaures (en écho à leur dernier album, T-Rex From A Tiny Space Yojouhan) et mettent aussitôt leur machine infernale en route. Maximum overdrive ! Aucun souci, ils restent fidèles à leur réputation. C’est vrai que Dieu leur a assigné un mission : blaster l’occident, mais derrière les oreilles.

C’est toujours un régal que de voir Seiji le zigoto haranguer les filles qui dansent. Il brandit une belle SG rouge barrée d’un gros sticker Goner. Il hurle tout ce qu’il peut hurler. C’est comme si chaque fois qu’il yaourtait une connerie, son corps se vidait. À la manière des mages de l’ancien temps, il rallume les flambeaux un par un et éclaire la nuit qui semble vouloir s’abattre sur le monde.

Une culture vaut pour un monde, puisqu’elle façonne des vies. Dès lors, on se rassure, car tant que des mecs comme Seiji - le roi des coups d’épée dans l’eau - monteront sur scène, la culture vivra. Tant que Toru le batteur ailé beurrera son beat, le pouls du vrai monde battra. Tant que des petits mecs comme UG le chevelu remplaceront les âmes dévorées par Saturne, la médiocrité reculera de quelques mètres, en sifflant comme un démon qu’on asperge d’eau bénite. Vu sous cet angle, il peut s’agir d’un qui-vive de tous les instants, d’un ultime raout de rage face au rideau de ténèbres qui va finir par nous encercler et par nous avaler, tous autant que nous sommes, et tant mieux.

Avec son rage rage against the dyin’ of the light, Dylan Thomas fut l’un des derniers mages des temps modernes. Seiji, UG et Toru mènent exactement le même combat. Pas question de baisser les bras. Même s’ils n’ont que trois personnes dans la salle, ils joueront. Non seulement, ils vouent leur vie au rock’n’roll (c’est écrit sur les ceintures qu’ils vendent), mais ils ont aussi le talent qui leur permet de créer une légende.

Vous voulez entendre un bon battteur ? Alors écoutez Dead Rock. Toru bat «Fighting Rock» au tribal des cavernes. C’est un authentique batteur fou. Il claque le beignet des annales et il fait danser les breaks. Puis il rebat «Sex Napoleon» à outrance. Il bat vraiment comme un dingue. Tous les batteurs devraient l’écouter jouer. Avec «High Schooler Action», Guitar Wolf fait une belle OPA sur la power pop. Avec un mec comme Toru derrière, ça devient enfantin. Il joue ça bien sec. Il joue «Wild Bikini Girl» à la poussive carnassière, et ça avance sur un tapis de basse en distorse. Pour couronner le tout, Seiji claque des solos flash qui resteront des modèles du genre. Et puis on tombe plus loin sur un «Asian Explosion» joué à la force du poignet japonais. Ça blaste à outrance, comme l’indique le titre du cut. Toru n’a aucune pitié pour son enclume. Personne ne peut rivaliser avec lui. C’est aussi lui qui blaste le cut suivant, «Ikebukuro Tiger». Comme dans Ran de Kurosawa, Toru incendie toutes les forteresses. Pour finir, on écoutera «Red Situation», histoire de voir comment se joue un cut à l’éperdue.

L’une des plus belles versions d’«Hoochie Coochie Man» se trouve sur Spacebattleshiplove paru en 2010. Le heavy blues leur va vraiment comme un gant. D’autant qu’on a la pire hurlette du pays du Soleil Levant. C’est dingue ce qu’il peut gueuler, Seiji. Si Muddy entendait ça, il serait surpris. Il y a là de quoi faire sauter Chess et même Chicago. Quand Seiji part en solo, les immeubles s’écroulent. Il est certain que Guitar Wolf ne peut pas plaire à tout le monde. C’est trop brut, trop hurlé, beaucoup trop rock’n’roll. Mais en même temps, c’est une véritable aubaine pour les tympans crevés, et, on l’imagine, une souffrance pour les natures délicates. Le morceau titre sonne comme un balladif insipide, mais derrière, Toru bat comme un démon. Comme ces gens-là ne se connaissent pas de limites, ils ont forcément le monde à leurs pieds. Ils compressent le son pour offrir plus d’espace à l’ampleur de la clameur. Quels fantastiques pourvoyeurs d’orgasmes soniques ! Encore une monstrueuse prestation de Toru dans «Voltage Sepa/Han». Toru tear it up ! Il frappe tellement que ses coups rebondissent. Voilà un prodigieux tatoué au son tribal psychotique. Sous des dehors approximatifs, ces trois mecs se révèlent extraordinaires. Ils bousculent les genres, album après album. Avec «Tears Are Violence», ils sont complètement explosés de l’intérieur. Le son revient par vagues, mais ce sont des vagues de ras-de-marée. Ils traumatisent le rock. Ils emportent tout, les cons, les coins, les cas, les cops, les cars, les cuts, les crus, les crans, les caps. Avec «Concret Punk», ils s’amusent à faire du punk, mais c’est trop facile avec un mec comme Toru derrière. Il cavale à perdre haleine et soudain arrive un killer solo ! Absalon ! Absalon ! Au bout de dix titres de Guitar Wolf, normalement on lâche prise, mais un truc comme «Hakata Tactics» réveillerait un mort. En écoutant Guitar Wolf, vous économiserez au moins une boîte de cotons-tiges. C’est assez con, comme métaphore, mais elle a le mérite de bien situer le contexte du cortex.

Curieusement, Beast Vibrator, paru en 2013 souffre d’un problème de son. Seiji commence par hurler le morceau titre dans la tourmente et il fait vite le tour de problème. Il chante «Gasoline Lullaby» un peu faux. Dommage. De toute façon, on ne saura jamais à quoi sert ce cut. Et puis, de cut en cut, on les voit s’enliser dans des longueurs fantômales. Auraient-ils perdu leur pouvoir ? Même impression en B, avec «Magma Nobunaga», monté sur un riff sporadique. On se réveille enfin avec un «Barf Night» monté sur un riff de r’n’b et un joli groove de basse pompé chez Booker T. & The MG’s. Ils finissent cet album un peu falot avec un «Female Machine Gun» en forme de fournaise à la Guitar Wolf. Même si on sort déçu de cet album, on l’écoute jusqu’à la dernière note car le groupe sait rester attachant, quelle que soit la qualité des cuts. On voit bien qu’ils lutteront jusqu’au bout.

Leur dernier album en date s’intitule T-Rex From A Tiny Space Yojouhan. C’est pour ça qu’ils arrivent sur scène avec des têtes de Tyrannosaures. Alors bien sûr, cet album n’échappe pas à la loi du blast. On se retrouve dans les cordes dès «Jet Reason» et ça continue avec un «Ameoba Love Song» trop dur, trop saturé. Nos petits soldats du trash continuent de monter à l’assaut de la gloire, mais avec brio, car ça se passe dans un pur wall of sound. Il n’existe aucun équivalent de ce raw to the bone dans le mode civilisé. Les Chrome Cranks ? Non, c’est encore autre chose. Avec «Alain Delon’s Revenge», Seiji s’amuse à jurer comme un cocher - Merde ! What a mess ! - Il passe un solo concasseur d’une horreur abyssale - Je t’aime ! Je t’aime ! - Il gueule et ça tourne au fantastique. «Sean And Cold» flotte dans l’air, tellement le son sature. Ils jouent ça aux fumerolles de la fin du monde. Ils chaufferaient une ville entière avec l’énergie qu’ils dégagent. Encore une fois, c’est Toru le génie tribal qui fait le cut. Il bat comme un vrai dingue. Et puis avec «Ninja Season», nos trois vaillants amis font du cinémascope. Leur vague de son balaie tout à 180°. Jolie façon de conclure que ce «In The Galaxy». Ils jouent leur va-tout en power-pop et nous saluent avant de disparaître dans la fumée.
Signé : Cazengler, Guitar Whore
Guitar Wolf. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 6 octobre 2016

Guitar Wolf. Wolf Rock. Goner Records 1993
Guitar Wolf. Kung Fu Ramone. Bag Of Hammers 1994
Guitar Wolf. Missile Me. Matador 1996
Guitar Wolf. Run Wolf Run. Less Than TV 1996
Guitar Wolf. Planet Of The Wolves. Ki/oon 1997
Guitar Wolf. Jet Generation. Ki/oon 1999
Guitar Wolf. Live. Ki/oon 2000
Guitar Wolf. Rock’N’Roll Etiquette. Ki/oon 2000
Guitar Wolf. UFO Romantics. Skydog 2002
Guitar Wolf. Loverock. Narnack Records 2004
Guitar Wolf. Dead Rock. Ki/oon 2007
Guitar Wolf. Spacebattleshiplove. Ki/oon 2010
Guitar Wolf. Beast Vibrator. Ki/oon 2013
Guitar Wolf. T-Rex From A Tiny Space Yojouhan. Ki/oon 2016
Vive Le Rock #39. James Sharples - Monster Squad.
De gauche à droite sur l’illusse : Billy, Seiji et Toru.
23 / 12 / 2016
MIREPOIX / SALLE PAUL DARDIER
JUKE JOINTS BAND / NUMBER NINE
NOBODY'S PERFECT

La teuf-teuf piaffe de joie. Vient de parcourir d’une seule traite trois cent cinquante kilomètres et de nous déposer avec une heure d’avance devant la salle de concert. Pari tenu malgré les files d’attente sur l’autoroute. Les gens qui se ruent dans les centres commerciaux pour les cadeaux de Noël. En tout cas à Mirepoix l’atmosphère n’est guère festive. Ruelles noires, désertes, vides, et des centaines de corbeaux qui croassent et piaillent sur les arcs-boutants de l’église. Doivent se rejouer Les Oiseaux d’Hitchcock. Parfois, sans préavis, ils s’envolent tous en même temps et leur vol lourd tourne sans fin autour du clocher, sinistrement, comme l’annonce d’une catastrophe imminente. Une véritable invitation au suicide préventif. Un truc à vous refiler le blues au minimum pour trois mois. Parfait, justement ce soir : concert de blues !
Remarquez, l’existe différentes teintes de bleu. Le bleu sombre des idées noires et le bleu pâle des petits matins livides, genre When I awoke this morning, my babe was not inside… Vous connaissez, je ne vous fais pas de dessin, surtout que ce soir ce sera funny and sunny blues, mais laissons défiler les images.
ELSA
Deux euros l’entrée, un euro si vos êtes affilié à l’association. Un gala de bienfaisance pas tout à fait dans les normes, du beau monde, mais pas celui qui se presse chez Dior ou Cacharel. Elsa est une association d’entraide aux plus démunis, un local - pour se ressourcer et conseils juridiques gratuits - qui ne désemplit pas depuis trois mois. S’agit avant tout de reprendre confiance en soi, pour mieux affronter la vie aussi tranchante qu’une lame de guillotine. Pas question de s’apitoyer sur l’injustice du sort, plutôt apprendre le rituel des pirates qui montaient à l’assaut le rire aux lèvres et le couteau entre les dents. Chez Elsa font feu de tout bois, se servent de leur stock d'échange de fringues et des amis autour. Ce soir, ce sera deux groupes de zicos du coin ( trois si vous savez compter ) et défilé de mode. Ne faites pas les étonnés, vous n’avez jamais entendu parler de la naissance du punk à Londres dans la boutique de Vivienne Westwood ? A part que chez Elsa on ne se prend pas pour des créateurs. Considèrent la mode comme un travestissement, un moyen de se faufiler hors de soi et d’incarner la formule rimbaldienne du je qui est un autre.
MODE

Un gamin et une vingtaine d’adultes de tous les âges mènent la sarabande à train d’enfer. Bande-son derrière, miment, dansent, courent, se bousculent, se pavanent, se dandinent, sautent, minaudent, tour à tour Betty Boop, Marylin, rappeurs, artistes de cirque, bavarois, écossais, déboulent, défoulent et déroulent la fresque du monde, une centaine d’incarnations qui se bousculent dans la chrysalide des coulisses, viennent faire leur tour, et s’enfuient rapidement aussi vite que ces papillons qui finissent en apothéose dans la flamme de la bougie. Burlesques à la Cocardasse et à la Passepoil. Les gars jouent aux jeunes premiers et les filles ont des gorges dénudées de duchesses. Applaudissements nourris, interpellations, embrassades, une demi-heure de couleurs disparates et froufroutantes, une queue de comète éblouissante. La parodie en tant qu’acte du réinvestissement du réel mythifié. Pas le temps de respirer, Maître Chris au micro détaille le programme de la soirée. N’aura pas besoin d’aller bien loin, juste le temps d’enlever son blouson, Ben Jacobacci prend place sur son tabouret, l’on aperçoit Damien Papin - porte sur son dos sa contrebasse comme l’escargot sa coquille - qui se faufile par l’entrebâillement de la porte d’entrée. L’est déjà sur scène en train de s’harnacher de sa basse électro-acoustique.
JUKE JOINTS BAND
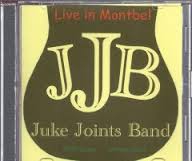
Que diable, Ben et Damien ont dû gober douze œufs mimosas à la cocaïne avant de monter sur scène. Survoltés. Du blues enrockbé de dynamite. Deux misérables grattes qui vous tissent un de ces quadrillages métalliques comme les électriques n’arrivent à en accoucher que les soirs de grand vent rock‘n‘rolliens. Une déjection canine des chiens de l‘enfer dans vos oreilles. Pauvres instruments soumis à une effroyable torture. Ben a décidé de scier ses cordes avec ses ongles. Fait voler le blues en éclats. L‘écartèle et le dispatche aux quatre coins de l‘univers. Ne regardez pas le va et vient de ses mains, si vous ne voulez pas devenir fou. Le tic-tac titanic du destin détraqué qui se hâte de courir vers la catastrophe finale. Une amplitude sonore inégalée. Le râle de la mort sûre. Damien tout aussi foutraque mais tout en longueur. Une note, l’une après l’autre. Mais attention au traitement spécial. Au début la laisse échapper telle une torpille qui se tortille, swingue du museau pour chercher sa direction, l’épouse les formes de la vague, nous la fait plus jazz que moi tu meurs, et c’est vrai qu’elle ondule méchant explorant toutes les subtilités modales de sa propre sonorité, et brusquement elle file droit et loin, un éclair, la charge de foudre qui explose sur les saccades de Ben, et la lumière bleutée du blues se change en technicolorock. Pas le temps de voir le film, y a un chien de sa chienne encore plus féroce qui la suit de près. Sur ce Ben surenchérit, plus vite, plus fort, plus violent.
Qui serait capable d’arrêter la pluie d’un tel déluge ? Chris, bien sûr. Fait tout de même signe qu’on lui monte le son. N’ayez crainte, connaît ses rituels par cœur. Sang de vaudou et âme noire de colère enragée. Faut la voix qui râpe le granit du réel pour proférer ces saillies d’ensorcèlement et d’anathèmes, porte à ses lèvres le sang du Chris, un coup de rouge, un coup de blues et la fièvre noire vous colle à la peau comme la jaunisse du désespoir. Et Ben survolté qui pousse de sa voix d’aboyeur les refrains des morceaux car il faut toujours appuyer là où ça fait le plus mal. Chris la chignole qui grince comme les seaux des puits dans les poèmes de la trilogie noire de Verhaeren. Le blues comme un bélier qui fracasse les portes de l’hypocrite fausseté du bien-être.
PREMIERE INVITATION
Le coup de la fausse nostalgie. Vu les zigotos qui dansent sur la piste, la tête surmontée de branches d’arbres - ressemblent à des créatures alligatoriennes échappées des bayous - ce n’est pas le moment d’entamer la séquence des larmes. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était. Fred est prié de s’installer derrière la batterie. Voilà vingt ans, il jouait avec Chris, nous en saurons davantage tout à l’heure. S’en vient jouer de la grosse caisse et des mini-fûts. S’intègre très bien dans le raffut de nos cordistes, ce soir le JJB ne pose pas des cloisons en placo-plâtres, ont pris l’option agencement de murs cyclopéens à la Lovecraft, bye-bye le blues plaintif qui rampe plus bas que terre, ce soir c’est le grand varan destructeur des Galapagos qui mugit de colère et de joie. Chris n’hésite pas à rappeler que les chiens de l’enfer n’engendrent pas des chatons mignons, enjoint les pauvres à rentrer dans le cercle mouvant des danseurs. Les invite au banquet des mendiants, afin d’investir la royale assemblée des hommes libres. Le blues brise les chaînes sociales et vise à l’accomplissement individuel. Le JJB descend de scène sous les acclamations.
NUMBER NINE
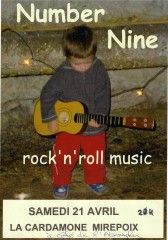
Number Nine prend la relève. Christophe s’arme de sa basse et Jeff de la lead guitar. Fred est resté à sa place. Le groupe local par excellence. Vingt ans d’existence et toujours ensemble. Les copains qui se retrouvent régulièrement pour pousser la rocksonnette. Pour le plaisir. Pour perpétuer l’illumination native de leur seize ans. Sévissent dans les environs comme ils disent. Sans prétention, mais sont comme des dolmens inamovibles du milieu rock mirapicien. Des amateurs, au sens noble du terme. Font partie de ce terreau des groupes irremplaçables qui perpétuent la flamme rock dans les campagnes les plus reculées. Chaque fois qu’ils montent sur scène revit le rêve de la grande mythologisation des sixties and seventies. Ces années de feu où le rock donnait l’impression d'accoucher d’une nouvelle culture dont l’implantation bousculerait le vieux monde dans les poubelles de l’histoire. Le rêve est mort, mais le rock and roll survit. Un dinosaure échappé de l’extinction programmée des espèces.
Envoient la béchamel sans chichi. A pleines louches. Des premiers Beatles à Led Zeppe, tout ce que l’on aime, rajoutent quelques vieux rock pour faire monter la sauce. Derrière ses fûts Fred s’empare du micro et vous envoie de ces mouscailles de mouettes qui ricanent de joie dans les vents les plus tempétueux. Un délice, servi chaud et rapide. Parfois Jeff prend le relais. Jeff la force tranquille et débonnaire. Arbore les mimiques de celui qui n’y croit pas, qui va se planter dans le premier riff qui passe et hop il vous refile de l’airain estampillé qualité supérieure. Christophe est encore pire dans l’auto-dénigrement. S’excuserait presque de vous faire prendre votre pied d’argent massif. Echangent leurs places, Christophe ceint sa Flying V, et Jeff se met à la basse et c’est reparti pour le pont d’Arcole.
FRERE JACQUES
L’est demandé pour venir sonner matines avec ses anciens compagnons. Du temps d’avant vingt ans où les Number Nine s’appelaient Nobody's Perfect. Possédaient alors deux guitaristes et ce soir Jacques remonte sur scène. Un tantinet crispé et les doigts un peu rouillés. Laissera deux ou trois fois passer son tour, mais attention va vite retrouver ses talents de bretteur. L’a intérêt car ses potes ne lui font pas de cadeau. L’introduisent dans une des meilleures pièces de la maison rock, White Room des Cream, pas moins ni plus, et Jacques retrouve ses marques de fine lame, un jeu délié à la Clapton, fait chanter les aigus tandis que ses acolytes lui servent un accompagnement brut de décoffrage, qui met parfaitement en valeur son ruisseau électrique minéralisé.
Après un tel morceau, l’on ressort les classiques, Sweet Little Sixteen idéal pour que chacun prenne son chorus de guitare et un Jailhouse Rock dégobillé à la Led Zeppe, guitares étincelantes à fond et Fred l’égosillateur sans frein qui mène la cavalcade à fond de train. Anthologique. L’on se calme avec le balancement régulateur de Worried Life Blues.
NOBODY'S PERFECT
L’en manquait encore un. Un groupe sans chanteur est une erreur de la nature. Le boss est demandé au micro. Et voici Chris qui revient pousser la goualante avec ses poteaux. Start It Up comme entrée en matière. Dantesque. Le font durer comme les couloirs de l’enfer avec traversée obligatoire des fournaises les plus chaudes. Le combo envoie du séquoïa, n’y a plus que les filles exaltées qui dansent du ventre et de tout leur corps, les mâles ont abandonné la partie, les sorcières ont trouvé un sabbat digne de la fièvre hystérique qui les agite. Under Cover, Sweet Home Chicago sont brandis tels les brandons d’Alexandre boutant le feu dans les palais de Persépolis. Ben est rappelé en renfort de pyromanie. S’empare d’une électrique et la triture un peu à la façon du Marquis de Sade réalisant ses phantasmes sur le corps pantelant d’une Justine fortunée des plus cruels délices. Un Mustang Sally et un Walking by Myself à vous rendre fous et l’on termine par un Crossroads démentiel qui vire carrément à la folie collective. Au bout duquel Chris déclare forfait. N’est pas descendu de l’estrade qu’il est happé par un groupe d’admiratrices.
Se fait tard mais l’on ne va pas se quitter comme cela, les trois mousquetaires de Number Nine ont encore de la ressource, nous offre un mini-festival Rolling Stones et finissent par appeler l’australien de service. Loïc et sa guitare. Pantalon court, veste de collège et cornes du diable clignotantes sur la tête et c’est parti pour un Highway to Hell à tombeau ouvert qui emporte l’assistance au paradis des rockers.
RETOUR SUR TERRE
Demain le Père Noël peut rester au chaud avec ses rennes. L’on a déjà eu notre cadeau. Ne pourra nous offrir rien de plus beau. Blues and Rock forever !
Damie Chad.
APPROCHES DU R&B
I
PORTRAITS DE FILLES ELECTRIQUES
J’AI ENCORE ESQUINTE MON VERNIS
EN JOUANT UN RE SUR MA GIBSON
JEAN-ERIC PERRIN
( Editions Tournon / Mai 2009 )
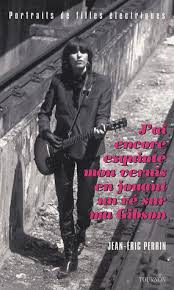
Retour au Gibus. Pas le parisien. Au camion itinérant aujourd’hui au marché mirapicien. L’ai déjà dévalisé la semaine dernière. Ne reste plus grand-chose à part les quatre premiers numéros ( petit format ) de la revue Harmonix spécialisée dans le rock progressif. Se vendait uniquement par abonnement. J’hésite, lorsque mon regard est attiré par une fille. Waouh ! Quel chien ! Vous la voyez l’espace d’une demi-seconde et déjà le chiendent du désir vous embroche le cœur. Je ne vous fais pas languir, c’est Chrissie Hynde. Inutile de faire les présentations. Belle couverture mais titre racoleur aux limites de l’idiotie. Mais pour la dégaine de Chrissie en couverture - ah cet air dédaigneux dont elle vous toise ! - vous achèteriez deux mille mauvais livres sans sourciller. D’autant plus qu’à la maison je bois du petit lait. Passe la moitié de l’interview à me couvrir de compliments. A l’écouter je suis un gars parfait bien au-dessus de tous ces balourds d’américains parmi lesquels elle a vécu. Une déclaration d’amour envers ma modeste personne qui vous rendra fous de jalousie. Non, elle ne parle pas exactement de moi. Vous avez eu peur. Mais du rocker français. N’est pas rongée par le doute la Chrissie, le pays qui aime le rock, qui possède un public averti, c’est le nôtre. Et depuis longtemps. Cite les jazzmen qui sont venus s’installer en France pour fuir la crasse bêtise de leurs concitoyens. Déclaration sans ambiguïtés, les véritables amoureux du rock and roll, les connaisseurs comme elle nous qualifie, nichent par chez nous. A l’entendre, au béret et à la baguette de pain qui nous épinalisent selon les nations étrangères, faudrait ajouter sous l’autre bras une pochette de trente-trois tours de Willie DeVille. Il y a des filles qui n’ont qu’à ouvrir la bouche pour se faire aimer.
Jean-Eric Perrin, ce sont ses dossiers qu’il ressort. Trente-quatre des interviews des donzelles du rock qu’il a rencontrées pour Best, Rolling Stone Rock & Folk, RER et R&B magazine. N’est pas fou, n’a pas voulu générer des haines irréconciliables de préséance mal placée, les a rangées dans l’ordre alphabétique. Parfois elles datent de plusieurs années, il résume en quelques lignes - dans la série que sont-elles devenues ? - la suite de leur carrière, souvent il remodelise l’article initial en ajoutant un ou plusieurs paragraphes qui redéfinissent les circonstances. Pour les photos qui illustraient ses contributions, nacash, pas une seule, même pas un petit format en blanc et noir. C’est râlant, surtout qu’à lire les descriptions énamourées que Jean-Eric Perrin dresse de ses interviewées, nous avons affaire à de superbes créatures douées d’une plastique de rêve ou d’une personnalité étonnante, parfois les deux conjuguées…
ELECTRICITE
De nos jours l’électricité est partout. Dans le fil qui alimente votre batteur à œufs comme dans les lignes à haute tension. De même chez les filles. Perso j’aurais tendance à classer les meilleures condensatrices d’énergie chez les rock and rolleuses. Vous en trouverez quelques unes, Chrissie bien sûr mais aussi Debbie Harris, Siouxie Sioux, Wendy O Williams, Marianne Faithfull et c’est à peu près tout. Ne proposez pas d’autres noms, vous feriez erreur. D’abord l’on ne peut interroger que celles qui passent auprès de votre micro. Si Poison Ivy n’est pas dans les parages, il est peu de chance que votre rédac chef vous loue un jet privé pour partir lui poser douze questions aux States. A l’impossible nul n’est tenu.

Et puis tout dépend de vos goûts et de vos couleurs. Qui se discutent. Jean-Eric Perrin fut directeur de RER revue spécialisée en Rap, et de R&B magazine. Le rap est avant tout une affaire de mecs machos. Ce n’est pas moi qui le dis mais les nombreuses icônes du R&B qui forment les gros bataillons du bouquin. J’en cite quelques unes : Tori Amos, Erikah Badu, Mary J Blige, Mariah Carey, Neneh Cherry, je m’arrête à la lettre C. Toutes interchangeables. Je résume un portrait type. Je suis née dans les quartiers, j’ai appris à me défendre, j’ai fait de la danse, j’ai toujours eu envie de chanter, une de mes cassettes est arrivée dans les mains d’un gros producteur, l’on m’a tout de suite proposé un contrat, j’ai enregistré un disque qui s’est vendu à deux millions d’exemplaires, je vis dans le luxe, je ne le regrette pas, noire, sang-mêlé ou hispanique j’ai connu les humiliations racistes, je fais des duos avec des rappeurs célèbres, parfois je sors avec, sont tout de même un peu violents, je travaille beaucoup, je continue à prendre des cours de chant et de danse, je dis ce que je ressens à mes producteurs qui m’écrivent les morceaux, je lance une ligne de vêtements, je participe à des défilés de mode, je tourne des clips, des publicité et des bides au cinéma. Je suis une femme libérée, je pose nue pour Playboy. Certaines un peu plus perspicaces mettent sur pied leur propre boîte d’édition, de production et de distribution. En plus, les pauvrettes, pour la promotion elles sont obligées de se farcir les interviews.
C’est Jean-Eric Perrin qui se charge du pensum. Ne le plaignez pas, il aime ça. Parfois elles sont entourées d’attachés de presse, de caméristes, d’habilleuses, et de maquilleuses. L’est un peu le larbin de ces dames, tôt le matin ou tard le soir. Mais il y a des compensations, l’est assis sur le même divan que la diva, sont dévêtues de vêtements qui lui laissent entrevoir des décolletés qu’il qualifie de vertigineux, normal ce sont des entrevues, lui est même arrivé de faire des interviewes couché à côté de la dame, n’est pas un mufle, ne raconte pas tout.

Les réponses sont un peu stéréotypées, les zamzelles s’appliquent, connaissent le discours par cœur. Parfois vous tombez sur une forte personnalité à la Grace Jones, vous avez alors l’impression d’être avec la copine frapadingue que vous préférez. Mais le must, c’est d’être envoyé en mission sur des inconnues. Sont au pied de l’escalier de la gloire mais n’ont même pas encore posé le pied sur la deuxième marche. Perrin aura ainsi la chance d’interviewer Madona dans sa chambre d’hôtel, au Meurice mais dans une soupente presque aussi large que le lit. Vient juste de signer chez Sire mais elle s’étend surtout sur ses expériences musicales hexagonales avec Patrick Hernandez de Born to be Alive…
Trois françaises : Hardy désabusée de tout, Birkin faussement modeste, Paradis qui se prend pour Calimero. Les trois toquardes de service, toutes les autres jouent, avec plus ou moins de talent, à l’interview ou avec l’intervieweur qui est assez intelligent pour ne pas être dupe. Nos mijaurées nationales, se confient et reniflent, le bureau des larmes, genre Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
Je résume en gros : nous sommes surtout dans les temps de l’après-disco. Quand la musique noire se perd dans l’hyper-sophistification, que les défauts de la Tamla deviennent des impératifs esthétiques, que le disque se transforme en produit de consommation de masse, que les chanteuses se suivent et se ressemblent, que l’artiste devient un élément interchangeable de la production… Une plongée au cœur d’une industrie qui n’a que peu de relations avec le rock and roll.
Jean-Eric Perrin ronronne avec les panthères noires mais ne hurle pas avec les louves. Un bel article sur Tina Turner - une grande chanteuse - mais c’était encore mieux avec Ike…
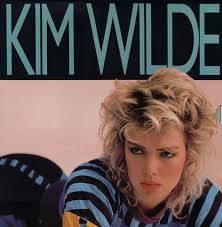
Faut pratiquement atteindre la fin du bouquin pour se retrouver en territoire connu. Jean-Eric Perrin la présente comme l’incarnation physique de son idéal féminin. Se pâme, s’il osait écrirait un poème sur sa blondeur. A dû le composer et le lui offrir mais il l’a supprimé de sa chronique. Kim Wilde ! Qui met tout de suite les points sur les I. Sa carrière n’en cause presque pas. D’ailleurs toutes ces dernières années elle s’est consacrée au jardinage. Non, elle, ce qui l’intéresse c’est le bon vieux rock and roll des familles. N’est pas la fille de Marty Wilde pour rien. Qui a rencontré des gens extraordinaires Eddie Cochran, Gene Vincent, Billy Fury… Ne s’en laisse pas conter. Moi je l’écouterais jusqu’au bout de la nuit cette blondinette.
Damie Chad.
II
R&B
ENTRE POP & BLACK MUSIC
MARC FANELLI-ISLA
( Editions Didier Carpentier / 2012 )
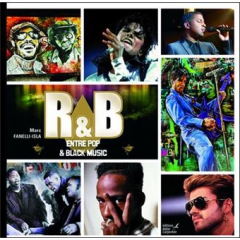
La première fois que je l'ai vu dans une librairie, j'ai ricané de mépris. Ne pouvais pas l'ouvrir puisqu'il était scellé dans une gangue de plastic indéchirable. Mais je subodorais ce qui s'alignait à l'intérieur de ce grand format. Une suite de sombres félines, plus redoutables les unes que les autres, complaisamment étalées en de voluptueuses poses suggestives de fausse candeur. Ce n'est pas qu'elles me laissent indifférent, mais questions poupées sonores je préfère les estampillées Dolls de New York. En plus 29, 50 euros ! La semaine suivante l'avait dégringolé à vingt. Huit jours après, trois euros chez le soldeur. Et la caissière m'annonce 1,50 sous prétexte d'une remise de 50 % sur le rayon livres. Evidemment, une fois dépouillé de sa coque protectrice, tricherie complète sur la marchandise. Les nanas faut les chercher. Rares, que des photographies minuscules et pour le sex-appeal c'est un peu décevant. Que des gars. Que des mecs. A téléphoner aux ligues de parité. Désolé de décevoir une partie de mon lectorat, même pas gay. En plus, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est rempli de texte. Est-ce le démon de la perversité cher à Edgar Allan Poe qui me pousse parfois à des commettre des achats inconsidérés de livres qui jactent d'une musique que je n'apprécie pas ? Point du tout, c'est le flair, le fameux flair du rocker, qui vous renifle une photo d'Elvis ensevelie à cinq cent mètres sous terre, sans faillir, avec la célérité d'une truie truffière. Car oui le bouquin est plus qu'intéressant.

Fonctionne comme une enquête. Marc Fanelli-Isla - les amateurs reconnaîtront G.No, chanteur de R&B latino. Donc ce jeune homme ( né en 1978 ) piqué par une saine curiosité a décidé de dresser la carte du génome de sa musique préférée. C'est un peu son truc à notre auteur, un citoyen multi-cartes, de son siècle branché sur l'informatique - tour à tour et en même temps chanteur, producteur, écrivain, journaliste, conseiller et autodidacte - les deux pieds dans la technologie, toujours en quête de nouveauté, les bras pris dans l'engrenage de notre modernité, mais avec le désir de tout comprendre des courants ascendants et contraires pour rester sur le haut de la vague... Vous pouvez le stigmatiser, entre ceux qui suivent la mode ou la musique et ceux qui la créent - n'en déplaise à David Bowie - la distance n'est pas si grande. D'où cette interrogation dans la première partie du bouquin. J'aime le R&B, mais que signifie cette musique ? Quel message porte-t-elle ? Que véhicule-t-elle au juste ? Que transmet-elle à son public ? Lui semble osciller entre deux extrêmes, un simple divertissement abêtissant ou l'expression d'une révolte nécessaire. Acceptation ou refus de la réalité sociale du monde ? Ne sera jamais très clair dans sa réponse. Mais Heidegger précisait que l'important réside dans le questionnement de la question. Le R&B est un phénomène complexe. La frontière entre les deux postulations est mouvante. Rien n'est tout à fait blanc ou tout à fait noir.

Choisit tout de même son camp. Le noir. La musique noire qu'il décrète l'élément constitutif primordial de la musique populaire américaine, puis occidentale et aujourd'hui mondiale. L'a trouvé la piste. Ne lui reste plus qu'à la remonter. Pour être exhaustif, il lui faudrait rédiger une encyclopédie en vingt volumes. Elira un itinéraire, définira un certain parcours, fera ses choix. C'est lui le guide qui organise la visite. Délaisse certaines pièces, s'attarde dans d'autres. Ne le critiquons pas, chacun agit de même.
Débute par les esclaves emmenés en fond de cale, glisse quelque peu sur le blues. Privilégie le gospel. Insiste sur les voix de têtes qui lui paraissent la première manière de se révolter contre l'oppression blanche. Des voix de castrat, qui symbolisent les mutilations psychologiques dont la communauté noire fut la victime non-consentante, et qui sont en même temps un formidable pied de nez à l'ordre des blancs, impossible de reconnaître une voix de femme d'une voix d'homme, confusion des organes, mélanges des genres et des sexes qui font si peur à la pruderie des puritains... Phantasmes résurgents des sexes noirs pénétrant le corps des blanches épousées chez les maîtres, tradition de ces notes tremblées dans le chant des noirs, ces falsetti qui font fondre les corps et émeuvent les âmes. Vous les retrouvez partout chez Sam Cooke, Otis Redding et dans toutes les ballades énamourées des chanteurs et chanteuses de R&B de ces trente dernières années. Un cri profond, un cante jondo qui puise sa source au fond des solitudes et de la détresse du peuple noir.

L'on ne va pas passer son temps à pleurnicher. Déjà au tout début, dans les Eglises, souvent on accélérait le rythme et l'on s'adonnait à de ces javas d'enfer ! Mais c'est après que les choses ont empiré. Lorsque petit à petit s'est formée une première bourgeoisie noire, en constante progression au fil des décennies. Qui n'avait qu'une idée, oublier les débuts difficiles et prendre un peu de bon temps. Les musicos ne se sont pas fait prier. L'on a attifé le vieux canasson fourbu du blues d'une coupe de crinière fringante et affublé son pas pesant d'un trot enivrant. Le rhythm and blues était né. Musique de danse et de joie. S'est tellement accéléré que sans y prendre garde il s'est transformé en rock and roll. Visite des studio Sun obligatoire, pleine page sur Screamin'Jay Hawkins, et j'en passe. N'allez pas chercher plus loin pour savoir d'où viennent tous les morceaux rythmés du R&B...
Tout n'est pas simple. Le monde n'est pas devenu tout beau, tout marrant. L'existe de terribles allers et retours. La ségrégation n'en finit pas de mourir, faudra des révoltes, des manifestations, des morts, des émeutes pour l'abolir, du moins en théorie... Le racisme n'a pas dit son dernier mot, au moment où j'écris ces mots. Aux USA ( ailleurs aussi ) mieux vaut être blanc, riche et en bonne santé que noir, pauvre et malade. La musique s'inscrit en accordéon dans ses contradictions, parfois elle est la bande-son du black power, de la révolution qui vient, et parfois elle sert de chloroforme, le verre d'alcool qui vous requinque, le shoot d'héroïne qui vous calme... Marc Fanelli-Isla ne parvient pas à délimiter une frontière style face lente je m'endors, face rapide je me révolte. Dans le jazz, le be-bop se prête mieux à une telle dichotomie, mais l'instant d'après tout se brouille...
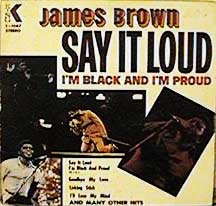
La solution est ailleurs. Avec James Brown, Say loud, I'm black and proud, certes la violence revendicatrice du funk, mais peut-être beaucoup plus dans le tenace effort de Mister Dynamite à devenir le maître de sa propre production, enregistrer ce qu'il veut comme il veut... En attendant la Motown vous pond des hits à gogo, de la belle musique qui caresse les chats de toutes les couleurs dans le sens du poil. Couvera en son sein Mickaël Jackson. Ce n'est pas qu'il soit un bon ou un mauvais chanteur qui compte, l'est le premier artiste noir hégémonique. Fait l'unanimité et chez les noirs et chez les blancs. Number one at the top. Ouvre la voie à Obama.
L'est le cheval de Troie introduit non pas dans les goûts du public mais dans le showbizz. Au coeur des maisons de disques. Les noirs trusteront désormais les postes de direction. Managers, producteurs, compositeurs, directeurs des labels... la force du R&B réside en cette prise de pouvoir. Sont aux manettes. Un plus, pour les brothers et les sisters.

Ils ont gagné. Oui. Mais attention aux retombées. L'argent, les dollars, sont des reptiles fascinants au venin incapacitant. Le R&B s'endort sous les violons et les recettes faciles. Le réveil viendra de la rue, des quartiers, du hip-hop, du rap, qui booste et qui bouscule. Pour un temps. Car si le R&B y gagne en couleur, le rap colérique perd les siennes. N'est plus un dégueulis de haine qui tombe sur l'auditeur comme un seau d'acide, rentre dans le rang, couplet, refrain, couplet, refrain, parle encore fort mais chante beaucoup plus...
Méfiez-vous généralisations hâtives. La musique noire est aussi l'apanage des blancs. Héros du rock'n'roll, Presley est un amateur de musique noire, ne se contente pas d'adapter, ou plutôt d'adopter, That's All Right Mama, enregistre plusieurs albums de gospel ( espèce de retour à l'envoyeur ) comme How Great Thou Art en 1967 et en 1969 sort From Elvis In Memphis qui jette les bases de ce que l'on pourrait nommer the white soul. Domaine des noirs, le R&B s'ouvrira aussi aux chanteurs d'origine blanche, George Michael avec ses quatre-vingt millions de disques vendus étant le parangon parfait de ce cross-over à rebours.

La dernière partie du livre est consacré à l'émergence, puis au triomphe, du New Jack Swing, cet instant magique où Teddy Riley réalise le grand mix : rap, funk, gospel, rhythm and blues, jazz, hip-hop, musique classique. La grande fusion. Expérimentation tous azimuts. Libération suprématiste. La musique noire explose tell un feu d'artifice.
Le New Jack Swing possède la force de frappe d'un sous-marin porteur d'ogives atomiques, mais son principal défaut réside en sa structure dépourvue de parois étanches intérieures. Les recettes des nouvelles cuisines appliquées systématiquement risquent de virer à la plus infecte des tambouilles. La New Jack Thing qui apparaît à la mid-eighties comme une forme révolutionnaire de la musique noire a perdu au fil des années de sa virulence. L'industrie musicale vous l'a liophilisée en produit diluable de grande consommation... Fanelli-Isla présente quelques uns de ses créateurs : Guy, Bobby Brown, AI B. Sure, The Boyz, Johnny Kemp... Le courant se durcit quelque peu avec l'apparition du Heavy R&B qui apporte une emprise rap ( peut-être davantage au niveau attitude, revendication et mode vestimentaire )plus appuyée à la Notorius B. I. G. 2 Pac, Jodeci, Blackstreet, DeVante, sont les figures de proue de ce mouvement qui va s'effilochant quelque peu... L'apparition de la Nu-soul, retour à la soul des années soixante-dix jouée avec des instruments traditionnels et affranchie des boîtes à rythmes et autres outillages électro est-elle un relent de passéisme ou la marque d'une reprise en main doctrinale ? L'est difficile de savoir qui est qui. Dans une portée de chatons noirs collés en vrac au ventre de la mère, pas évident de saisir les limites de chaque individu entremêlé à ses frères et soeurs. Fanelli-Isla reste très discret. Fait comme s'il avait oublié les questions à l'origine de ses recherches. Le R&B est-il un simple artefact de musique sans alcool mais qui mousse beaucoup à consommer sans modération pour le plus grand bien des actionnaires des maisons de disques ? L'on s'arrache les chanteurs à coups de millions de dollars. Le mercato R&B n'a rien à envier aux surenchères des clubs de sport. Notre auteur évite le dilemme entre le choux gras de l'investissement capitaliste et la chèvre maigre de la révolte artistique. S'en sort par le haut. Proclame le résultat : la musique noire domine la musique populaire mondiale. Belle revanche pour ces descendants d'esclaves qui ont réussi grâce à leurs talents à s'emparer de tout un segment culturel.
Vous rangerez ce livre – exactement le même format – dans votre bibliothèque à côté des deux volumes de Jean Christophe Bertin, Les Racines de la Musique Noire Américaine ( Gospel, Blues, jazz ) et Rhythm & Blues, Country, Rock & Roll, La Musique qui vit grandir Elvis, l'en est la suite. A ceci près que Marc Fanelli-Isla ne possède pas le même recul, pédale dans la choucroute le nez dans le caca, mais sa tentative de classification et de réflexion est des plus méritoires. Et puis surtout ces prolégomènes interrogatifs initiaux sont les mêmes qui se posent à tout amateur de rock and roll. Est-il une musique d'enternainement ou de démarcation ? Et dans la série des questions qui fâchent et divisent, quid de ses implantations politiques et existentielles ? C'est bien connu, l'amour rend aveugle. Je préfère la déclaration de Jim Morrison qui se définissait comme un politicien érotique. Nous arrêterons là. Pour cette fois.
Damie Chad.
21:06 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.