22/06/2016
KR'TNT ! ¤ 287 : ROLCALLBLOG / FAT WHITE FAMILY / JACKETS / DEATH IN KITTY / LE HAVRE CITE ROCK / ROADRUNNERS / HUBERT SELBY Jr / AMERICA
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 287
A ROCKLIT PRODUCTION
23 / 06 / 2016
|
ROCKCALLBLOG / FAT WHITE FAMILY / JACKETS DEATH IN KITTY / LE HAVRE CITE ROCK / ROADRUNNERS HUBERT SELBY JUNIOR / AMERICA |

APPEL ROLLCALLBLOG
Nous relayons ici l'appel à l'aide de Rolcallblog. Blogspot.com. Nous espérons que nos lecteurs sauront se mobiliser. Rappelons que le blog d'Alain Mallaret, consacré au rock and roll, au country et au blues était une source de documentation ( photos, archives, actualités, films, chroniques, concerts, disques, revues, liens avec d'autres blogs pharamineux, etc... ) inégalée en ce bas-monde. Une véritable somme culturelle. Le nombre de consultations provenant des USA m'a toujours étonné. A croire que chez eux ils n'ont point d'équivalent.
Réfléchissons aussi à la fragilité des supports offerts par internet. Nous permettent une large diffusion à moindre coût, mais sont d'une volatilité extrême. N'importe qui ( ennemis personnels, hypocondriaques divers, services secrets et étatiques ) peut s'en emparer et les détruire. Gardons des doubles. N'oublions jamais que nos stratégies de communication sont mortelles et facilement destructibles.
Bonjour,
Face au vol de son adresse gmail et à l'éradication sauvage du blog "Roll Call", Google ne propose à Alain Mallaret qu'une solution et un unique interlocuteur : un service robotisé !!!! (*) qui délivre une série de questions imposées qui appellent des réponses balisées genre QCM. Cette méthode est sensée le faire reconnaître comme authentique gestionnaire du blog. Chaque réponse est suivie à chaque fois d'un nouveau questionnaire identique en tous points au précédent et force est de constater que le système tourne en rond. Toujours pas de "Roll Call".
Alain nous propose d'envoyer tous à Google un courrier en s'inspirant de mon texte ci-dessous. Une lettre en français à destination du siège parisien et, pour appuyer la requête, le même courrier en anglais (traduit par Google traduction si nécessaire !) auprès de la maison mère en Californie (adresses ci-dessous).
Ce courriel pourrait peut-être débloquer une situation ubuesque et est probablement l'ultime possibilité pour que "Roll Call" réapparaisse. 8 ans de travail et des milliers d'informations/documents nous ont été confisqués sans avertissement et sans considération. Vous pouvez écrire ou ne pas le faire mais sachez que ces blogs peuvent disparaîtres du jour au lendemain sans avertissement sur simple décision de Google. N' hésitez pas a relayer cette info sur vos pages Facebook, blogs, correspondants.
Grand merci d'avance.
Alain.
Voici un modèle de courrier qui peut être expédié pour essayer de sauver les meubles :
Le but de cette lettre est d'essayer d'attester que Monsieur Alain Mallaret, est le véritable propriétaire d'une adresse courriel alanfortyseven@gmail.com, qui lui a été volée, ainsi que son mot de passe et son carnet d'adresses, début mai 2016.
À la suite de ce vol pour lequel il a déposé plainte auprès de la gendarmerie, nous avons vu son blog rollcallblogspot.com supprimé sans aucune explication, de même la dizaine d'autres blogs qui en dépendent, ainsi que toutes les photos stockées chez Picasa.
J'adresse ce même jour cette lettre à l'agence française et sa traduction en anglais à votre maison mère aux États-Unis.
Plusieurs autres courriers de contributeurs et visiteurs de ce blog, tous très déçus, voire en colère, de le savoir supprimé devraient vous être adressés. Alain Mallaret a passé 8 années à le gérer bénévolement, sans aucune aide financière ni support publicitaire, sans aucun but commercial avec pour seul but de partager des informations, sur un seul et unique sujet, la musique d'essence américaine qui plus est! Nous considérons être propriétaires de ce blog qui vous a été confié et vous demandons de nous le restituer.
Dans l'espoir que ce courrier soit pris en considération avec l'attention particulière qu'il mérite, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueux sentiments.
———
Google, 8 Rue de Londres, 75009 Paris
———
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis
LE 106 / ROUEN ( 76 ) / 20 – 05 - 2016
FAT WHITE FAMILY
FAT WHITE FAMILY STONE

Alors ? Arnaque ou bon buzz ? On les présentait à une époque comme les nouveaux Fall. On apprend à se méfier des buzz. Souvent, les gens racontent n’importe quoi pour se rendre intéressants. Un bon exemple de buzz : le buzz autour de Razorlight dans la presse anglaise il y a dix ans suivi d’un concert tragique au Nouveau Casino.
Il existe deux moyens de tirer une telle affaire au clair : écouter les disques et voir le groupe sur scène. Si on commence par les disques, le problème est vite réglé.

Leur premier album s’appelle «Champagne Holocaust». Une homme à tête de porc orne la pochette. Il brandit une faucille et un marteau. Les Fat White Family seraient donc les nouveaux Clash ? On se marre à l’avance. Déjà que les Clash frôlaient le ridicule avec leur pseudo engagement politique... On glisse le disque dans le lecteur et on coiffe précautionneusement le casque. Commencent alors à défiler des cuts tous plus insipides les uns que les autres. Il faut attendre «Wild American Prairie» pour trouver un peu de viande. En effet, ça sonne comme the Fall. Mais les autres morceaux semblent complètement dépareillés. Ces mecs n’ont pas de son bien défini. Ils travaillent semble-t-il sur la diversité, à l’image de la vie. Ils se veulent résolument inclassables. Pas question pour eux d’aller s’enfermer dans une petite boîte. Leur bordel ambiant est leur façon d’affirmer une certaine forme de liberté. On trouve un deuxième disque dans la pochette. Ils attaquent avec un «Wet Hot Beef» joué à l’hypno d’une grosse basse métallique. Clin d’œil à Can. La seule vraie chanson digne de ce nom qu’on trouvera sur ce disque s’appelle «Bomb Disneyland». Attention à l’extraordinaire attaque ! Ils finissent en piqué. Ces mecs veulent juste montrer qu’ils sont capables d’exploser. Mais oui, ils explosent ! Ils sortent là un vrai beat de destruction massive.

Leur deuxième album s’appelle «Songs For Mothers». La pochette se moque de celle d’un album des Black Keys, «Brothers». Ils attaquent par une espèce de pop intéressante, «Whitest Boy On The Beach». Mais cette pop ne sert à rien, puisqu’elle ne se raccroche à rien. Ils prennent un malin plaisir à s’éloigner de tout. Ils se veulent comiques et peu concernés par les chapelles. «Satisfied» se retrouve monté sur un beat envoûté qui s’envoûte de lui-même. Ils recherchent un son, avec un chant en retrait. On soupçonne une volonté hypno, mais au fond on ne sait pas. «Duce» ressemble à une chanson païenne de l’ancien temps, oui, c’est une immanence de l’antiquité, profondément baroque et insondable. Voilà encore un son étrange et météorique, pesant et monté sur un beat absolument inconnu au bataillon. Avec «Hits Hits Hits», ils inventent un nouveau genre : le groove ramollo, le groove de broc, avec des guitares de Tahiti et de la vieille boîte à rythme. Ils brouillent un peu les pistes. Aucun accès n’est possible. La scène anglaise se tire une balle dans la bouche. Retour à du Kraftwerk à la con avec «Tinfoil Deathstar». Ils lancent ça dans la nuit, et ça vire hypno, on ne sait pas pourquoi. Voilà enfin un groupe qui ne sert à rien.

Si on cède à la curiosité, c’est d’abord parce qu’elle fait partie des vilains défauts, comme la tentation à laquelle Oscar Wilde nous conseillait de céder. Et pouf, retour au 106 pour un concert des Fat White Family. Avant le concert, on les voit circuler dans le grand hall, avec leurs dégaines de branleurs des faubourgs. Le chanteur déambule, accompagné de son roadie punk. Il appartient à cette nouvelle génération de groupes anglais qui se foutent éperdument du look et des fringues, des coupes de cheveux et des mythes. Ce mec est assez laid, il parle fort, il ne se peigne pas et son profil d’aigle renvoie un peu à celui d’un Jazz Coleman mâtiné de Dupontel, mais en mille fois plus ingrat. Son allure entretient merveilleusement bien les mauvais a-prioris.

On retrouve la tête de cochon, la faucille et le marteau du premier album sur le rideau de scène. Le groupe se fait longuement attendre. Idéal pour le public français ronchon qui adore protester. On se dit : tant mieux, ils ne vont jamais venir. Le groupe s’est en effet spécialisé dans les coups de Jarnac et soigne sa réputation d’incontrôlabilité. Il faut même s’attendre à prendre des coups si on est au premier rang. Ils débarquent enfin sur scène.

Il y a eu du changement de personnel. Un petit japonais joue de la basse. Le guitariste a l’air complètement défoncé. Ce mec qui doit peser vingt-cinq kilos habillé porte des fringues trop petites. Il n’y a que les Anglais qui osent monter comme ça sur scène, avec un feu de plancher de dix centimètres. Il passe un temps infini à essayer de régler sa guitare et à réclamer du son à la technique d’une voix incroyablement décadente. Mais c’est le petit Japonais qui envoie la sauce avec un drive de basse terrible.

Ils démarrent avec ce cut hypno qui passe si mal sur le disque, «Tinfoil Deathstar» et soudain, ça prend des proportions extravagantes, car le groupe sature la salle de son. Ça frise même la démesure et ce chanteur qu’on regardait un peu de travers prend des allures de bête de scène. Il s’appelle Lias Saudi. Le son qu’ils sortent sur scène n’a absolument rien à voir avec leurs deux disques foireux. Voilà l’explication du buzz : l’incroyable présence scénique. De cut en cut, ils font monter la pression. Le chanteur siffle des grandes 8 de bière et se retrouve rapidement torse nu.

La comparaison avec Jazz Coleman prend soudain tout son sens. Ce mec est franchement spectaculaire, il peut screamer comme un démon et les autres n’en finissent plus de soutenir le meilleur beat d’Angleterre. Le set tourne à la bonne surprise, et c’est même une révélation. Ce qu’ils jouent n’est pas franchement du rock anglais à guitares, mais du rock atmosphérique extrêmement bien foutu et souvent hypnotique. Des cuts comme «Whitest Boy On The Beach» et «Raining In Yer Mouth» passent comme des lettres à la poste. Lorsque le guitariste Saul Adamczewski refait un peu surface, il se met à intervenir de manière fulgurante. Il calme le jeu pour préparer la tempête de «Satisfy» - I’m so easy to satisfy - et le set atteint des proportions gargantuesques.

Ils ne font pas les choses à moitié. Lias Saudi se fond dans le carnage sonique comme le faisaient avant lui tous les géants de la scène, Iggy, Lux, il chante à la tripe et dégouline se sueur, il siffle ses 8 et balance ses boîtes dans le public. Il n’en finit plus de screamer et d’alimenter la démesure. On sent qu’il va finir à poil, mais non, ils abrègent le set et quittent la scène. Pas de rappel.
Signé : Cazengler, fat white finally
Fat White Family. Le 106. Rouen (76). 20 mai 2016
Fat White Family. Champagne Holocaust. Trashmouth Records 2013
Fat White Family. Songs For Your Mothers. Without Consent 2016
*
BOURGES / 07 – 05 - 2016
WILD AND CRAZY COSMIC TRIP FESTIVAL
THE JACKETS
LA QUÊTE DES JACKETS
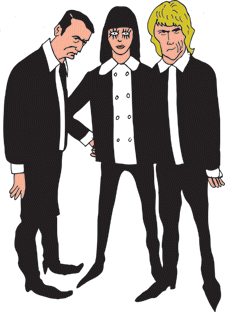
Jackie et ses Jackets devraient bientôt atteindre les sommets de la gloire underground. Trois ans après leur premier raid au Cosmic trip, le trio suisse revient secouer les puces de Bourges.

Ça se passe dans la Jungle Room, tant mieux, plus petite salle, son plus ramassé. On les retrouve tous les trois, bien rassemblés autour du drumbeater lanceur de cuts Chris Rosales, Américain expatrié en Suisse, qui fut un temps le batteur du bon Reverend Beat Man. Ça part en garage blast, avec une Jackie en forme. Incroyablement légère et vivace, elle danse en grattant sa petite guitare jaune. Elle ne porte que du noir et des grandes lunettes noires, elle passe ses accords avec une classe insolente et l’ami Samuel monte au créneau pour les chœurs. Ah quelle équipe ! C’est un régal pour l’amateur de garage. Lorsqu’elle retire ses lunettes noires, on découvre son maquillage Alice Cooper, elle en joue, fixe des gens dans le public entassé au pied de la petite scène.

Le trio joue un petit garage féroce, bien en place, ils incarnent l’avenir du genre, ils soignent bien leur virulence et ne laissent pas la température baisser d’un seul degré. C’est claqué du beignet, rondement mené, sans frime, sans filler, ça baigne dans le pur jus. Jackie monte parfois sa voix comme une sorte de Siouxie éperdue mais elle met tellement de jus dans son blast qu’elle balaie tous les soupçons. On attend le moment fatidique : elle tombe enfin sur le dos et passe un solo les pattes en l’air.

Pur garage sauvage ! Magnifico ! Elle met la petite salle en transe. Le public adore ça. Les Jackets ont tout bon. Ils savent rester classiques, mais avec une certaine fulgurance.

Ils s’appuient désormais sur un beau parcours discographique. Leur troisième album vient de sortir sur le beau label du Reverend Beat-Man, Voodoo Rhythm. Bien beau rond noir que ce «Shadows Od Sound». Dès «Don’t Turn Yourself In», on voit que Jackie chante à l’insidieuse. Elle remplit bien son garage de sale petite fuzz, aussi râpeuse qu’un mur de briques à Manchester. Rien de tel pour redorer le vieux blason du garage. Question son, elle est comme Thee Headcoatees voici vingt ans, elle a tout compris. Il faut appuyer sur le bouton d’acné pour faire gicler le pus. C’est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. On retrouve sa belle dynamique fuzzy dans «At The Go Go». Elle dessine une belle dimension garagiste et ses élans moites se frottent aux résurgences. Admirable de perversité. Encore une belle pièce encrassée de fuzz avec «Keep Yourself Alive», mais elle chante parfois d’une voix un peu trop docte, à l’Allemande, pourrait-on dire, une voix de timbre froid un peu hautain, même si la pure jute de fuzz lui coule malicieusement entre les doigts. En B, ça chauffe avec des trucs comme «Wheels Of Time», un jerk qu’elle monte en épingle. On rêve de la revoir en chair en os se rouler par terre pour prendre un solo. Elle trouve enfin sa voix sans «You Better», elle y va cette fois au feeling et paf, on prend une giclée de fuzz dans l’œil, c’est toujours ce qui arrive quand on s’occupe de ce qui ne nous regarde pas. Elle mène son bal de la dérive, fait des brrrrr et part en vrille, mais de manière splendide. C’est avec une certaine fermeté qu’elle dit à un mec «Hands Off Me», sur un mid tempo bardé d’avantages. Elle sait placer un solo, la garce. Elle termine avec l’excellent morceau titre et chante avec de faux airs de Grace Slick, ou de qui on voudra, après tout on s’en fout, seule compte sa présence scénique car elle finit toujours par imposer sa loi d’airain (et non des reins, comme on serait tenté de l’insinuer).

L’album précédent s’appelait «Way Out» et on y trouvait quelques belles énormités fumantes, comme par exemple «Freak Out». Elle tire ça à bout de bras, car c’est du garage gros popotin, bien lesté de basse. Jackie screame plutôt bien et elle semble à l’aise dans le gros boogaloo - freak out is the only way out - S’ensuivent quelques cuts très moyens qui font douter les pèlerins et puis soudain, la machine semble se remettre en route avec «You Said». On y sent bien la partence de la véhémence et l’exégèse de la paragenèse. Oui, car voilà un bel entraînement de garage fuzz digne des meilleurs jukes du lac Léman. Même chose avec «Hang Up» qui est roulé dans la farine d’un gros riff de fuzz. C’est exactement le même principe que l’«I Can Only Give You Everything» des Them, c’est la fuzz qui commande, bien crade et bien lancinante. En B, on tombe sur un «In My Mind» bien sautillé à l’accord et tapé au petit riff insistant. Mais ce qui fait le charme du cut, c’est le petit filet de bave fuzz qui coule et qui sert de solo. Fameux ! Ils semblent rendre hommage aux Seeds avec «Oh Baby» car on y entend les petits accords légers bien connus des Seedomaniaques. Tiens, encore un perle avec «Falling Girl», fantastiquement balancé aux couplets de chœurs d’artiche. Voilà encore un cut incroyablement bien senti. Elle s’entend bien avec son équipe. Le dernier cut vaut largement le détour. Dans «Last Chance», elle fait sa folle, sa fauve, sa reine du garage et ça s’emballe pour de vrai. On a là un gros classique chanté à la liberté de ton et elle finit à la clé d’apothéose, sous le soleil d’un Satan qui n’est pas JC Satan.

Il se pourrait bien que leur premier album, «Stuck Inside» soit le meilleur des trois. Jackie y tape une solide reprise du mythique «Demolition Girl» des Saints. Elle jette tout son dévolu dans la balance, elle fait montre d’un sacré courage, car elle tape vraiment dans l’intapable - That’s what I say ! - On trouve sur ce disque trois beaux classiques garage, à commencer par «Get Back With You», impérieux, joué dans le riffing traditionnel avec des chœurs masculins bien sentis. On reste dans le garage d’accords baveux de sang et de larmes avec «Traitor». C’est là que naît leur extraordinaire santé de balistique cabalistique, cette fantastique exhalaison riffique qui va les caractériser. Jackie prend un solo en franc-tireur et elle remonte à la note de gamme pour créer la lueur d’incendie. Les Jackets sont déjà terriblement bons - I can’t stand it no more yeah yeah yeah - Et puis voilà «Escape», bardé d’accords exponentiels. Jackie entre à la fine fleur d’excellence, elle cherche le Graal du gras et transforme le riff en or comme un Pic de la Mirandole des temps modernes. Quel sens du solide et de la transmute ! Elle explose le garage c’mon avec des brrrr de lippe ! fab fab fabulous ! D’autres cuts titillent bien l’oreille, comme par exemple «Running», gratté à l’os, raw to the bone, belle passade de ryhtmalama et de yeah yeah yeah, c’est nerveux, excitant, ah la bourrique, elle sait partir en solo garage éclair, exactement comme Wild Billy Childish, c’est fin, viandu, tapé derrière par l’infernal Chris Rosales - Get outta my way ! - Elle est dessus et maintient une tension vocale impressionnante. Elle enchaîne ça avec un «Got NoTime» digne des Standells, oui, car ces sont les accords de «Good Guys Don’t Wear White». Encore une merveille avec «Out Of My Head» et sa violence déterminée. Elle travaille à l’escarmouche et c’est battu à la soudarde, sans pitié. Voilà bien un cut guerroyé à l’axe et gratté mauvais.
Signé : Cazengler, jacquête spirituelle
Jackets. Wild And Crazy Cosmic Trip Festival. Bourges. 7 mai 2016
Jackets. Stuck Inside. Subversiv Records 2009
Jackets. Way Out. Sound Flat Records 2012
Jackets. Shadows Of Sound. Voodoo Rhythm Records 2015
DEATH IN KITTY

Vous avez de la chance, sur KR'TNT l'on parle de tous, même de ceux que l'on ne connaît pas. Mais le bouche à oreille fait mouche. Un coup de téléphone venant d'Embrun – non, ce n'est pas situé au bord de la mer mais au pied des Alpes - de ma fille : « J'ai vu Death in Kitty, je ne suis arrivée que pour les trois derniers morceaux, fais-leur un article, ils le méritent. »
Trois filles et un garçon. Un peu le good boy kidnappé par un gang de bad girls, mais l'a l'air de se débrouiller pour survivre. Du moins aux dernières nouvelles, il n'était pas encore mort. Deux lycéennes, Petri Rawn ( guitare ), Fannity Pie – or Dash – à la basse, depuis 2014, plus tard rejointes par Princess Eboueuse au micro et El Bourissimo, drummer. Vous avez douze minutes de leur premier concert sur You Tube, à Guillester, au Central. Du métal, manque un peu d'amplification sonore, les morceaux sont un peu trop construits sur un même schéma – car attention les Death In Kitty ont cet avantage de composer – mais l'ensemble tient la route et vous n'avez pas envie de vous arrêter en chemin. Des guitares et une voix mélodique - ce qui ne signifie pas rose bonbon mélodieuse - mais qui de temps en temps sait growler comme un pitbull à qui vous essayez de reprendre votre main malencontreusement égarée entre ses mâchoires. Vous trouvez aussi des enregistrements studios, un Bless You qui vous fait du bien, un Go To Sleep bien en place et mon préféré Second Flowering en acoustique auquel vous n'aurez rien à reprocher. Princess Eboueuse se lance dans une jolie performance. Je ne sais pourquoi, elle m'a rappelé certains vocaux de Joni Mitchell – connaît-elle seulement ? - cette manière de prendre sa respiration entre les mots pour leur donner plus de force.
Définissent leur style dans une trop rapide interview en direct sur DICI TV comme du glam-metal. Z'ont été parmi les gagnants des Laureats Class Rock – région PACA – 2016. Que dire de plus ? Que Fannity Pie semble un peu obnubilée par les guitares ce qui prouve que cette jeune fille est une passionnée. Or le rock sans passion c'est comme un verre sans bourbon. En plus, parfois elle porte un haut-de-forme, un look qui vous Slashe menu. Death In Kitty : méfiez-vous des petits chats qui se font les griffes dans vos yeux. En grandissant ils deviennent des tigres altérés de rock.

Promis, l'on gardera un oeil sur eux.
Damie Chad.
( Photo : Paul Gertz )
LE HAVRE CITE ROCK
NEVER CRY FOR THE PAST
( Doc télé : Diffusé le Lundi 13 / 06 / 2016
à 23 H 40 sur FR3 )

Je regarde rarement la télé. Pour une bonne raison. Je n'en ai point. J'ai fait une exception, non je n'ai pas acheté un poste, me suis aperçu qu'ils diffusaient le reportage Le Havre – Cité Rock en streamin' pour cinq jours. Un peu maigre quand on sait que France-Culture met à disposition ces émissions en broadcast pour 1000 jours. Pas tout à fait les Mille et une Nuits, mais presque. Bref cinquante deux minutes ( c'est le format ) consacré aux glorieuses années rock du Havre.

Merveilleux et frustrant. Merveilleux pour tout ce que l'on entend, nombreux extraits de groupes live, en pleine action, ça ruisselle de guitares, de fougues et de foudre. Frustrant parce qu'au bout de trente secondes l'on passe à autre chose. Ne vous tirez pas une balle dans la tête de désespoir, en cherchant sur le net vous retrouverez pas mal de pépites in-extenso. C'est construit sur le modèle de la cuisine chinoise qui mélange les douceurs du palais et les aigreurs de l'estomac. Une face qu'ils étaient beaux et vindicatifs quand ils étaient jeunes, et le revers de la médaille, les cendres après la braise, les survivants qui racontent, qui font le point. Sagesse, amertume, regrets and no regrets, orgueil.
Plantons le décor. Des ruines. Le Havre, rasé par les bombardements alliés durant la guerre. Une cité au passé aboli, qui connaîtra les dividendes et les affres de la reconstruction. Renaissance et recherche d'une identité. Des usines, et des installations portuaires qui nécessitent une forte population ouvrière. Français de souche et prolos étrangers. Cas emblématique Little Bob ( l'est déjà petit mais pas encore Bob le grand ) dont le père est venu d'Italie chercher du boulot. Un monde dur, violent, fier, qui vous burine davantage le caractère que les écumes salées de la Manche. Au début des années soixante-dix, la jeunesse locale possède encore un avenir. L'usine. Ses éléments les plus conscients n'en profitent guère. Les inconscients, quand on pense que l'absence de futur s'inscrira dès le milieu de la décennie en lettres de menace sur le fronton des pochettes punk. Sont focalisés par autre chose : innommable. Un produit d'importation hautement toxique : le rock and roll.
Le Havre n'est pas Paris. Pas question de suivre ces groupes parisiens de la nouvelle vague qui au début des eighties se compromettent dans un rock moderne insipide qui flirte avec la pop-musack. Au Havre, l'on est résolument rock. L'on a des modèles, les Stooges et Iggy Pop, MC 5 et consorts, l'on est au diapason de la vague renouveau rhythm and blues / rock and roll du pub rock britannique, des vieilles et bonnes médicamentations de Dr Feelgood. Guitares en avant, électricité crépitante, batteries à fond de train et chanteur qui mouille le perfecto. Une formule infaillible. Le secret – connu comme le loup blanc – du rock and roll. Mais c'est comme le saut à l'élastique. N'importe qui comprend le principe, mais peu de monde se presse au portillon pour se jeter du haut de la Tour de Montparnasse.

Mais au Havre, va y avoir un monde fou pour le saut de l'ange. Little Bob Story – un peu l'arbre géant qui cache les autres séquoias, les Bad Brains, les Croaks, les Dirty Kids, les Roadrunners, les Fixed up... pas du tout des seconds couteaux. Des groupes qui possèdent un public, qui peuvent se prévaloir d'avoir donné entre six cents et quinze cents concerts, en France, en Angleterre, en Europe et jusqu'aux Etats Unis et en Australie. Une épopée oublié aujourd'hui, et inscrite dans la colonne pertes et profits par les médias français. Une véritable conjuration du silence. Et pourtant ils faisaient un bruit pas possible. Inutile de réveiller le monstre d'une jeunesse française turbulente dans les seventies mais assagie et presque endormie par la suite.
Faut être juste. C'est de leur faute. Z'ont fait le buzz mais n'ont pas su accepter les compromissions nécessaires : s'obstinent à chanter dans cet idiome incompréhensible qu'est l'anglais, ne sont pas du genre à arrondir les angles, ont l'outrecuidance d'imposer leur répertoire quand on leur offre un passage télé... Qu'ils restent dans leur village gaulois d'arriérés. C'est-là où ils se trouvent le mieux. Pas envie de se perdre dans la capitale. Ces autonomes ont une âme d'autochtone. Préfèrent la camionnette pourrie et les galères qui roulent avec. S'en moquent. S'en foutent. Vivent une jeunesse merveilleuse. Une quinzaine d'années plus tard les séquelles de cette vie de soutiers du rock and roll se feront sentir. La fatigue engendre l'animosité, les combos implosent de l'intérieur. Et à l'opposé de soeur Anne sur la plus haute tour de leurs illusions, fatigués de ne rien voir venir, ils baissent la garde.
Ne les accablez pas. Les individus ne sont pas seuls en cause. La France entre dans la modernité libérale. L'ère de la dés-industrialisation commence ses méfaits. Le Havre licencie ses ouvriers. Les quartiers perdent leur fierté ouvrière, la lèpre d'une pauvreté insidieuse étend ses tentacules. Toute une jeunesse naïve ( pour ne pas dire stupide ) se précipite dans les filets de de cette société de services et de pressurisation des salaires en laquelle ils croient voir leur future émancipation...

N'empêche que les groupes du Havre ont écrit une des pages les plus glorieuses de l'histoire du rock français. C'est Little Bob qui tire la leçon de toutes ces années de grands débordements, nous chante la plaintive complainte de Never Cry For The Past. Rock And Roll attitude jusque sous les décombres.
Documentaire mais pas documenteur.
Damie Chad.
INSTANT TROUBLE
ROADRUNNERS
Boucherie Production / 1993
I'M WATCHIN' YOU / SATURATION POINT / CONTORTIONS / BAGS UNDER YOUR EYES / BULLDOG / EYE OF THE CYCLONE / BEAT AROUD THE BEACH / COUNT ME OUT / DON'T WAKE ME UP / LUCKY FIND / DON'T LOOK DOWN

Depuis quelque temps rôde sur le net – enfin pour ceux qui fréquentent les mauvais lieux - la photo d'une bande de patibulaires pistoleros mexicains méchamment armés. Ah oui ! Les Roadrunners, une sacrée réputation, faudra que j'écoute un jour. Mais vous savez les bonnes résolutions, ça s'envole comme les hirondelles à la première bise d'automne. Attendez je vous la refais, un peu moins poétique, un peu plus rock and roll : comme les vautours à la première puanteur de cadavre portée par les vents du désert et du désir. Mais après avoir visionné le docu Never Cry For The Past, l'envie s'est faite pressante. J'avais déjà mis de côté la bande son de leur avant-dernier album – z'en avaient tout de même aligné une demi-douzaine entre 1987 et 1995 – que j'avais piquée en toute impunité sur leur FB. Suis comme ça moi, me constitue des réserves de concentré de pemmican à haute dose de nitroglycérine en prévision des futures glaciations. Capitaine tout est paré ! C'est bon matelot. Première torpille babord, feu !
I'm watchin' You : Accrochez-vous au mur. Ca commence tout doux, vous filent en passant deux uppercuts sur le museau et c'est parti jusqu'au bout de l'enfer. Une voix qui appuie là où ça fait mal, et une guitare du diable qui souligne les vertèbres fêlées, zone calme détendez-vous mais méfiez-vous, peu de chance que ça dure. Qu'est-ce que je vous disais ? Surtout qu'ils ont un batteur expert en roulements.
Saturation Point : Pas de temps à perdre avec des intro romantiques l'on file tout de suite à quarante noeuds, pas de panique le vent et la mer vous poussent. Enlevé mais très musical tout de même.
Contortions : Un peu la même chose que le précédent. L'on adore ces instants où la voix se pose et où la batterie fait un break de brick pirate. Pas d'abordage tout de même. C'est dommage on aurait aimé un peu de sang. Méchamment au point. Morceau qui doit dézinguer sur scène.
Bags Under Your Eyes : ces gars-là sont pressés. Cris d'indiens autour du poteau de torture. Non c'était le final du morceau précédent. De toutes les façons ces sauvages ont changé d'avis, ont décidé de vous faire cuire à feu doux dans une grosse marmite de cannibale. Vous vous réveillez en sursaut, quel cauchemar pernicieux ! Arrêtez de vous balader dans les ballades. Ils sortent toujours des marécages, les Mescaléros. Portez des lunettes noires pour cacher vos cernes et vos incertitudes flageolantes. Poison à diffusion lente.
Eye of the cyclone : ouf ! on retrouve le bon beat fortune carrée qui écrase tout. L'on doit naviguer près des perfides falaises d'Albion, car ça sonne méchamment british. Ces hooliganss vous refilent toujours de la marchandise de qualité. Vous pouvez importer sans problème. Vous adouberont même de l'estampille de la reine ( fascist pig ) pour vous remercier.
Bulldog : Ne s'arrêtent plus, on dirait qu'ils font une course entre eux, à celui qui franchira le premier la ligne d''arrivée. Faut voir comment ils ne négocient pas les virages. Jamais dans les décors mais du corps à corps. L'on en profite pour admirer la couve, très beau carton Diddley.
Beat Around the Beach : Drum martial, promesse de guerre. Une dirsto de guitare à vous nouer les tripes en noeud de serpents. Les plages sont parfois dangereuses.
Count Me Out : On dirait que la batterie klaxonne et que derrière les guitares grondent. Chaque fois que la voix s'arrête vous avez droit à un pont instrufractal aussi douloureux qu'un passage en caisse quand vos amis se sont barrés en vous laissant l'addition à régler.
Don't Wake Me Up : Avec le boucan qu'ils font, ce n'est pas la peine de vouloir dormir. Vous avez plutôt envie d'entrer dans la farandole des riffs et de vous laisser emporter dans une sarabande méphistophélesque.
Lucky find : un peu de calme dans ce monde de brutes. Une petite ballade country appuyée d'harmonica, avec les anges qui volent autour de vous, cela n'a jamais fait de mal. Surtout à un agonisant à qui le cerveau compatissant envoie de belles images pour lui faciliter le passage de l'autre côté.
Don't Look Down : ce n'était qu'un rêve, un havre de paix illusoire. Tous en choeur au vocal et pas de fausses notes rien que de ces glissandis de guitare qui se fichent comme autant de piquants de porc-épic dans votre chair saignante.
Tiens un bonus sur la bande : I'm watchin You qui repasse avec une intro un plus guillerrette style sale gamin de huit ans qui vous tire la langue après vous avoir craché dessus. Un truc qui énerve. Je ne sais pas trop pourquoi.
Du bon. Font un peu penser au Flamin' Groovies deuxième manière. Et en même temps ont des attaques qu'un groupe de métal hardcore ne renierait pas. A fond, mais jamais destroy. Superbe cohésion. Si vous en voulez d'autres, tapez sur You Tube, toute une couvée de titres est gardée bien au chaud. Le groupe s'est arrêté lorsque le chanteur François Pandolfi a décidé de faire une carrière en solo, sous le nom de Frandol. Peut-être pas le bon choix, mais cela le regarde. France, terre des arts et marâtre du rock and roll.
Damie Chad.
LAST EXIT TO BROOKLYN
HUBERT SELBY Jr
( Livre de Poche 3624 / 1975 )

La honte ! Des années qu'il erre sur les étagères et jamais l'envie fulgurante de m'y jeter dedans. Plus d'un quart de siècle que les amis me disent qu'au lieu de reluquer l'oeuvre érotique de Pierre Louÿs pour la quatorzième fois je ferais mieux de lire mon Selby, l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature contemporaine, d'une force égale à Au-dessous du Volcan de Malcom Lowry qu'ils ajoutaient. Z'avez pas tort. L'ai dévoré d'une seule traite. Certes l'on y avale moins de téquila au paragraphe que le personnage du Consul ( en eaux troubles ) de l'auteur de Plus Sombre Que la Tombe Où Repose Mon Ami, mais je vous avertis l'ambiance est encore plus éruptive. Pas pour rien que la chaste et prude England lui ait intenté un procès en obscénité. L'on est toutefois déçu de ce que les Italiens pourtant renommés comme des chauds lapins l'ait carrément interdit de traduction. En France l'on a profité de Mai 68 pour le sortir. En plus pour ne pas faillir à notre réputation de Don Juan, nous en avons donné une deuxième traduction en 2014.
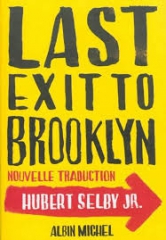
D'abord ce qui choque : le style. Normal pas de grand roman sans nouveau procédé d'écriture. Six chapitres, six blocs monolithiques qui forment une falaise abrupte. Escalade difficile. Pas de saillies où s'accrocher. Les dialogues dépourvus de toute ponctuation afférente sont mêlés au linéaire du récit. Point de belle phrases. Malgré l'opulence naturelle de la prose française, l'on ressent le génie incisif, et la concrétude quasi-monosyllabique et agglutinante de la langue vernaculaire américaine. Point de dispersion. A chaque situation sa charge sémantique et segmentique répétée autant de fois qu'elle se représente. Les mêmes mots, les mêmes expressions pour les mêmes gestes, les mêmes actions. Pour l'intrigue ne cherchez pas le résumé sur le net. Il n'y en a pas. Six parties indépendantes avec quelques personnages qui reviennent de temps en temps, mais vous pourriez les lire dans le désordre comme des nouvelles.
Si vous voulez un équivalent national, faut imaginer un mix de Céline qui allierait le tronçonnage des vocables de Rigodon avec le contenu de Mort à Crédit. Evidemment vous enlevez tous les points de suspension si chers à Ferdinand. A une différence près, le vécu américain n'a rien à voir avec le quotidien franchouillard. Changez d'échelle. En Amérique tout est plus grand. Même l'infiniment petit. Ce qui tombe bien puisque nous sommes chez les petits. Pas du tout chez nos petites gens, ces pauvres emplis de dignité.
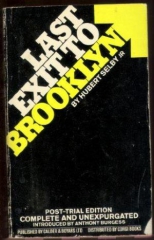
Marx parlerait de lumpen-prolétariat, et les chrétiens de gauche d'âmes égarées. Au dix-neuvième siècle l'on aurait dit la lie de la société. Mais Selby, lui il cause des gens de Brooklyn. Rien à voir avec les ambiances bourgeoisement calfeutrées de Gens de Dublin de Joyce. Sérigraphie des basses couches de Brooklyn dans les années cinquante. Le roman est paru aux USA en 1964. Une espèce de ces carottes géologiques et révélatrices que réalisent les prospecteurs de pétrole. A part que Selby, ce n'est pas de l'or noir qu'il recherche. Mais de la merde. L'en trouve beaucoup d'ailleurs. Quant à la carotte facile de savoir ce que vous allez en faire. Foutez-vous là dans le cul et n'emmerdez plus le monde.
Non, je ne suis pas grossier. N'ai rien trouvé de mieux comme introduction au sujet. Vous aligne la suite : culs, cons, bites, putes, pédés, sexe, money, violences, alcools, drogues, bagarres, meurtres, morts, survies. Ne vous inquiétez pas il y a pire : stupidité. Racisme. Les héros ne sont pas folichons : refusent de travailler, volent et vivent des allocations d'état, correspondent au portrait type du chômeur tracé par nos hommes de droite. Trompent leurs femmes. Trompent leurs mecs. Restent au lit, envoient l'épouse au turbin – et nos ligues de vertu féministes dussent-elles pousser des cris d'horreur – ils refusent de faire la vaisselle. Ne s'occupent pas des enfants. Ce qui n'est pas très grave puisque les mères agissent de même. Les fils ne valent pas mieux que les pères. Se tatanent dans les bacs à sable depuis qu'ils sont en âge de marcher et une fois adolescents rentrent dans les gangs pour le plaisir de jouer aux hooligans avec la bande de l'immeuble d'en face. C'est la police qui ramasse les corps étendus à terre. Boulot ingrat, z'ont des compensations, des lots de consolation, le droit et le devoir de matraquer avec une vigoureuse joie brutale les crânes des grévistes.
White trash people. Mais plus haut dans la hiérarchie sociale, chez les patrons d'usine et le staff des organisations syndicales, ce n'est pas plus brillant : manigances, hypocrisie, pouvoir. Chez Selby, l'homme est un requin pour l'homme. Ce qui le différencie des animaux c'est qu'il est incapable d'un minimum de tendresse et d'amour. Le semblable n'existe pas, uniquement des prédateurs. La loi du plus fort est rigoureuse : l'on ne s'attaque au plus faible que si l'on est en nombre suffisant : deux, trois, dix, vingt, trente... C'est ainsi que la vie devient vivable. Et la mort mortelle. Du cul, du con et de la bite. N'oublient pas la musique : prédilection pour le saxophone de Charlie Parker. Vous voyez bien que vous commencez à les apprécier, malgré leurs défauts. Ont des goûts de prince.
Un livre impitoyable. Le miroir dans lequel vous refusez de vous regarder. Pas de désir: des pulsions. Cerveau reptilien. Très rock and roll.
Damie Chad.
L'AMERIQUE DE MARK TWAIN
BERNARD DE VOTO
( Seghers / Coll : Vent d'Ouest / 1960 )
( Publié en 1932 aux USA )
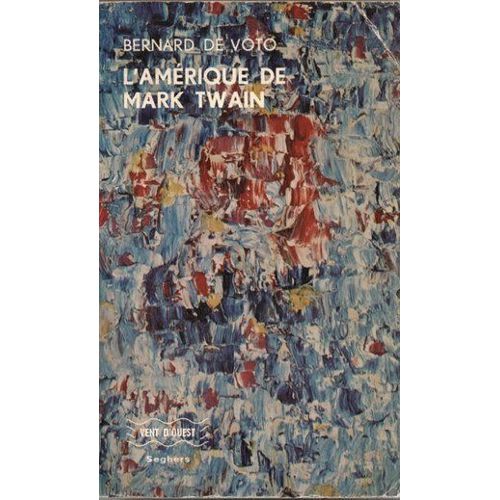
Parfois l'on commet des erreurs. Je farfouille chez Gérard, my favorite bouquiniste ( L'Ivre Livre – Foix 09 ). Kesaco ? De Voto ? N'ai jamais voté pour lui. Poche. Pas Cher. Je prends. Le lirai plus tard, quand je serai plus vieux. Et puis par un après-midi pluvieux, suis tombé dedans. J'aurais dû me méfier. Seghers – celui de l'ancien temps – c'est du sérieux. Plus tard je m'apercevrai qu'ils avaient toute une collection sur l'histoire de l'Amérique aux titres attirants. Idem pour ce parfait inconnu de De Voto. L'est né en 1897 et décédé en 1955. Lorsque l'on pense que Robert Johnson naquit en 1911 et Elvis the Evil en 1935, l'on se dit que ce gars-là l'était proche des débuts. Historien réputé de l'histoire des origines de l'Amérique, spécialiste de Mark Twain et du Far-West. Haut-le-corps en ouvrant le bouquin, quatre cents pages composées en caractères si petits qu'ils nécessitent l'achat d'un télescope interplanétaire. J'ai failli le refermer, c'était trop tard, happé par un tourbillon fabuleux, saisi au collet par la tumultueuse apparition d'un monde disparu, celui des pionniers, celui de la frontière, celui de la grouillante gestation des Etats-Unis.
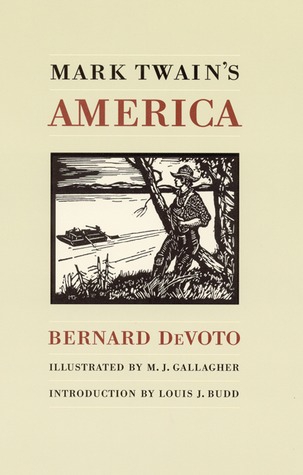
Drôle de manière d'écrire une biographie. En l'occurrence celle de Mark Twain. Le personnage principal n'apparaît que rarement. Le héros du livre ce n'est pas Mark Twain, mais l'Amérique. Un peu comme si l'on dressait votre portrait en racontant la France d'aujourd'hui : ses richesses vendues aux multinationales, ses élites corrompues et ses manifestations attaquées par la police... Pas sûr que vous vous y retrouveriez. Z'avez intérêt à ce que votre existence soit le reflet de tout cela, sinon votre égotiste unicité risque de passer à l'as. De pique, comme dirait Mötorhead.
Mark Twain entre en scène vraiment au huitième chapitre. N'en parle pas avant, l'évoque en creux. Ce qui compte ce n'est pas le gamin qui vit à Hannibal, c'est ce qui lui saute aux yeux, la nature, la forêt et les gens qui crèchent dans le même village, et puis le fleuve. Le Missouri. Entre 1835 et 1845, va en passer du monde. Nous sommes dans ces territoires mouvants qui jouxtent la frontière. Sam Clemens s'en met plein les yeux. Et de Voto plein les pages. Nous décrit le fourmillement des passants. Les chasseurs, les trappeurs, les aventuriers, les mormons, les illuminés, les pisteurs, les anglais, les marins, les esclaves, les voleurs d'esclaves, les pirates, les charriots... Et même ceux qui s'arrêtent en si bon chemin. Les perdants, les épuisés, qui n'ont plus d'énergie, plus rien, on les appelle les squatters, se fixent sur des bouts de terre improductifs que personne ne revendique. Deviendront les nids à misère, les oeufs cassés, les laissés pour compte du déploiement capitalistique en développement exponentiel dans les décennies suivantes. Ceux-là exceptés c'est défilé incessant. Une interminable file de chenilles processionnaires. Ne les lâche pas d'une semelle. Nous les suivons pas à pas, au travers des forêts, sur les pentes des montagnes qui remontent vers le Canada, jusqu'en Californie, au travers des territoires indiens. A vingt ans Sam Clemens ne résistera pas à la tentation, devient ouvrier typographe, pilote un vapeur sur le fleuve, puis journaliste, s'enrôle dans les rangers sudistes dès les débuts de la guerre de Sécession, pousse vers l'Ouest, épouse la cause nordiste qui correspond mieux à ses idées, s'improvise chercheur d'or, est nommé directeur de journal, et acquiert une célébrité locale de rédacteur d'articles à Virginia City dans le Nevada.
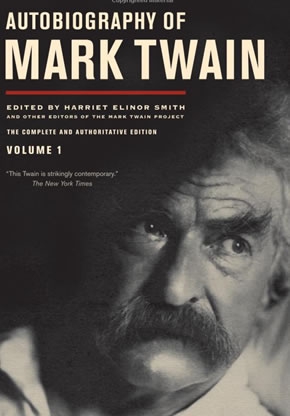
Son inspiration, il la tire de son vécu. Ne dites pas que votre vocation d'écrivain est ratée, que jamais le monde picaresque que Twain a eu sous les yeux ne frappera vos pupilles. Contentez-vous de visionner les westerns américains. Car ce que de Voto nous décrit vous le retrouvez facilement dans les films du genre, mais les plus gores, les plus violents, les plus sadiques. Pas de pitié. Pas de prisonnier. Les personnages mythiques de Davy Crockett à Kitt Carson et d'autres beaucoup moins fréquentables. Vous ne connaissez pas John A. Murrell ? Tant mieux cela prouve que vous êtes encore vivant. Un pirate de terre ferme et de navires dépouillés, commandant d'une troupe de plusieurs milliers de complices. L'était comme Attila, sous ses pas l'herbe des outlaws repoussait comme du chiendent, le terrible William Quantrill dont les colonnes infernales de jayhawkers faisaient la loi au Kansas était en quelque sorte son fils spirituel...
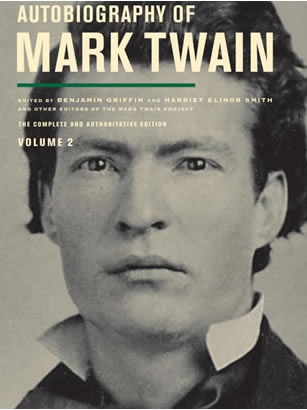
Inutile de jouer les pleureuses. C'était un monde dur, injuste, cruel et brutal. Mais sur la frontière on en riait. On s'amusait de tout. Le moral était au beau fixe. Vous trucidiez celui qui vous embêtait d'une balle entre les deux yeux ou si vous n'étiez pas un tireur d'élite d'un coup de couteau dans le dos. Y avait aussi des jeux récréatifs amusants : vous donniez une pièce d'un dollar à un parieur qui vous refilait un coq. Si vous arriviez à arracher d'un seul coup les pattes de la bestiole, vous emportiez le gallinacé et la pièce. Si vous ratiez, vous repartiez les mains vides. De Voto a d'autres poulaillers à fouetter. Tous les écrivains qui avant lui ont décrit les gars de la frontière comme des puritains coincés de là où vous savez. N'y avait pas beaucoup de femmes, mais les orgies avec les indiennes les remplaçaient avantageusement. Sans compter ces dames de petite vertu mais au grands coeur qui pour quelques dollars vous laissaient visiter leurs dessous. On fréquentait aussi les théâtres, je ne résiste à recopier ce passage : « Les costauds à la peau tannée se penchaient en avant, tendus par l'effort qu'ils faisaient pour saisir ce rêve aussi ténu qu'un fil de vierge. Enfin Adah Menken dénudait son corps mémorable, à l'exception d'un lambeau de gaze légère qui restait accroché là en manière d'excuse, et, attachée à l'étalon sauvage de Tartarie, elle était emportée, toute blanche, s'offrant au viol et promettant l'orgasme dans les hauteurs des cintres. » Ne vous précipitez pas, du premier choix inaccessible aux bourses vides...
Intellectuellement c'était itou. L'on préférait rire que bramer comme un cerf privé de rut. Journalistes, plumitifs, écrivaillons rivalisaient. C'était à qui ferait rire en premier le lecteur. Tout était bon. Accusations, calomnies, dénigrements, insinuations, attention les duels n'étaient pas rares, avec un lecteur, avec un confrère... Mais la mode était au rire. Mark Twain se définissait comme un humoriste. Un humour pas très fin, qui nous passe à côté mais à l'époque, tout le monde s'esclaffait à la première saillie. Suffisait de dire « Mire ce qu'elle a au bas du dos, c'est aussi gros que le Colorado » et vos auditeurs se roulaient de rire par terre pendant trois heures.
En fait ce que nous raconte Bernard De Voto, c'est la naissance du burlesque en tant qu'art premier de la frontière. Dans l'entremêlement des nations et des origines qui s'entrecroisaient, noirs et blancs se volaient chansons et musique. Chacun les adoptait à sa mouture et tout de suite après l'on reprenait, on la reconstruisait à sa manière et c'était reparti pour un tour. Dans les théâtres souvent mal éclairés les artistes faisaient de la surenchère, l'on se teignait le visage en blanc pour attirer les regards. White faces et black faces ont une commune origine.
A trente ans Mark Twain quitte l'Ouest. L'a confiance en ses capacités et en sa plume. Emigre à l'Est vers la capitale de la culture, Boston. Ses écrits sentent la vie et les coteries littéraires sont obligées d'accepter son talent évident. Est reconnu en tant qu'écrivain mais les femmes lui mèneront la vie dure. Non pas d'histoire de coeur ou de cul à rebondissements. Nous sommes dans dans la haute société. Ces dames très chrétiennes trouvent qu'il sent un peu trop le sauvage. Dit tout haut ce qu'il pense et ses propos sur la religion sentent le fagot. Son relativisme prudent ne serait-il pas le prudent camouflage de son athéisme ? Nos grandes dames de haute tenue ont remplacé leurs deux seins de chair ferme par les flasques mamelles de la dévotion et de la tempérance. Font régner une chape de plomb sur les maris et les fils. De Voto esquisse une explication : les femmes se vengent du viol qu'elles ont subi durant leur nuit de noces. Font payer, par cette castration que nous qualifierons de victorienne, à la population mâle familiale, le rêve brisé des jeunes filles chastes et pures qu'elles ont cru rester toute leur vie.
Dans les cent dernières pages De Voto analyse l'oeuvre de l'auteur des Aventures de Tom Sawyer et celles d'Huckleberry Finn en la comparant à celles de ses contemporains. Nous quittons alors l'Amérique des pionniers pour entrer dans une étude littéraire des plus classiques au bord de laquelle nous nous arrêterons.
Désolé de quitter Bertrand de Voto, mais nos pistes se séparent ici. L'est l'homme qui a vu les hommes qui ont tué l'ours. En effet il a côtoyé des témoins qui ont directement connu certains des personnages qu'il évoque dans la première partie de son livre. De loin, la plus enthousiasmante. Le creuset de la naissance de la musique populaire américaine.
Damie Chad.
PS : ah ! j'oubliais pour donner des cauchemars ou des idées ( sait-on jamais ? ) à tous les amateurs et musiciens de rockabilly, cette terrible histoire ( légendaire je vous rassure, mais aussi noire que le corbeau immémorial d'Edgar Poe ) du contrebassiste qui avait caché le cadavre de son épouse et de ses deux enfants qu'il avait assassinés dans les flancs de sa big mama.
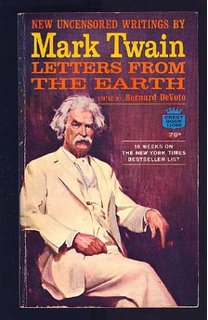




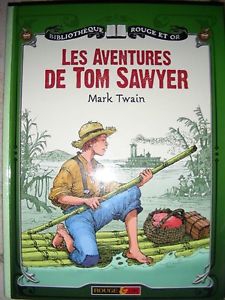
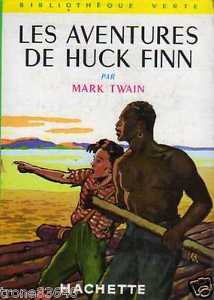
Les commentaires sont fermés.