30/04/2016
KR'TNT ! ¤ 279 : STEREO TOTAL / SUGAR BONES / EDDIE COCHRAN / NINETEEN / DAVID BOWIE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 279
A ROCKLIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
28 / 04 / 2016
STEREO TOTAL / SUGAR BONES
EDDIE COCHRAN / NINETEEN
DAVID BOWIE
POINT EPHEMERE / PARIS X° / 14 - 04 - 2016
STEREO TOTAL
A CREDIT ET EN STEREO TOTAL

Les gens qui ont assisté au set des Strokes à la Mutualité en 2002 doivent s’en souvenir : Stereo Total qui passait en première partie créa la surprise. Eh oui, ils étaient fabuleux, nos deux Stereo. Ils firent même passer les Strokes pour des garagistes ringards.

Treize ans plus tard, voilà-t-y pas qu’ils débarquent au Point Éphémère pour une nouvelle démonstration de force. Brezel Goring ressemble toujours à une rock star, mais Françoise Cactus accuse le poids du temps, comme si elle voulait prendre du ventre pour sonner comme Coluche. Le couple fait honneur à sa légende et diffuse vers un public acquis leur vieux brouet de fantaisie dadaïste. Ils tâtent du trash-punk avec le même doigté qu’auparavant et dodelinent leur «Musique Automatique» avec une certaine forme de mélancolie mélimontoise.

Ils font monter un jeune étalon pour danser avec eux le jerk lubrique de «l’Amour À Trois» et n’hésitent pas à tâter du cactus pour rendre hommage à Dutronc. Brezel Goring n’a plus sa guitare rectangulaire à la Bo, mais il déborde d’énergie. Il joue les prolongations, on croit que c’est fini, mais il attaque un nouveau cut, il ne veut pas quitter la scène, il veut encore profiter de l’excellente ambiance qui règne au Point. Les gens rigolent et dansent. Le bon esprit est de retour à Paris, semble-t-il.

Pas si sûr. En arrivant au pied de la station Jaurès, on a croisé une charge de CRS. Ils poursuivaient une équipe de mecs casqués. On s’est pris un peu de gaz dans l’œil, comme au bon vieux temps, on a grimpé les escaliers de la station sans traîner et on a sauté dans la rame. À travers les vitres du métro arien, on voyait les flics boucler le quartier.

Françoise Cactus et Brezel Goring forment ce qu’il faut bien appeler aujourd’hui un vieux couple. Au départ, on les situait dans la mouvance des Rita Mitsouko, mais leur problématique consistait justement à se différencier des Rita en travaillant un autre son. Françoise chantait mal. Ils eurent l’idée géniale de transformer ce handicap en avantage, comme Gainsbarre l’avait fait en son temps avec Brigitte Bardot. En vingt ans, ils ont enregistré une petite douzaines d’albums et bricolé un son à base de machines. On passe à travers certains albums à cause des machines, justement. Le petit conseil qu’on peut vous donner est de les voir sur scène. Ils dégagent une énergie considérable, même si Françoise Cactus joue les impassibles derrière sa petite batterie, pendant que Brezel pique sa crise en grattant sa guitare.
Ils sont photographiés au volant d’une voiture pour la pochette de leur premier album, «Oh Ah», paru en 1995. Au dos, Françoise est assise à poil sur la pelouse d’un parc. On retrouvera d’ailleurs une variante de cette image sur la pochette de l’album suivant. Deux duos d’enfer et deux hits de juke se nichent sur ce premier album. Ils font en effet du Gainsbourg/Birkin avec «Supergirl». C’est Brezel qui chante d’une belle voix mâle - Hey supergirl tu sors de ton Aston Martin - C’est admirable et bien rimé - Ton Fleur Bleue de chez Guerlain/ Me fera perdre mon latin - Et il revendique de la tendresse de tigresse. Ils font aussi une reprise de «Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais». On retrouve la magie de Gainsbourg - Tes sanglots longs n’y pourront rien changer/ Comme dit Verlaine au vent mauvais - On a au moins un vrai truc à se mettre sous la dent. On reste dans l’excellence avec «Moviestar». Brezel reprend le groove de charme - You think you are a movie star - Quelle élégance ! Ce mec chante comme un dieu et Françoise apporte sa fraîcheur ingénue - Woahh wahhhh - Avec «Get Down Tonight», ils transforment le plomb du beat en jerk d’or. Françoise sort son meilleur get down baby ! Et puis on découvre chez eux un goût prononcé pour le trash, à travers «LA CA USA» - pur trash punk - et «Miau Miau»

Quatre belles bombes tombent de «Monokini» paru deux ans plus tard. À commencer par «Lunatique», vieux jump de stomp joué au tambourin - Un jour tu dis oui/ Le lendemain tu dis non - Fantastique ! Ils font du Dutronc, même son de casseur de baraque. On retrouve sur cet album l’infernal «Supergirl» qui sort de son Aston Marin et qui se parfume au Fleur Bleue de Guerlain. Brezel passe un solo de wha-wha énorme - Ta p’tite culotte Calvin Klein/ Tu la retrouveras à la saint-glinglin - Voilà le travail. On tombe plus loin sur «AVA», un trash-punk complètement dévastateur. Ils savent faite sauter une sainte-barbe ! C’est une horreur orientalisante chantée de loin en loin, un vrai coup de génie. Aw c’mon, on entend Françoise au loin et Brezel envoie un killer solo kill kill kill. Ils restent dans la pure violence punk pour «Tu M’as Voulue». Françoise chante robot et elle bat ça au gros beat punk - Tu m’a voulue/ Tu m’as euuuuuuuuueee - et Brezel enfile un solo garage. Il reprend aussi «LA CA USA» et montre qu’il peut jouer comme un con.

Trois belles choses guettent l’amateur et l’amatrice sur «Juke-Box Alarm». Pour commencer, un «Comic Striptease Girl» chanté en Allemand, monté à la basse fuzz et torpillé de plein fouet par une guitare en distorse. Avec «Film D’Horreur», ils sortent un vrai jerk electro, monté sur un gimmick binaire. S’il n’en reste qu’un ce sera celui-là. L’autre énormité, c’est bien sûr «Der Schlussel», un air de fête foraine bourré d’énergie. Quand ils défoncent, ils défoncent pour de bon, et pas seulement pour de bon, mais aussi pour de vrai. Ô Puissances des Ténèbres Electro ! Notons au passage que Françoise chante parfois très faux et ça peut devenir insupportable, comme c’est le cas avec «Crazy Horse». Elle se prend aussi pour Stone de Stone et Charden dans «Les Minets», mais bon, on lui pardonne. Il faut savoir rester magnanime en toutes circonstances.

Vous trouverez deux véritables coups de génie sur «My Melody» paru en 1999. Brezel lance le stomp de «Vilaines Filles Mauvais Garçons» (signé Gainsbourg) et nous claque ça aux accords. Il sait caler un jerk. Autre énormité avec «Partir Ou Mourir». C’est là qu’on mesure leur grandeur - Ils veulent nous flinguer/ Nous faire un gros trou dans le dos - Voilà comment devrait être jouée la pop. Ce hit devrait servir de modèle. «Disc Jockey» vaut aussi le détour, car on a là une belle tranche d’electro. Ils savent driver un cut, pas de doute là dessus. Ils passent un hommage aux Beatles avec «Ringo I Love You» - yeah yeah yeah - «Milky Boy Bourgeois» se danse au coin du juke, c’est un vrai hit sixties de démence pure et Brezel boucle en sortant son baryton pour «Joe Le Taxi». Il bat tous les records (de baryton, bien sûr).

«Musique Automatique» pourrait bien être leur meilleur album. C’est là que se niche leur reprise légendaire de «Nationale 7» - De toutes les routes de France/ Celle que j’préfère - Pure énormité. Ils explosent littéralement la mélodie. On voit rarement des explosions aussi juteuses. Ils nous plongent dans leur démence pure de ciel d’été et d’amour qui fait risette. Ils se servent du ciel d’été pour déclencher l’apocalypse. On retrouve cette fulgurante dynamique dans le morceau titre qu’ils swinguent à outrance. Encore une bombe : «Für Immer 16». C’est tout simplement le punk-rock revu et corrigé par Stereo Total. Françoise lance un assaut plein de jus qui éclabousse tout. Ils sont réellement monstrueux. Ils croisent Ministry avec Dutronc comme on le voit avec «Hep Onalti’da» qu’ils chantent en Grec. Ils deviennent les rois du tourbillon et rivalisent d’ardeur avec Al Jourgensen et Alec Empire, les seigneurs de la transe. C’est apocalyptique. Il faut écouter cet album pour ne pas mourir idiot. On y trouve aussi du sexe, car Françoise vante les mérites de l’amour à trois dans «L’Amour A Trois» - Moi c’que j’aime c’est faire l’amour spécialement à trois - C’est du jerk à l’état pur - Moi c’que j’adore c’est les p’tites caresses à quatre mains - Sex & drugs & rock’n’roll - Puis ils stompent «La Pequana Melodia» comme un hit de Dutronc. Ils en font un véritable hit d’exotica repris aux instruments d’enfants. Voilà encore une sacrée dégelée de monster beat !

Avec «Do The Bambi», le soufflet retombe un peu. Ils sonnent soit comme les Bee Gees de la mauvaise époque, soit comme un duo electro en panne d’idées. «Cinemania» est insupportable, car Françoise fait de la charpie de noms - Pasolini, Fellini et compagnie - Trop facile. Le hit du disque s’appelle «La Douce Humanité». Voilà une pièce de punk sixties à la France Gall - Des dingues des malades voilà ce que je vois/ Nulle part la douce humanité - On trouve un autre bon cut sur cet album, «Ne M’Appelle Pas Ta Biche» joué au trash-punk - Ne m’appelle pas ta chatte/ Ta minette - En fait, ils passent bien mieux quand ils chantent en duo, c’est même leur grand art, comme le montre «Europa Neurotisch».

«Discotheque» n’est pas non plus un grand album, loin de là. Ils font une reprise du «Mother’s Little Helper» des Stones - What a drag it is getting old - Ils respectent bien l’esprit des little yellow pills et du shelter du little mother’s helper. Mais ils font des hommages atroces à Jacno et à Taxi Girl qui nous rappellent des très mauvais souvenirs d’une sale époque. L’autre cut sauvable de l’album n’est autre que «Das Erste Mal» sacrément bien secoué du bulbe. Ils font de la pure discö electro. On sent la force d’un couple convaincu dans l’intimité de leur tiédeur épidermico-electro. Voilà bien le hit du disk. Mais pour le reste, c’est tintin.

En examinant la pochette de «Paris Berlin», on songe à cette folie des expos Beaubourg qui nous donnèrent le vertige dans les années soixante-dix, dont le fameux Paris-Berlin, mais aussi le Paris-Moscou, le Paris-New York et le Paris-Paris. Ah on peut dire qu’on en a bouffé du catalogue pouf pouf de Beaubourg ! Françoise attaque en force avec «Miss Rebellion Des Hormones», une petite electro sans lendemain - Elles ont besoin de tendresse ces deux petites fesses - Ça commence à chauffer avec «Küsse Aus Der Hölle Der Musik». Quelle bande d’agitateurs du stomp ! - I wanna be loved by you - Elle parle de Brian Jones et de Marc Bolan, du Père Laschaise, de Johnny Vicious, de Danny Whitten et de Janis. Elle allume enfin la mèche avec «Plus Minus Null» qu’elle chante à la fois mal et bien. On assiste à l’emballement des bécanes et à une fantastique partouze d’electro de Flore d’entrejambe de stéroïde. Et ça continue avec «Mehr Licht», pur délire d’electro par dessus les ponts, approche ton oreille de robot de buzz, ils tapent dans le répondant d’electro de bas nivö - Courage courage, tout le reste, c’est de la pose - Ils enchaînent ça avec «Ta Voix Au Téléphone», un groove de rêve érotique avec des ahhhh qui en disent long sur la lancée, allo allo tu m’entends, mais il fait le pitre, il fait beau temps, est-ce que tu t’ennuies de moi ? Et voilà qu’ils rendent hommage à la fameuse Patty Hearst - Princess & terrorist - en la montant sur un puissant beat electro. On tombe plus loin sur un énorme «Relax Baby Cool» qui donne la chair de pool, et tout le monde il est mabool, je marche comme une somnambool dans cette fool qui me sool. Ils bouclent avec un sacré «Modern Musik» de bonne débandade et d’effervescence absolutiste. Ils se proclament ainsi rois de la punkitude à la cathédrale de Reims.

Avec «No Controles», ils font un albumen Espagnol. Ils reprennent tous leurs vieux coucous d’Amour à trois et de Miau Miau mais on bâille aux corneilles.

Retour aux affaires an 2010 avec «Baby Ouh». Le morceau titre qui se trouve en fin d’album est un véritable coup de génie. C’est l’un des hits de Stereo. On y entend un effarant background déconnecté de la mélodie chant. Voilà ce qu’il faut bien appeler une pure merveille monstrueuse - Si tu fais ta valise, si tu veux la devise, je ne serai pas surprise - Autre clin d’œil à Bardot avec «Elles Te Bottent Mes Bottes» et elle en rajoute - Est-ce qu’elles te branchent mes hanches - Voilà de la belle pop énervée - Elles sont chouettes mes couettes/ Est-il trop sage mon corsage ? - C’est joué à la batterie. On retrouve les paroles ingénues dont Françoise s’est fait une spécialité - Elles te réjouissent mes cuisses ? - On se croirait chez Godard. Avec «Alaska», elle fait sa frigide - Je suis un frigo/ Appelle-moi Alaska - Elle chante ça exactement comme ces petites connes du temps de Salut les Copains - Moi qui croyais à tes contes de fée/ Ah quelle belle conne je fais - Encore une sorte de coup de génie avec «I Wanna Be A Nana», car ils traitent ça au Brill. Brezel chante et il a du jus, l’animal. Ce mec sait ramener de la hargne dans la pop - Oh yeah I wanna be a nana - C’est la voix d’un mec en perfecto et en Ray-Ban noires. Et la Cactus la ramène par derrière. Ils jouent «Illegal» en pur punk de guitare rectangulaire - Faut toujours que j’avale comme si c’était normal - Elle a vraiment un don pour la rime à la con - Tu m’ronges l’épine dorsale/ Tu m’fais faire des bêtises dans les rues d’Montreal ! - Admirable.

«Cactus Versus Brezel» sort en 2012. Françoise continue de jouer les ingénues libertines avec «Jaloux de Mon Succès», et Brezel plaque des gros paquets de distorse. Il intervient toujours brillamment. Brezel est un pur trasher. Il faut attendre «J’Aime le Synthétique» pour trouver un peu de viande. Ils pompent carrément le drumbeat de Dutronc, mais elle se rend très vite insupportable de modisme. Ils renouent avec le vieux stomp electro pour «Ich Will Blut Sehen». Voilà le vrai son de Stereo. Ils sont magnifiques de force inventive, car ils possèdent un vrai sens du stomp electro. Ça fonctionne à tous les coups. Ils bouclent avec «We Don’t Wanna Dance», un cut très impressionnant, vu d’avion. Elle casse la baraque. Ils vont au plus profond du mythe Stereo. Ils atteignent le fond de leur son et ça vire à l’énormité, une fois de plus. On entend même une sorte d’accordéon en distorse. Voilà qui risque d’en effarer plus d’un et plus d’une.

Ils reviennent cette année avec une compile intitulée «Yéyé Existentialiste». Pour eux, c’est une sorte de consécration, car la compile est sortie sur Blow Up Records, le label anglais du Bongolian. Et pour ceux et celles que Stereo intéresse, c’est l’occasion rêvée car on y retrouve pas mal de gros hits (sauf hélas «Nationale 7»). En plus de «Musique Automatique», «Relax Baby Cool» (amené à l’excitation maximale), «L’Amour À Trois», «Partir Ou Mourir» (pure merveille pop), «Inch Bin Der Strichergunge» (Brezel le rocker de banlieue allemande) et «Fur Immer 16» (l’un de leurs plus grands hits de trash-punk»), on trouve aussi une version du «Heroes» de Bowie et une reprise de «Comme Un Garçon» jouée au glam anglais - Pourtant je ne suis qu’une fille...
Signé : Cazengler, Sirop Total
Stereo Total. Point Ephémère. Paris Xe. 14 avril 2016
Stereo Total. Oh Ah. Little Teddy Recordings 1995
Stereo Total. Monokini. Bungalow 1997
Stereo Total. Juke-Box Alarm. Bungalow 1998
Stereo Total. My Melody. Bobsled Records 1999
Stereo Total. Musique Automatique. Bungalow 2001
Stereo Total. Do The Bambi. Disko B. 2005
Stereo Total. Discotheque. Disko B 2006
Stereo Total. Paris Berlin. Disko B 2007
Stereo Total. No Controles. Elefant Recors 2009
Stereo Total. Baby Ouh. Disko B 2010
Stereo Total. Cactus Versus Brezel. Staatsakt 2012
Stereo Total. Yéyé Existentialiste. Blow Up Records 2015
FOIX ( 09 ) / 21 - 04 - 2016
L’ACHIL CAFE
SUGAR BONES

La Barre, son barrage, sa zone d’activité commerciale, banlieue blafarde de Foix coincée le long de la nationale 20, entre le plan d’eau et les contreforts rocheux des Pyrénées. La teuf-teuf emprunte la bretelle d’accès à contresens et va se garer d’instinct à cinquante mètres des quatre seuls êtres vivants encore visibles dans les environs. Coup double, juste devant l’Achil Café ( pas question de tourner les talons ), et les quatre zigues pâteux à la mine sympathique m’ont tout l’air d’être des musicos. Un coup au cœur lorsque je passe devant eux, j’entends le nom de Weather Report. Courage Damie, nous sommes en Ariège, et tu as dégoté un concert, alors sois heureux et remercie le Seigneur. Se contentera d’un doigt d’honneur mental, le grand responsable de la disette rock planétaire. Je suis un peu artisan de mon propre malheur, je maugrée, pourtant demain l’affiche promet un groupe punk à l’Achil Café, et moi aux abonnés absents. Ô cruauté délétère du sort qui m’accable !
Sas d’entrée, six euros d’octroi et enfin dans l’Achil Café. N’imaginez point un rade parisien exigu, plutôt un hall d’aéroport, assez d’espace entre les tables pour qu’un éléphant puisse s’ébrouer sans danger pour votre orangeade. Pardon, j’ai oublié la vodka. Coins banquettes à droite, comptoir sans fin à gauche, une véritable scène au fond. Longs voiles noirs au plafond, des dizaines d’affiches sur les murs, atmosphère accueillante, la salle se remplit un peu, beaucoup de groupes de filles sans mâles chevaliers servants à leurs côtés.
SUGAR BONES

Quatre sur scène, et illico un funk à réveiller puces et morpions qui sommeillent dans la douce moiteur pubienne de votre corps. Mais ce shake body n’est qu’une bande annonce pour la tonitruante entrée des deux chanteurs. Robin et sa guitare, Aliénor et sa beauté. Soul Groove qu’il y avait sur l’affiche. Ce n’était pas un mensonge. En tant que rocker j’avoue que le groove me soûle un peu, mais là c’est bien en place, les musicos sont plein d’énergie et paraissent s’amuser comme des fous.
Section rythmique : vous trouverez Romain à la basse, coupe afro boursoufflée, interventions un peu timides, n’éprouve pas le besoin d’assourdir le son par d’énormes vibrations envahissantes, vise plutôt à l’élasticité sonore en accord avec Mika qui tel un Shiva hindou agite ses bras sur ses cymbales. Vous devinez là une des spécificité de Sugar Bones, la rythmique halète, file et soutient le tempo de main de maître, mais ne se taille pas la part du lion.
Le gros du son est assuré par les bibelots sonores point du tout abolis que sont le saxophone et l’orgue. Martin, cravate champagne et claviers rouge-sang, fournit l’ossature craquante, la moelle sucrée de l’os, celle dont vous vous pourléchez les babines, tellement présent que vous n’y accordez aucune importance, si consubstantiel à la musique du groupe que vous n’y faites pas plus gaffe qu’à la poutre maîtresse de votre maison qui empêche que le toit ne s’effondre sur votre tête. En plus Martin possède sa martingale secrète, joue funk mais son orgue sonne comme dans les groupes des années soixante. Hyper hype ! Antoine, frimousse bouclée et pantalon noir tortillés de motifs noirs labyrinthiques, et puis un sax dément, de longues soufflées style lance-flammes ravageurs. Partout présent avec cette marque de fabrique des Sugar Bones, ne jamais marcher sur les platebandes des copains, l’est la cheville coruscante, la chenille processionnaire du groove, mais sait s’arrêter à temps. Un son ronflant mais pas gonflant. Long saxo mais pas grosse tête. Par deux fois, il se paiera le luxe de boom-boomer sur la paire ce congas inoccupée.

Chemise noire, espèce de queue de pie informe à rayures surpiquées avec col de fourrure ( véritable faux lapin made in Taïwan ) qui retombe par devant, allure dégingandée, guitare à bout de bras, voici Robin. Incapable des rester en place. Genre agité du bocal. Vous faudra cinq minutes pour vous apercevoir qu’il se sert de son instrument. Pas du tout le genre gratteur ravageur, l’est un partisan du miaulement, de la note qui fuse et qui vous transperce le tympan droit, pour le gauche ce sera le couinement de la souris prise au piège, et en plus il chante. Même style qu’à la guitare. Il intervient, il déclare, il opine, il remarque, ne se lance jamais dans des lyrics interminables, mais quel beau timbre, quelle voix, à l’écouter vous en oublieriez Aliénor.
Pus qu’un crime, une erreur. Ne soyez pas des gars lents, soyez galants. Robe courte et collants noirs. Bras blancs et cheveux tombants sur un côté du visage. L’a du chien, Aliénor, de la voix et du charisme. Elle ne chante pas, elle joue, elle interprète, elle mime, du geste et de la danse, mêlant tour à tour le feu du funk à la cendre plaintive des ballades crépusculaires. C’est là l’autre secret de Sugar Bones, n’enfilent pas les morceaux à la suite. Savent le faire, nous donnerons par exemple en début de deuxième partie un Superstition irréprochable une version beaucoup moins stricte et triste que la scolaire démonstration groovique de Stevie Wonder, mais ce n’est pas leur propos. Les Sugar Bones racontent des histoires, de sombres tragédies d’amours maladives et de voyous de troisième mouture - Aliénor dresse les décors et campe les personnages, mélodramatise à mort, Robin se contente de courtes réflexions insidieuses, les drames romantiques de la vie les Sugarbones les transforment en comédies burlesques. Sous les larmes, le rire inextinguible de la vie pétillante. Laissons la plage aux drôlatiques. La sveltesse et la brièveté des vocables anglais se prêtent à merveille à ces dissonances existentielles mises en scène, devraient tout de même faire l’effort de composer quelques textes en français - la plasticité de notre langue s’y prête peu mais à l’impossible tout un chacun est tenu - et ils y gagneraient davantage de complicité avec le public. Remarque superfétatoire si j’en juge par le monde qui remue du croupion et du sourire au bas de l’estrade. Et puis Aliénor a l’art et la manière d’introduire les morceaux, ne dévoile rien mais suggère beaucoup. Sait minauder avec l’assistance, les petits sous-entendus complices sans jamais une once de vulgarité.

Vont délivrer deux sets d’égale intensité, un meddley funk-disco-r’n’b-rhythm and blues-Nouvelle-Orléans, passage en revue de la musique populaire noire, par six jeunes petits blancs directly fron toulouse qui ont une pêche melba extraordinaire. Triomphe assuré, un dernier rappel une reprise de Mister Hyde - tout un programme - déjà donné en début de show, mais personne ne rouspète, trop contents d’une dose de vitamine D ( celle qui commande l’énergie sexuelle ) supplémentaire. Foi de rocker, une soirée plus qu’agréable.
Damie Chad.
EDDIE COCHRAN
TONY MARLOW
( JUKEBOX MAGAZINE N°353 / Avril 2O16 )

Cette année Jukebox Magazine a mis les petits plats dans les grands. Première de couve pour Eddie Cochran. Guitar Hero, c’est le sous-titre. Les rockers ont compris. Sans ouvrir la revue, l’on sait que c’est Tony Marlow qui s’est chargé de l’article. Un diamant noir de plus à ajouter à ses précédentes et précieuses études dévolues aux grands guitaristes du rock. Des écrits souverains qui nous dressent un portrait du rock and roll, de l’intérieur. Une somme signifiante et germinative. En prime vous pouvez commander pour 25 euros un 25 cm Eddie Cochran On Stage 1957 - 1960 regroupant treize titres. Attention, ne sont tirés que trois cents exemplaires.
17 avril, c’est le onze novembre des rockers. La date fatidique. C’est en 1966 que je me suis procuré mes deux premiers 45 Tours d’Eddie. Cinquante ans. Un demi-siècle. Un mal de chien. Les avais trouvé à cent cinquante kilomètres from my house, à Montpellier. Fallait se déplacer loin lorsque l'on habitait au fin fond de la France, si l’on voulait mettre la main sur des disques de ce que déjà à l’époque l’on appelait le rock des pionniers. Restait encore des vieux Presley un peu partout dans les bacs, mais c’était tout. Etrangement l’on mettait plus facilement la main sur les rockers noirs : mes premières acquisitions furent de Chuck Berry et de Little Richard. Pour Cochran, j’étais aux aguets depuis la sortie au printemps 65 de la chanson J’avais deux Amis d’Eddy Mitchell. Remarquons que sous l’avion de Buddy Holly et le taxi d’Eddie Cochran, l’était suggéré une troisième piste de recherche aussi prometteuse puisque la pochette indiquait que l’ode aux deux rockers était une adaptation de Saint James Infirmary, porte ouverte sur le continent noir du blues.
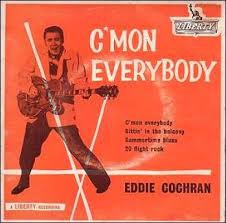
Eddie Cochran est l’Arthur Rimbaud du rock. Entre seize et vingt un ans il délivre une œuvre fabuleuse. Et puis le silence, irrémédiable. Mais au contraire de l'enfant de Charleroi, l‘on ne pourra jamais parlé de reniement, de renoncement. C‘est le destin qui s‘en charge. La Parque coupe le fil. Avant que le film ne commence vraiment. L’on a juste la séquence d’ouverture. Scénario sans fin. L’on range la bobine dans le cercueil et c’est terminé. Passons à autre chose.
Mais il est des cadavres qui ne veulent pas mourir. Refusent de reposer en paix. L’Œuvre est éparse, faudra des années avant qu’elle ne nous soit restituée en son entier. Des années encore pour que ses différents éléments soient mis en perspective. Inutile d’accuser les uns ou les autres. L’est sûr que chez Liberty l’on n’a pas vraiment su mesurer l’importance de l’oiseau fabuleux qu’ils avaient déniché. Mais Cochran a été le premier à se contenter de la cage dorée qui lui fut offerte. L’oiseau ne s’envola pas car les portes étaient grand ouvertes. Pas du tout cadenassées. Toutefois un peu trop béantes sur l’incertitude des temps et des choses.

Eddie Cochran est le Janus du rock. Ce dieu romain aux deux visages, l’un tourné vers le passé et l’autre vers l’avenir. En 1956 le passé du rock s’appelle Elvis Presley. La romance du pauvre. L’est arrivé à transformer le plomb saturnien du hillbilly en l’or en barres du rock and roll. N’a pas réalisé l’exploit tout seul, a été aidé, Sam Phillips et RCA lui ont mis le pied à l’étrier et ensuite tout est allé très vite. Trajectoire de météorite. Pas du genre coucou c’est moi je ne fais que passer, de celles qui s’accrochent au firmament et dont les feux éclipsent tous les autres. A l’époque n’y a pas de Victor Hugo pour percevoir les ombres entre les rayons. Tout nouveau. Tout beau. Le modèle idéal. Si vous voulez réussir dans le rock and roll, imitez Elvis. Chez Liberty l’on a davantage les regards tournés vers la réussite que vers le rock and roll. Le problème, c’est que l’on ne remplace pas Elvis du jour au lendemain. Faut des tubes et des films. Le genre de marchandises qui ne trouvent pas sous le sabot d’un cheval. Surtout si la monture renâcle un peu.

Certes Eddie rêve de remplacer Elvis mais le garçon a aussi ses mauvaises habitudes. N’est pas que chanteur, l’est aussi musicien. Cela c’est le futur du rock, mais personne ne le sait encore. Un guitariste d’exception. Jazz, blues, rock, country, sait tout faire. La gamme complète. Le gars sympa, toujours prêt à aider, vous refile ses dernières idées, vous pond une petite merveille de solo sans même se dire qu’il aurait dû le mettre au frigo pour lui. Généreux. Je le qualifierai davantage de musicien de session que de studio. Pas le requin qui s’en vient faire preuve de l’impeccabilité de son brio et puis qui se tire au plus vite, mais un expérimentateur passionné qui a toujours un truc en plus à essayer. A vous montrer. A vous offrir.
Elvis a opté pour une carrière. Cochran invente le rock. L’existe déjà depuis toujours mais il en fixe les modalités existentielles. Aux USA, Cochran est un parmi tant d’autres, c’est quand il arrive en Angleterre que son action revêt toute sa force catalysatrice. En quelques semaines, grâce à ses conseils le rock anglais change de dimension. Guitare, batterie, l’apporte cette assise rythmique typiquement américaine qui manquera tant aux groupes français. Longtemps l’on se plaindra dans notre pays aux mille fromages d’avoir des groupes mais pas de son. C’était oublier que le groove est le vecteur du son. French snif, snif !

Ironie du sort, lui qui aura beaucoup partagé avec les futurs Shadows n’aura pas ni le temps ni l’occasion de développer sur un album entier ses visions sur le rock instrumental. L’avait une difficulté à surmonter : la trame et la transe rythmiques de son jeu étaient en totale contradiction avec l’effulgence m’a-tu-vu des soli. L’a libéré la cavalcade infinie des chevaux fous mais n’a pas réussi à asseoir la suprématie du lead guitar. Bizarrement j’ai toujours eu l’impression qu’Eddie avait tendance à jouer ces solos avec sa voix. Ce qui est un comble quand on pense à sa virtuosité instrumentale. Faut lire Marlow, l’a des explications éclairantes sur le jeu de Cochran, pas un guignol comme moi qui n’y connaît rien et qui ne s’appuie que sur des approximations poétiques.
Stage et studio, les deux mamelles du rock. Cochran a excellé dans les deux. L’a en quelque sorte industrialisé le rock. Ne s’est pas contenté d’une simple réverbe, l’a compris qu’il était nécessaire de chromer le son. D’alourdir l’audition, d’impacter l’auditeur. Phil Spector s’en souviendra. Eddie ouvre la voie royale de la production rock. Aujourd’hui la production a pris le pas sur le rock and roll. On y applique trop souvent la recette du pâté d’alouette. Comptez un cheval pour une alouette.

Ne s’est pas enfermé dans son studio. L’en est sorti à plusieurs reprises et pas seulement dans la périphérie de Los Angeles. L’a traversé les mers, Australie et Europe. Y a d’ailleurs perdu la vie. C’est en ces instants que son amitié avec Gene Vincent prend toute sa signifiance. Le rock and roll est le fils constitutif d’une errance existentielle. Un cheminement poétique et rimbaldien sur les gouffres béants du devenir. Little Richard en éprouvera la sensation d’y perdre son âme. Quand il s’apercevra de son erreur, ce sera trop tard, il ne retrouvera jamais l’ardente plénitude dont elle était pétrie. Mais pour Gene, il n’est pas de retour possible. L’est le premier à inaugurer cette fuite des rockers américains vers la vieille Europe. Une espèce d’exil exotérique qu’avait inauguré la génération perdue précédente, celle du blues. Quitter l’œuf protecteur du studio et choisir de vivre en prise direct live. L’émancipation adolescente du cocon familial. La crise ombilicale générative du rock and roll. Malheur aux aiglons en leur premier essor à qui la vie réserve un coup de fusil inopportun et assassin. Un taxi aux portes de Londres nous a privés du futur du rock and roll.
Damie Chad.
NINETEEN
1982 - 1988
ANTHOLOGIE
D’UN FANZINE ROCK
( LES FONDEURS DE BRIQUES / MARS 2016 )
Les Fondeurs de Briques ne sont pas des inconnus pour les lecteurs de KR’TNT ! Avons déjà chroniqué de cette maison d’éditions toulousaine un ouvrage essentiel : Le Pays où Naquit le Blues d’Alain Lomax et une monographie de Jeffrey Lee Pierce, Aux sources du Gun Club de Marc Sastre, l’est des choix oriflammes qui claquent au vent comme des palmiers sauvage au bord des plages de Miami et de l’imaginaire rock. Donc ce nouveau volume consacré au fanzine toulousain Nineteen n’est pas dû au hasard et s’inscrit dans une certaine vision du rock and roll qui n’est pas pour nous déplaire.
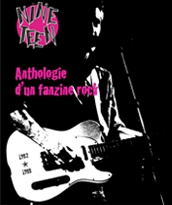
Avant d’ouvrir le paquet je m’attendais à la reproduction de quelques couves historiques du fanzine. Rien. Certes cela s’inscrit dans une certaine continuité éditoriale de la revue : du texte avant toute chose, uniformément réparti pleine page sur trois colonnes. Parfois une photo joliment tramée, mais pas de débauche de clichés. Des écolos avant l’heure qui ont dû faire l’économie d’un chêne centenaire à chaque numéro. Rien à voir avec les fanzines punk de la belle époque aux lettrages dévergondés, aux maquettes délirantes. Tout de suite une impression de sérieux académique. D’autant plus étonnant que l’on pourrait résumer la ligne idéologique de Nineteen en disant que la revue s’était donnée pour but de défendre tous les déjantés du rock and roll. Un cap d’autant plus méritoire que le fanzine a vécu durant les funestes années 80 qui furent au rock and roll ce que la Pérestroïka fut pour l’ancienne URSS. Comparaison mal venue puisque, sans jamais le revendiquer politiquement, des bases idéologiques de Nineteen s’élevait un agréable fumet d’éthique libertaire des plus affirmés.
L’est des décisions que l’on ne devrait jamais prendre. Evitez de décider de vous lancer dans la confection d’une revue rock. Au début, cela paraît simple, un trimestriel, cela donne le temps d’écrire vos articles : pas d’urgence, vous pouvez soigner le style, vous documenter à foison, pondre des monographies de douze pages tout à loisir. Mais trois mois, ça vous file entre les doigts sans que vous vous en aperceviez. Vous n’avez pas terminé le premier numéro que tout le monde vous le demande. Merci les copains ! On essaie d’améliorer la qualité technique pour le deux. Et vous voici engrangés dans un engrenage sans fin. Le pire c’est qu’entre les abonnés et les dépôts chez les disquaires, vous diffez à six cents exemplaires et puis à mille cinq cents. Vous savez que vous pourriez faire mieux, mais il ne faut pas rêver. Allez trouver une banque ou un fond de pension qui se mette en tête de vous aider ! Nineteen fera le pari d’une diffusion mensuelle en kiosque qui ne durera que trois mois, le temps de réaliser que malgré un tirage de trois mille cinq cents exemplaires, la revue ne possède pas l’assise financière qui permettrait de rentabiliser l’aventure. Et le combat cessera faute de combattants, comité de rédaction peu étendu, fatigue et lassitude. Auront tenu 25 numéros, contre vents et marées, sans compter le magazine latéral Going Loco, défendant exclusivement la scène française. Offraient en prime un single aux abonnés et s’amusaient à organiser des concerts. Un peu déçus des réactions de certains groupes qui se croyaient en territoire conquis… Des héros, que leurs noms soient sanctifiés jusqu’à la fin des temps.

FRANK BEESON / BENOIT BINET / GILDAS COSPEREC / JIM DICKSON / SOPHIE DUTERTRE / ALAIN FEYDRI / ANNE KERVELLA / CHRISTIAN LARREDE / ANTOINE & KARL MADRIGAL / JEAN-LUC MANET / FRED MILS / POSTMANN / JOSE RUIZ / SCHELL SCOTT / MONIQUE SABATIER / DOMINIQUE SAILLARD / STEPHANE SAUNIER / ERIC TANDY / ERICK WEBER
Nineteen n’a jamais fait de concession. Ont parlé de ceux qu’ils aimaient et se sont contrefichus des dernières modes de l’actualité. Préféraient les guitares aux synthétiseurs, les outlaws au mainstream, agonisaient la rock musak calibrée par l’industrie du disque, militaient pour un rock vivant et séditieux. Trente ans après, la situation n’a guère changé. Les mauvais esprits diront qu’elle a empiré. Ne nous laissons pas anéantir par la tristesse des temps, plongeons-nous sans plus attendre dans la lecture revigorante de cette tumultueuse anthologie.
D’entrée de jeu les Byrds, le premier grand groupe amerloque post-beatlesmania, si l’on excepte les Beach Boys un peu trop près de Chuck Berry, nos oyseaux pépient de belles pépites, dès la première entrée Nineteen nous offre une interview de Gene Clark qui composa les titres emblématiques du groupe avant de se percher sur d’autres branches… C’est tout de suite après cette première séquence que l’on enfile les descentes vertigineuses des pistes noires du rock’roll. Aujourd’hui Love est une affaire classée. Grand groupe prometteur et très vite sortie de route définitive. En décembre 1984 Arthur Lee possède encore un futur. Nineteen y croit encore. L’est rappelé qu’il est en quelque sorte le précurseur de Jimi Hendrix qui galère encore aux côtés de Little Richard. C’est après voir vu les Stones à la TV qu’il comprend que la cloison étanche qui séparait le rock and roll blanc du rhythm and blues noir vient de s’effondrer. Son sang de jeune métis se sent comme enfin réunifié en son propre corps. Entre 1965 et 1968, Love essuiera les plâtres du rock and roll américain, le groupe ne maîtrise pas son entourage, la dope occasionne des ravages, entre les deux mon cœur balance, entre ses deux poulains qui piaffent d’impatience dans son corral, Elektra fera le choix de la sérénité ( ! ), laisseront tomber Love pour tout miser sur… les Doors ! Ne reste plus à Arthur Lee qu’à emprunter les sorties de secours. Prison et leucémie.

Pas le temps de verser une larme, MC 5 brûlent les planches, trois disques, trois armes de destruction massive, les panthères blanches du rock and roll passent à l’attaque. S’il fut un groupe éminemment politique au sens noble du mot, ce fut bien le quintet maudit de Detroit. Quand on pense qu’en ces temps glorieux Elektra affichait dans son catalogue : Love, Doors, MC 5 et Stooges, l’on se dit que l’âge d’or est derrière nous. MC 5 se désintègre en plein vol comme une fusée dont le carburant s’enflamme. Qu’importe, le vaisseau spatial vogue encore vers les confins de l’univers, et l’on peut suivre sa trajectoire incandescente sur les écrans de l’imaginaire rock.
Des Sonics, Nineteen ne retient que les deux premiers albums… S’attarde sur Sky Saxon des Seeds, encore un groupe de la légion des gueules cassées du rock and roll ! Croquons rapidement dans la tablette du Chocolate Watch Band pour arriver aux Flamin Groovies : se taillent la part du lion avec pas moins de trois interviewes : tour à tour Roy Loney, Danny Mihm, Cyril Jordan. Ensemble passionnant, lecture obligatoire pour les inconditionnels des Flamin’ et pour tous les autres qui veulent savoir comment fonctionne un groupe de l’intérieur. Des propos qui confortent la doctrine d’Empédocle : le cycle Amitié / Haine , Amour / Discorde est le moteur pas du tout immobile de l’univers.
Au tour de Syd Barrett, je passe, je n’ai jamais accroché, pas plus qu’à Elliot Murphy, vous laisse découvrir Twink batteur émérite et successif des Pretty Things, des Pink Fairies et des Deviants, un beau tapage. C’en est fini pour la première partie qui couvre les années soixante et soixante-dix. J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche.

Deuxième round. Eighties in America. La période noire. Reste encore du beau monde. Alex Chilton, Cramps, Gun Club, Fleshtones, X, Dream Syndicate et autres babioles éruptives que je vous laisse découvrir. Oui je sais, je puis être cruel.
Troisième reprise : chez cette bonne chère old british grand-mère : l’on commence fort, vingt-cinq pages sur les Barracudas, l’on épluche la disco à fond morceau par morceau, une seule raison à cette attention soutenue, un vrai groupe de rock and roll ! En plus avec les barac ( sans frites ) et Chris Wilson on n’est pas loin des USA. C’est après due ça se gâte. Je ne parle pas du choix : n’est-ce pas notre cat Zengler kr’tntique qui nous a présenté ici même Undertones et Nikky Sudden ! C’est le rock lui-même qui se retrouve en quarantaine : Wilko Johnson et Dr Feelgood, Prisonners, Sting Rays, Milkshakes, une tragédie, les rockers sont des outlaws rejetés dans les marges. Une lente mais efficace dégradation, ou vous tapez aux portes des majors et vous acceptez un remodelage total, un relookage intégral, ou vous survivez dans un anonymat sans avenir. Tristes perspectives.

Quatrième donne, dix pages pour les Suédois et Nomads, mais soixante-dix pour les Australiens, Radio Birdman, The Saints, des cadors, mais nous terminerons avec les vingt pages prémonitoirement hommagiales dévolues aux Dogs, la revue leur doit beaucoup puisque Nineteen est un titre de leur premier quarante-cinq tours. Un bel article qui raconte les Dogs, un récit captivant par lequel Monique Sabatier a su exprimer la fiévreuse indolence si particulière du groupe, aujourd’hui mythique. Un complément indispensable au livre que Catherine Laboubée a consacré à son frère ( in KR’TNT ! 155 du 12 / 09 / 2013 ). L’on retrouve dans ce final la quintessence des choix esthétiques qui ont présidé aux destinées de Nineteen, le rock and roll vécu en tant qu’intransigeance existentielle mégaphonique.
Répétez la chanson : I’m waitin’ fot my Nineteen, twenty-five euros in my hand !
Dose addictive de plus de 400 pages. L’abus de cette médecine non remboursée par la sécurité sociale est chaudement recommandé.
Damie Chad
BOWIE
L’AUTRE HISTOIRE
PATRICK EUDELINE
( Edition de La Martinière / Mars 2016 )

Depuis trois mois c’ent l’inflation. L’on ne compte plus les numéros spéciaux consacrés à Bowie, ni les livres. Encore un tout nouveau « Spécial Bowie » ( pas très beau ) ce matin dans le kiosque à journaux ! Heureusement que Prince vient de disparaître, l’on va enfin pouvoir changer de disque. Certes Bowie est une importante figure de la rock music, mais méfions-nous des hagiographies et des thuriféraires. Tresser des couronnes funéraires à Bowie n’est pas un acte gratuit. Les chacals font de l’argent avec tout. Tant que le menu peuple est prêt à débourser, pourquoi se priver. Surtout que l’exemple vient du Maître. N’a-t-il pas, lui le Héros adoré, eu la bénéfique idée de faire coter la marque Bowie en bourse ? Ce qui s’appelle ensemencer son sillon au plus profond. Notons que Patrick Eudeline revendiquait en un précédent ouvrage le fait de faire payer la moindre ligne issue de sa plume. L’asservissement salarial est une contrainte pour beaucoup, personnellement je ne l’érigerai point en philosophie.
Ceci étant posé, Patrick Eudeline possède quelque légitimité de krockniqueur distingué à discourir sur Bowie. Nous ne la remettrons pas en cause. Reste à savoir quelle autre histoire il tient à nous raconter. L’amateur de l’œuvre du Thin White Duke n’appendra rien de nouveau. L’histoire est connue. La carrière fouillée et refouillée depuis des lustres. Mais tout est question d’analyse et de mise en perspective. Changez l’éclairage, et une statue ne possède plus la même stature.

Hormis le prologue consacré à la disparition de l’Artman, le livre épouse la continuité chronologique. Nous pourrions la diviser en trois grandes parties : tâtonnements, accomplissements pour les deux épisodes du début. Affaissement pour le dernier. Nous commencerons par cette fin peu glorieuse. Jusqu’à la parution de Scary Monsters ( and Super Creeps ) la trajectoire de Bowie est un sans faute. Nous sommes à l’orée des années quatre-vingt et les deux décennies fabuleuses sont terminées. Au mieux, du bout des boots vous admettrez Let’s Dance ( 1983 ), mais pas plus. Après, Bowie a perdu le fil et la grâce. Ne produit plus que la daube. De la merde noire, pour rester poli. Le magicien ne sait plus saisir l’esprit des temps. A côté de la plaque. Le visionnaire ne perçoit plus rien. Faudra attendre vingt ans d’errements et de silence pour que Bowie puisse rétablir le contact. Non plus avec le monde, mais seulement avec lui-même. Se concentre sur son égo, à la Stendhal. Lucidité de la mort qui s’approche, les dernières forces d’un corps déclinant jeté dans la bataille. Ne lutte déjà plus contre le trépas irrémissible mais fonde son espoir en la Résurrection. Lazarus sortira bien un jour ou l’autre de son tombeau. Genre d’espérance cryogénisée qui ne coûte pas cher. Cela dépend de votre fortune. Le serpent du fric se mord la queue. Un monde neuf après le prochain âge de glace. Vous avez le droit de ne pas aimer ce genre de film.
Reste à reprendre le chemin pour comprendre. Une enfance étriquée mais heureuse, un beau-père qui écoute du jazz, la beauté de Jim Bowie dans Alamo, l’irruption d’Elvis le Pelvis dans cet univers confortablement insatisfaisant, une prédilection pour le blues. David Jones ne diffère en rien de la génération montante des baby-boomers qui formeront les contingents des hordes mods. Pas des sauvages, pas des barbares, le scooter remplace la moto, bye-bye the bikers, surtout la composante à laquelle appartient David, un peu effet minet, la sape avant tout, paraître afin d’être. Un but devenir une Face, un de ces semi-anonymes du mouvement, ces héros d’un jour qui indiquent la tendance vestimentaire à suivre. Ce qui n’empêche pas une tête bien faite, lit beaucoup, parfait sa culture cinématographique, s’adonne au mime, au théâtre, Revolver le révolutionne, se sent la capacité d’un autodidacte absolu assez doué pour embrasser tous les rôles. Mais se prend au jeu souverain du rock and roll.

Veut être chanteur. Pour être devant. Pour que tout le monde le regarde. Ce qui satisferait son nombrilisme. Pas obligatoirement les filles. Ne les dédaigne pas. Se mariera même avec Angie, mais ses préférences vont aux garçons. Plus tard il changera, mais Bowie à passé sa vie à métamorphoser ses apparences et ses désirs. Lorsque au début des années 70 il revendiquera sa bisexualité, il fait preuve d’un courage remarquable. Aujourd’hui c’est plus qu’une mode, une véritable tendance, mais à l’époque il risque sa carrière. Le vrai pourfendeur des tabous et des totems ne sera pas Freud mais Bowie.

S’adonne aussi à d’autres plaisirs défendus - comme l’immense majorité de sa génération - commence par fumer quelques pétards, y prend goût et décline toute la gamme, héroïne, cocaïne, premières moutures du crack et toute la suite… Le cerveau un peu fumeux, plus vraiment les pieds sur la terre, dans les nuages - les merveilleux nuages dixit Baudelaire - et lévitation cosmique jusqu’à l’astre sélénique, l’homme vient de marcher sur la lune et Bowie crée son premier avatar. Major Tom. Sera suivi de nombreux autres. Bowwie n’est plus Bowie, je est plusieurs. N’est pas le roi lézard mais il peut tout faire. Le succès planétaire de ses disques en apporte la preuve tangible. Lit Crowley et Nietzsche, l’aube dorée de la surhumanité approche à grands pas. Bowie déraille, il est le Surhomme, peut-être pas l’extra-terrestre mais sûrement le terrestre extra, de la phalange des supérieurs connus, jours troubles, cite Hitler, fait le salut nazi, voit des soucoupes volantes et se coupe de la commune humanité qui continue à l’aduler. Tripatouille le rock, le mène aux limites de la matière sonore, l’est le novateur, le növoteur dirait Yves Adrien… Bowie fascine et se permet toutes les outrances.
Suivront les années de déshérence. Bowie la créature fabuleuse redevient un homme comme tous les autres. Fait de la peinture et se souvient d'avoir fait un enfant. Exit sosie Zowie. Le veut tout à fait normal, l’on aurait aimé un mutant, un monstre, on ses serait même contenté d’un mongolo acéphale, mais non lui façonne des prénoms de calendrier pour qu’il soit comme monsieur tout le monde. Bowie nous déçoit, lui qui a su ré-insuffler une énergie sans égale - les esprits lucides parlent d’un grossier badigeon - à Lou Reed et à Iggy Pop, se retrouve placardisé de par sa seule volonté. L’histoire du monstre qui se transforme en souris avant de se faire manger par son propre chat.
S’en sort par une dernière farce et attrape. Parvient à orchestrer sa propre mort. Part en fanfare. Sur ce coup-là il nous refait le coup du Sergent Pepper. Avec quarante ans de retard. Beaucoup trop pour Bowie. L’a essayé de ne pas mourir tout à fait. N’est même pas parvenu à ne pas vieillir. Le pire c’est qu’il y a de fortes chances pour que nous ne réussissions point mieux que lui.
Damie Chad.
08:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stereo total, sugar bones, eddie cochran-tony marlow, david bowie- patrick eudeline



Les commentaires sont fermés.