08/04/2015
KR'TNT ! ¤ 230. ROCKING FOR ERVIN with NESON CARRERA & THE SCOUNDRELS / ATOMICS / ALAIN CHENNEVIERE / CHRIS EVANS / BE BOP CREEK / TONY MARLOW / VIKTOR HUGANET / DON COVAY / EARLY SIXTY ROCK 1N VAUCLUSE
KR'TNT !
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME

LIVRAISON 230
A ROCK LIT PRODUCTION
10 / 04 / 2015
|
NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS / ATOMICS / ALAIN CHENNEVIERE / CHRIS EVANS / BE BOP CREEK VIKTOR HUGANET / TONY MARLOW DON COWAY / EARLY SIXTY ROCK IN VAUCLUSE / |
04 / 04 / 2015 / LE PICOLO
SAINT-OUEN ( 93 )
ROCKIN' FOR ERVIN

Mille sabords ! Mister B va le jeter dehors ! Son portable ! Le misérable ! Quatre fois qu'il nous fait sortir et puis reprendre la même bretelle d'autoroute ! Recalcul de votre itinéraire, mon cul, il y a qui se perdent, des coups de pied dans le derrière ! Tant pis l'on fonce tout droit ! Grande victoire de l'esprit humain sur la machine. Un saut de Puces, et hop nous voici à Saint Ouen. Inutile de prier, dieu est mort.
Trente ans que je n'avais mis mes guêtres dans le dédale. Ça a bien changé ma bonne dame ! M'en parlez pas, la dernière fois m'étais trouvé sur un étalage à côté d'Hugues Aufray, depuis doit avoir la voix chevrotante notre skiffler ! Eh oui, n'est plus très frais ! Sept heures et demie du soir, ca remballe sec, ça baisse les rideaux, et ça trimballe des amoncellements de poubelles sur les trottoirs. Les devantures sont repeintes à la mode rap et hip-hop, dire qu'avant c'était banané de rockers impénitents ! Lost Paradise, Milton nous avait prévenus !
Subsiste des points de résistance, le Picolo par exemple. Rien qu'au nom, l'on comprend qu'on n'y picole pas que de l'eau. Un rade comme l'on n'en fait plus, une terrasse, une salle avec comptoir sur la gauche, une deuxième salle en contrebas, une scène qu'il faut traverser pour atteindre les cuisines backstages. Un escalier en spirale dans le coin qui vous emmène je ne sais où. Ce n'est pas la Scala de Milan, mais tant qu'il y aura des rockers assoiffés, ça durera plus de mille ans. Ce n'est pas bâti en marbre de Carrare, mais ce soir ça regorge de rock and roll stars.
ROCKIN' FOR ERVIN
Huit heures pile : brève introduction de Tony Marlow qui nous donne quelques nouvelles d'Ervin qu'il a eu au téléphone et qui nous salue. Ce n'est pas la grande forme, mais déjà à pied d'oeuvre en Allemagne et a commencé sa batterie de tests. Encourageant mais pas la super joie. Va falloir scier les barreaux de la maladie à coups de lime et ce sera long. Et coûteux. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, la recette de la soirée sera reversée entièrement à l'association Lyme – solidarité Ervin Travis. Comme dira Alain Chennevière, chacun apporte son écot et les musiciens l'écho de leurs voix et de leurs instruments.
Un fond de tristesse dans l'assistance pour Carl Da Silva qui est parti très tôt, mais beaucoup de retenue et de discrétion. Respect et émotion.
NELSON CARRERA & THE SCOUNDRELS

C'est le bateau amiral de Nelson Carrera qui ouvre le feu. L'a posté ses deux malandrins, Georges à la doublebass et Raph à la guitare, avec ces deux-là il n'a besoin de personne à la batterie. Question rythmique, ils savent tricoter. Commence par Love is a trap – l'a bien raison, un véritable traquenard mais l'on aime sentir le piège se refermer sur nous. L'on pourrait écrire un livre de philosophie sur nos contradictions, mais Nelson nous en en raconte davantage qu'un traité de cinq cents pages avec ses seules inflexions mutines et ses faux apitoiements de tragédie antique. Toute la magie du rockabilly dans sa voix, l'espiègle gravité des situations mises en relief mélodique, mais le chant qui brûle comme une lame de rasoir. Du grand art. L'on est toujours surpris de la performance vocale de Nelson, prend des routes inattendues, nous amène aux antipodes de nos certitudes. Pas plutôt commencé que déjà terminé. N'a pas dû faire plus de dix morceaux.

J'avoue que j'ai aussi concentré mon attention sur Georges. Magnifique boulot. Caresse bondissante de swing. Aux abois, véritable chien de chasse qui court après le sanglier et ne le lâche pas d'une patte. Du souffle et de la hargne. Ne s'économise pas. Beau duo avec Raph, le piqueur qui retient et harcèle, qui vise et qui tire, un jeu très différent de celui dont il use avec les Atomics. Nelson demande à Red Dennis de se mettre aux drums, peaufine sur deux morceaux deux légèretés aériennes qui s'en viennent se mêler à la subtile alchimie des Scoundrels, d'une manière si pertinente qu'il devient évident qu'il fallait taper avec cette délicatesse sans faille.
THE ATOMICS

Ne mettent pas des heures à trancher la mortadelle. Dès l'intro Raph sonne comme Buddy Holly, mais électrifié comme le petit gars de Lubbock n'a jamais eu le temps de le parfaire. Préférait jouer sur la mise en avant de sa voix, laissant en background toute l'influence noire de sa musique. Le set des Atomics sera une montée progressive vers l'apocalypse. Du bop des Appalaches à la résurgence du jungle sound sublimée. Les trois derniers morceaux se termineront sur des salves nourries d'applaudissements approbateurs. Un Chuck Berry revisité en profondeur, non pas pour le plaisir de faire étinceler un riff accrocheur, mais pour faire luire le bleu-noir luisant des origines du rock and roll.

Fallait les voir, Francis pulvérisant les lignes de basse, transformant le ronronnement régulier de sa big mama en salmigondis de loopings de grand huit, Pascal s'embarquant sur ses drums en des fricassées de figures de plus en plus complexes et Raph qui nous sert des rissolées brûlantes de guitare grondante. Les Atomics ont sorti le grand jeu, un show presque expérimental, qui tente de repousser les limites de l'orthodoxie rockabillesque. Le rock comme on l'aime, borderline, flirtant avec le côté sombre de la force obscure. Un rock aventureux qui ne se contente pas des coteaux modérés de l'autosatisfaction de la perfection accomplie. Ne servent pas le côté bien léché du teddy bear. Essaient de capturer l'animal en sa force brute, sauvage, et point du tout apprivoisée. Un trio qui se remet en question à chaque set. Qui reprend l'histoire là où ils se sont arrêtés la fois précédente et qui pousse l'écriture un peu plus loin. A work in progress qu'ils n'ont manifestement pas le désir de clore de sitôt.
ALAIN CHENNEVIERE

Red Dennis à la batterie, Gil Tournon à la contrebasse, Tony Marlow à la guitare, Alain Chennevière au micro. Première fois que nous le chroniquons dans KR'TNT !, l'est pourtant une légende, l'était dans les Alligators – groupe phare de la naissance du mouvement rockabilly français qui ouvrirent en 1980 pour Eddy Mitchell – spectacle Olympia, le grand Schmoll y fête ses vingt ans de carrière - fut aussi dans le groupe local Pow-Wow qui se tailla une décennie de gloire dans les nineties... un curriculum vitae de plusieurs pages. Mais avec en prime des illustrations car Alain Chennevière dessine, fait de la bande dessinée, peint, expose. Pour rester en pays connu nous citerons la pochette du premier CD des Ghost Highway due à son pinceau prolifique...

Un monsieur qui possède plusieurs cordes à son arc et au moins trois octaves dans ses vocalises. N'ont fait qu'une rapide répétition, mais il n'a qu'à ouvrir la bouche pour comprendre que c'est déjà gagné. Une voix d'or. Une voix de rêve. Une voix de crooner. Un véritable don des dieux. Vaut mieux que vous ne connaissiez pas, vous en deviendrez jaloux. L'a l'organe moelleux comme une crêpe chaude au sirop d'érable. Peut le durcir et nous tringler en fin de set un Dactylo Rock de derrière les machines à écrire et un Lotta Lovin enjoué. Mais s'est construit un répertoire ad hoc. Un Johnny Cash en début juste pour montrer qu'il a un timbre aussi caverneux que le roi du country, et puis un florilège de douceurs, de ces friandises à la Presley qui sont devenues les proustiennes madeleines de plusieurs générations. Du Teenager in Love, du I need Your Love Tonight, de la barre chocolatée de quinze mètres de long que vous avalez jusqu'au trognon. Pur sucre. Et le tout servi chaud brûlant et fondant, avec la classe du parfait gentleman, souriant, à l'aise, séducteur dans son habit noir...

N'oubliera pas de remercier ses accompagnateurs qui lui ont surfilé, cousu main, un accompagnement de brocart et de satin. Pas le rock pur et dur, mais les déclinaisons adolescentes des années soixante. Pas le whisky des scènes de saloon juste avant que les colts n'aboient mais le muffin chocolaté à la framboise accompagné d'un cacao velouté.
CHRIS EVANS

Une mine de jeune homme. L'était pourtant déjà là, dans les startin'blocs, en 1977. Stéphane Mouflier a remplacé Red Dennis à la batterie. Chris a déjà joué dans la journée au Cidisc, mais il vient pour Ervin. Débute par un Memphis Tennessee qui recueille d'emblée la satisfaction du public et qui m'évoque en l'écoutant je ne sais pourquoi la version française de Danyel Gérard. Ne suis pas tombé à côté. Pour la majorité des titres qui suivront, Chris Evans présente et choisit une adaptation française du morceau. Signé de Long Chris par exemple. Parti-pris des plus courageux. Il est de si bon ton de se moquer des efforts des pionniers nationaux. L'on oublie un peu facilement que si ces gamins inexpérimentés mais emplis d'enthousiasme énergisant ne nous avaient pas fait la courte échelle vers les fruits interdits du rock and roll américains, nous n'y aurions jamais eu accès...

Chante en s'accompagnant sur sa Gretsch, nous étonne par sa prestance et sa mise en scène, les french tittles ne sont jamais ridicules, sa version de High Heel Sneakers transformée en Robe Rouge est des mieux venues et tient le vent. Mais n'a pas fini de nous étonner, nous affirme qu'il ne l'a pas chanté depuis longtemps mais il nous offre une splendide version de Baby Blue à pleurer. La bande à Marlow donne toute la gomme et vous martèle ce vieux blues comme Siegfried forgeant l'épée Nothung qui lui permettra de vaincre le dragon. Sera suivi un peu plus tard d'un Say Mama que les quatre vingt personnes personnes présentes dans la salle reprennent en choeur. Finit par une belle démonstration de rock français, le Nous Quand On S'embrasse de Johnny Hallyday aussi rapide et escarpée que la version de Gene Vincent. Chris Evans nous a convaincu de sa fidélité au rock et du tracé personnel de sa route. Un grand moment qui fut aussi un bel hommage à Ervin Travis via Gene Vincent.
BE BOP CREEK

C'est un mensonge, le mien. Uniquement deux membres de Be Bop Creek, Larry Beachlane à la caisse claire et Rocky à la contrebasse qui laissera pour un morceau sa place à Francis des Alley Cats. Tony est à la guitare au côté de Larry. Ne jouent pas longtemps, mais suffisamment pour voir que Be Bop Creek n'a pas choisi son nom au hasard. Saccadent du Be-bop plus près du Bop Street que de Lula, pour les connaisseurs qui comprendront. Le rock minimal à la Vincent et peut-être même avant tout le rock à la Gallup. La pliure rythmique, la systole primale incohérente, le cœur en suspension à chaque battement. Un tour de force pour Tony qui s'adapte au fur et à mesure des arrivées ponctuales. Faut improviser dans les trous, au quart de seconde près. Et tomber juste. Beau travail sur scène, mais dans la salle le micro de Larry n'est pas assez porteur, ne marque pas les temps d'arrêt de la voix un peu voilée qui apparaît comme trop fredonnante. Pas le temps de peaufiner les réglages, une chose est sûre, faudra les voir au complet et en pleine action quand ils passeront par chez nous.
TONY MARLOW
GILLES TOURNON / STEPHANE MOUFLIER

La pendule tourne. Les festivités doivent s'arrêter à vingt-trois heures trente, dernier carat. Nous les avons vus la semaine dernière en K'ptain Kidd, les voici tels qu'en eux mêmes. Effrayants. Speedés à mort. Course contre la mort. Slapin Gil – c'est ainsi que le surnomme Alain Chennevière – nous offre une démonstration de cordes aboyantes, ululant avec les loups, silhouette d'indien courbé sur le sentier de la guerre, danse de slap scalp. Stéphane Mouflier, part d'un principe simple : la batterie est un instrument bruyant. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je ne joue pas. Et je peux vous certifier qu'il n'est pas en grève. Une frappe à dérégler les sonotones de la planète. Tony Marlow – t-shirt Sex Pistols Tour sur la poitrine, serait-ce une indication sur le niveau d'incandescence minimum exigée – pousse au crime avec ses riffs ravageurs. Rock and roll troubadur ! Hymnes à la vitesse et aux motos grondeuses. Notons que certains jeunes du Club 59, motorbike rock mythique qui sont venus aider à préparer, à tenir la caisse, et à vendre disques et revues généreusement offerts par Jukebox Magazine, en soutien à Ervin, ne seront pas les derniers à s'agiter lorsque Tony imite le grondement des motocyclettes en furie.

Le groupe est chaud de chez chaud, lorsque retentit la basse intumescente de Gilles sur l'intro de Bird Doggin'. Nos trois lascars nous en livrent une version tsunamique, la meilleure que je n'ai jamais entendue en live. Une espèce d'oiseau-tempête qui se lève pour l'éternité. La salle reprend en chœur mais ne parvient point à recouvrir ce tonnerre d'orage qui fond sur nous et passe en nos cœurs comme une tornade ravageuse. Ce n'est pas le dernier morceau mais la balle en or du destin que le destin a mis de côté pour les rockers.

VIKTOR HUGANET
Onze heure vingt trois, l'heure de débrancher les jacks. Non, ultime surprise, ce sera Viktor Huganet, blondeur en bataille et guitare en main, sourire et joie de vivre en bandoulière, et pas le temps de finasser. Arpente la scène comme un tigre en colère. Alain Chenevière au micro. Pink Thunderbird et Johnny B. Goode, deux titres de feu que la guitare bousculante de Viktor enflamme avec une incomparable énergie. Dix petites minutes sur l'estrade, mais la trace fulgurante d'une météorite dans le ciel.

ROCKIN' FOR ERVIN
C'était tout sauf un concert de charité. Les artistes se sont donnés, ont essayé de se surpasser, tous réunis pour Ervin que certains n'avaient jamais rencontrés. Un public multi-générationnel, des vieux de la vieille jusqu'à des jeunes attirés par l'ambiance festive et remuante des concerts rockab. Deux énormes regrets tout de même, que Carl et Ervin n'aient pas été avec nous pour partager cette fête au rock and roll.
Damie Chad.
( Photos prises sur le FB de Martine Fifties )

UN DON AU CIEL

C’est à tous les coins de rue qu’on retrouve l’immense Don Covay : chez Steppenwolf, chez Etta James, chez Aretha, chez Ben E. King, chez Gene Vincent et Wanda Jackson, enfin bref chez tous les géants de la terre. Comme Chuck Berry ou Ellie Greenwich, Don Covay fut une usine à tubes. Il les pondait à la chaîne avec un petit sourire au coin des lèvres. Pour l’anecdote, Don Covay fut le chauffeur de Little Richard. Il composa ses premiers hits pour Solomon Bruke et Gladys Knight. Monsieur Covay ne se mouchait pas avec le dos de la cuillère. Et comme Bobby Womack, il refilait ses meilleures chansons à Wilson Pickett. Quand il enregistra «Mercy Mercy», le jeune Jimi Hendrix l’accompagnait et bien sûr les Stones en firent une version fidèle. Tout ceci n’est que la partie visible de l’iceberg.

Il enregistre son premier album en 1964 sur Atlantic. Inutile de dire qu’aujourd’hui on se l’arrache à prix d’or. C’est tout de même incroyable que les Stones aient craqué pour «Mercy Mercy», car on frise le groove gnan-gnan. Avec «I’ll Be Satisfied», la voix de Don se perd dans le fond du studio. Ah quel bricolage ! Hey you come on in, brame-t-il dans «Come On In» - Do you wanna date and have some fun ? - On est en plein dans l’excellence du superficialisme sixties - Come on in do the swim ! - Don joue les gros séducteurs, et dans «Can’t Stand Away», il chante même comme un castrat devenu fou. C’est en fin de face B qu’on trouve le hit que le monde entier attendait à l’époque : «Please Don’t Let Me Know». Après une merveilleuse intro, Don entre dans la danse de ce shuffle préhistorique, une vraie claquouille dans la gueule à la craquouille, une véritable fantasia d’énormité déviante, et voilà de quelle façon on tombe sous le charme de Don Covay.
Comme pas mal d’artistes signés sur Atlantic, Don Covay fut envoyé en 1966 en stage chez Stax par Ahmet et Jerry.
— Bon tu prends ta valise et ta brosse à dents et tu files chez Jim Stewart. Tiens voilà ton billet de train. Tu as six semaines pour décrocher un hit au Billboard. Vu ?
— Sure, boss !

Comme ce veinard de Don s’entendait bien avec Steve Cropper, ils composèrent «See Saw» ensemble. Accessoirement, «See Saw» donna un titre à son premier album et devint l’un des plus gros classiques de l’histoire du r’n’b. «See Saw» est en effet une énorme pièce de remue-ménage. Impossible de rester assis devant le meuble de la stéréo. On se voit contraint de danser le jerk au Palladium. Au passage, on note un détail important : dans la voix de Don, il n’y a ni colère, ni rage, pas la moindre trace de scream. Il défonce les annales de la postérité en douceur. On reste dans le joli groove sixties avec «Everything Gonna Be Everything», idéal pour danser au bobinard de la plage, devant le juke, en tongs, avec la copine bronzée en bikini vert d’eau - Hey hey c’mon a movin’ - Don Covay est incroyablement doué, il passe tout en douceur et en profondeur, sans jamais hurler - Shake it ! - Et puis en face B, on passe au joli groove funky avec un «Please Do Something» plein d’allant et de partance, bien swingué aux guitares, tendancieux car profondément insidieux. Il rend un bel hommage à Sam Cooke avec «The Usual Place» et revient à l’ivresse avec «A Woman’s Love» qu’il chante d’une belle voix de femme grasse. En fait, il sonne comme Smokey. C’est édifiant. On n’aurait jamais cru Don capable d’une chose pareille. Puis on tombe sur «Sookie Sookie», le hit rendu célèbre par Steppenwolf. C’est encore une fois co-écrit avec Steve Cropper. Voilà un beau groove noyé d’orgue, un vrai rêve de teenager en rut. C’est l’ancêtre du heavy groove d’Atomic Rooster - You better watch your step ! - Le dernier cut de l’album n’est autre que le fameux «Mercy Mercy» repris par les Stones sur «Out Of Our Heads», encore un joli groove de r’n’b racé et doux comme un agneau - Have mercy baby/ Have mercy on me - Surprenant de groovitude et de feeling vocal.
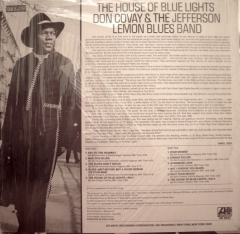
Avec Joe Richardson et JP Hammond, il monte le Jefferson Lemon Blues Band et enregistre «The House Of Blue Lights» en 1969. L’album est solide, mais pas déterminant. «Keys To The Highway» est un blues électrique très cuivré et Joe Richardson qui fut le guitariste des Shirelles joue le plus dépouillé des solos. Ils virent plus jazz pour «The Blues Don’t Knock» qu’une petite flûte tournoyante accompagne au long du chemin. Ça ne marche pas à tous les coups. John Hammond fait aussi partie de l’aventure. Il joue de l’harmo ici et là. Don revient au blues avec le morceau titre de l’album - Lord I was born in Mississippi/ Raised in Tennessee - John Hammond ramone ça à coups d’harmo, c’est nappé d’orgue et bien screamé. Idéal mais classique. Ravissant mais sans surprise. Don joue «Steady Roller» au pied, comme John Lee Hooker. C’est un fin renard car dans les transitions, il tape plus fort. Avec «Homemade Love», il va plus sur le r’n’b, mais les frontières entre les genres s’effacent puisque le r’n’b tire son jus du gospel. Don y va de bon cœur. Une nommée Margaret Williams vient mettre son grain de sel. Elle ramène tout le chien de sa chienne et ça donne une ambiance vraiment digne de Sly Stone. C’est ficelé au gospel sound avec toutes ces rivières qui font les grands ruisseaux. Puis on tombe sur «But I Forgive You Blues», un joli boogie blues à la Slim Harpo et voilà le travail.

Les seventies sont une bonne période pour Don Covay. Il reste sur sa lancée et enregistre des albums somptueux, comme ce «Super Dude I» paru en 1973. Au dos de la pochette, il pilote une moto et sa fiancée se serre contre lui. Photo magnifique sous un ciel chargé de menace. Don attaque par un «Overtime Man» qui sonne comme une bombe des Famous Flames. Quelle tarte dans la hure ! C’est travaillé aux trompettes et au groove de basse, alors qu’une mystérieuse wha-wha œuvre dans la pénombre. Plus loin, Don continue de tisser le groove qui fait sa légende. Il adore chanter les morceaux lents car sa voix mielleuse s’y prête bien. On revient à la belle soul funky avec «I Stayed Away Too Long». Il se montre une fois de plus exemplaire de vitalité. Plus loin, il nous pond un vrai hit de r’n’b avec «Hold You To Your Promise». Voilà la soul de première main à laquelle Don Covay nous habitue depuis les early sixties. Comme Sir Mack Rice, Don sait composer des hits fondamentaux. Au premier abord, ils paraissent simplistic, mais ils constituent le gratin de la soul de juke. On trouve «The Pinch Hitters» en face B, un petit groove de r’n’b gratté aux petites guitares funky. Et puis loin «Bad Mouthy» qui sonne comme un hit des Temptations. Il tarpouille aussi une version de «Money» à la façon de James Brown.
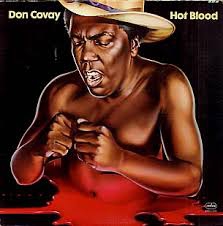
L’année suivante, il enregistre «Hot Blood» et démarre en trombe avec «It’s Better To Have (And I Don’t Need)», un joli groove de beat pressé et sacrément bien swingué à la charley. Don Covay se montre subtil et réconfortant. Il traite son groove avec humanité et ses amis jouent comme des princes. Sur les cuts suivants, les anges du paradis l’accompagnent. Si vous savez vous montrer patients, la face B vous récompensera. Car on y trouve «What’s Good To You», un groove de funk digne des Temptations, habilement violonné par derrière. C’est du grand Covay bardé de chœurs de sirènes. Attachez-vous au mât ! Puis il embarque «I Been Here All The Time» à la Marvin. Don Covay sait manier le groove angélique, pas de problème. C’est un enchanteur confirmé. Et voilà qu’avec «Hot Blood», il repond un hit séculaire. Plop ! C’est son destin, yo ! «Hot Blood» fait partie des hits du déficit des années antérieures.
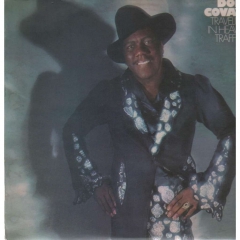
Don pose pour la pochette de «Travelin’ In Heavy Traffic». Il porte un costume brodé et un chapeau. On croirait voir l’empereur de la planète funk. Justement, il attaque avec deux monstruosités. «No Tell Motel», d’abord, the funk in the face, le beat des funksters qui ne rigolent pas. Les guitaristes fouettent leurs cordes et un bassman fou roule pour nous. Il s’appelle Michael Foreman et il joue comme un démon - You can boogie down - Encore plus endiablé : «Chocolate Honey», une véritable horreur de funk débridé. Ces mecs vont vite et derrière ça cuivre lourdement. Tout est sanglé serré et joué à la folie. Don Covay mouille sa litanie et chante la langue pendante. Il swingue un funk pulsé aux carbonates. Son cut est profilé pour vaincre, claqué à la dérobade de triplettes de basse et ça file sous le vent phillyque. Après, il revient au calme et à la good time music avec «You Owe It To Your Baby». Don transforme l’or du temps en or des philosophes et reste dans l’irréel.
Don Covay n’en finissait plus d’éblouir son siècle.
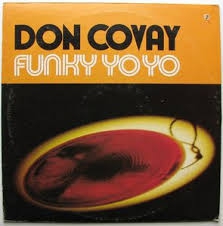
Au moment où les punks déferlaient dans les rues de Londres, Don Covay enregistrait «Funky Yo Yo», un album une fois encore terrible, ne serait-ce que pour les deux «Yo Yo», Part 1 & Part 2. Il revient en effet à l’épouvantable funky strut de soul. Il se savait sans doute destiné à yo-yoter le funk du sel de la terre - Say what ? - et il dialogue avec de sacrées gonzesses. Fabuleuse énergie ! Il repend son vieux «Three Time Loser» à sa façon, en mid-tempo dégoulinant de sensualité et tape ensuite l’un de ces petits rocks secs dont il a le secret, «An Ugly Woman», encore une tarpouille de beat grattée à la guitare funk, mais Don reste dans les clous du steady beat. Retour à Enormity Ends avec «Yo Yo Part 2», invraisemblable de furibarderie. Don le héros tape dans James Brown, cette fois et c’est pourri de cris de funk sisters qui jouent le jeu à fond. Pur génie ! C’est gratté à l’aune de la fournaise. Toute l’industrie de la soul s’agenouille aux pieds du géant Don - gimme som’ gimme som’ - Il devient irrépressible. Plus loin, il tape dans le rock’n’roll des instances supérieures avec «You Can’t Get Somthing For Nothing». Il sait chauffer la paillasse d’un hit, voilà sa botte secrète, sa facilité.

D’où sortait «Sweet Thang», paru sur un sous-label de Charly en 1985 ? Du ciel, probablement. On y trouve pas moins de quatre énormités, à commencer par «Why Did You Put Your Shoes Under My Bed» que Don le génie chante du menton, avec des heu ! à la James Brown. Il fait son funk uppercutiste rentre-dedans et tape en plein dans le mille. Il anime ça avec des petites montées de fièvre vicieuses et ô surprise, du petit scream, mais dans ce contexte surchauffé, ça s’impose. Il revient avec des uh ! de boxeur pour «Bad Luck». Pur funk de danse de cave de boum. On s’y croirait. Badoum badoum, cœur battant. Le funk de Don reste d’une brûlante actualité. Un pur régal pour l’amateur - Hard luck keep knockin’ at my door - Et on passe en face B au pur génie avec «Standing In The Grits Line». Don y cherche la petite bête de groove funky, il chante à l’énervée et reste dans un registre à la James Brown, avec une brin de déviance en prime. Son Grits Line vire à l’envoûtement. Voilà un cut terrible et généreux, barré et hypnotique, une pure merveille d’inventivité. L’autre pure énormité s’intitule «If There’s A Will There’s A Way», groove classique de blues-rock arrosé de coups de trompettes. Don s’y arrache la glotte et finit en screamer fou. Mais quand il tape dans le groove, Don redevient un ange de miséricorde. «In The Street Bye And Bye» suit un fil mélodique qui rappelle «Bridge Over Trouble Waters». Don chante ça avec une voix d’ange du paradis, un peu à la manière de Sam Cooke. Encore un groove de rêve avec «Daddy Please Don’t Go Tonight», finement teinté de country. Don est un être doux et cordial. Il sait se faire aimer des femmes et des blancs dégénérés.

Le dernier album de Don Covay s’appelle «Don Covay & Friends». Ronnie Wood dessinait la pochette. Don y invitait des bons amis du genre Kim Simmons ou Paul Rodgers, avec lequel il reprend son vieux hit «Mercy Mercy». Avec «One Stop Woamn», on retrouvait le groover captivant, le roi du doo-wop moderne. Il chantait «Nine Times A Man» avec Wilson Pickett et se montrait aussi royal que le petit Bobby. Don Covay et Bobby Womack ? Même combat ! Cet album sonnait de façon extraordinaire car il était bourré de versions sensibles de tous ses grands hits. Wilson et Don travaillaient le groove magique au feeling et poussaient des roucoulades brûlantes. Don enchaînait avec «Chill Factory», un groove jazzy haut de gamme. Puis il revenait à ses chères monstruosités avec «The Red Comb Song», accompagné par Huey Lewis. Don duettait à la dure et un nommé Frederick Knight venait déposer sa voix de castrat. L’autre très gros hit signé Don Covay, c’est bien sûr «Chain Of Fools» qu’il reprend ici avec Ann Peebles. Elle éclate la mélasse et Don pleure ses chaiiin. Il donne la réplique à la belle Ann qui enfouit ses chain chain chain entre ses cuisses d’albâtre. Nous voilà projetés au sommet du groove le plus pur. Ces deux-là nous font rôtir en enfer - C’mon darling c’mon ! - What you want ? I want some peentang ! Back to the funky strut avec «Peentang», encore un groove signé Covay - I want some peentang - Et Don s’adresse à son guitar man - Hey guitar man I want what you want ! - Quel festival, les gars ! Puis Wilson Pickett retape dans le tas avec «Three Time Loser». Il rebouffe le cut tout cru, pendant que Don le chatouille. Nous voilà une fois de plus projetés au cœur de l’un des plus beaux mythes de l’histoire.

La compile «Have Mercy. The Songs Of Don Covay» pourrait bien faire partie des disques indispensables. Hélas oui, un de plus. On se retrouve une fois encore en face d’un gros tas de dynamite. Eh oui, car ça commence avec le «Three Time Loser» de Wilson Pickett et on voit d’ici le désastre. Pickett lâche son gros batch de rock soul. Quelle pure merveille de raunch ! Cette énormité semble dater d’une autre époque. Pickett ramone le mid-tempo - one two three - il le fait rôtir aux flammes de l’enfer et on peut lui faire confiance pour le screaming. S’ensuit Aretha et «Chain Of Fools», pur genius de groove popotin avec des ahhh, des ohhhh et des chain-chain-chain. Et voilà, Don a déjà mêlé son destin à ceux de deux génies. Cet effarant festival se poursuit avec les Staple Singers et «This Old Town», un groove énorme. Ça prend des proportions terribles dès le premier coup de hanche car ça swingue sévèrement. Les Sisters y vont de bon cœur, elles éclatent le hit de Don, car elles sont des folles de swing. Personne ne peut les calmer. Dans le tas des interprètes de Don, on trouve aussi Solomon Burke et Little Richard. Mais aussi l’hallucinante pétaudière du Graham Bond ORGANization. Ginger et Jack Bruce jouent «Long Tall Shorty» à fond de train. On retrouve avec joie l’immense Chubby Checker pour «Pony Time», nouvelle énormité. On le sait, le vieux Chubby a toujours été un bon. C’est aux Wailers que revient l’honneur de taper dans «Mercy Mercy». Ils sont mille fois plus violents que les Stones. Awite et solo direct. Pas de fioritures. Parmi les autres grands interprètes, on compte Gladys Knight, Wanda Jackson, Brook Brenton, Ben E King et Connie Francis, excusez du peu. C’est à la petite Tina Britt que revient l’immense honneur de fracasser le vieux «Sookie Sookie» rendu célèbre par Steppenwolf. Elle n’en fait qu’une bouchée, normal puisque c’est le groove de l’éjaculation. Elle le chante à la pulpe, avec une audace indécente - Hangin’ in baby - Puis c’est au tour de Cliff Bennett & The Rebel Rousers de nous chauffer les oreilles avec «See Saw». Cliff sait ramoner le r’n’b, pas de problème. On dirait qu’il a fait ça toute sa vie. Il traite «See Saw» à la mode de Londres et quelle mode ! Plus loin Gene Vincent fait son chant du cygne avec «A Big Fat Saturday Night». La bonne surprise de cette compile, ce sont les Rollers avec «The Continental Walk», un heavy jive de juke - Let’s go now - un hit sous tension comme on les adore. Avec «She Said Yeah», Joe Tex tombe dans le panneau de la pop, mais il chante avec une telle énergie qu’on lui pardonne, car il transforme la pop en pure magie. Joe Tex est un monstre de talent, ne l’oublions pas. C’est à Millie jackson que revient l’honneur de fermer la marche avec «Watch The One Who Brings You The News», une pièce de r’n’b terrible. Elle y va la Millie, et elle a raison, car le cut de Don est bon comme le pain qui sort du four.
Signé : Cazengler, le bi-Don
Disparu le 31 janvier 2015
Don Covay & the Goodtimers. Mercy ! Atlantic 1964
Don Covay. See Saw. Atlantic 1966
Don Covay & The Jefferson Lemon Blues Band. The House Of Blue Lights. Atlantic 1969
Don Covay. Super Dude. Mercury 1973
Don Covay. Hot Blood. Mercury 1974
Don Covay. Travelin’In Heavy Traffic. Philadelphia International Records 1976
Don Covay. Funky Yo-Yo. Versatile 1977
Don Covay. Sweet Thang. Topline Records 1985
Don Covay & Friends. Cannonball Records 2000
Have Mercy. The Songs Of Don Covay. Ace Records 2012
LE ROCK C'EST CA !
ROCK & TWIST EN VAUCLUSE
( 1961 – 1965 )
JEAN-MARC QUINTANA

L'on avait beaucoup aimé Décélération Punk paru chez Camion Blanc en février 2012 ( voir KR'TNT 94 du 20 / 04 / 12 ). Jean-Marc Quintana y relatait les années punk en Avignon. Un témoignage de première main, bourré d'informations et de documents rares et inédits. Ne fit pas partie à proprement ( salement conviendrait peut-être mieux ) parler de ces maigres hordes de ces desperados cloutés et crêtés qui défrayèrent la chronique dans le seizième lustre du vingtième siècle, mais les a côtoyés et n'a pu s'empêcher d'éprouver une secrète et profonde admiration pour ces guerriers du nihilisme rock.
Années 60, l'arrivée du rock en France. Et d'un bébé ( août 61 ) – nous subodorons joufflu et ravissant, nous adressons nos félicitations à l'heureuse maman - prénommé Jean-Marc. Autant dire que Mister Quintana n'a vécu que de très loin cette période faste du rock and roll français. Question souvenirs personnels pouvait pas nous en mettre plein la vue. Mémoire aussi vide et sèche que le fond de son premier biberon. L'aurait pu se décourager avant de commencer. Eh bien non ! Les rockers ne se laissent pas abattre par la difficulté. S'est transformé en bénédictin. L'a épluché toute la presse locale, l'a fouillé les archives départementales, et est allé interroger les survivants. Précisons que le Vaucluse n'est pas un quartier de Paris mais un département perdu du sud de la France. Avignon, Orange, Carpentras, Cavaillon, si vous parvenez à situer ces quatre villages sur une carte nous vous offrons un an de lecture gratuite sur KR'TNT ! Le rock en Avignon en 1962, c'est un peu comme l'existence des tavernes alsaciennes en Patagonie du nord entre 1922 et 1928. L'aurait voulu nous pondre une monographie sur le Golf-Drouot, on lui aurait refilé l'adresse de trois cents copains qui y ont usé leurs soquettes. Oui mais le Quintana, ne s'est pas dégonflé, et à l'arrivée il nous refile trois cent cinquante pages agrémentées de trois cahiers iconographiques. Et attention vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
LE ROCK C'EST CA

Le rock c'est ça ! C'est le titre du premier vingt-cinq centimètres de Vince Taylor, chez Barclay. En France. Pas étonnant que Jean-Marc Quintana ait repris cette célèbre déclaration pour son bouquin. Point parce que Vince Taylor a fait deux petits tours dans le Vaucluse à la belle époque et puis s'en est allé. Mais justement parce qu'il s'en est allé se perdre, se faire pendre. Ailleurs. En lui-même. Puisque partout ailleurs, l'on n'avait point besoin de lui. La carrière de notre premier rocker national, qui rappelons-le était anglais même s'il aimait à se faire passer pour américain, est très symbolique de l'histoire du rock français. L'expression rock français est un oxymore, une conjonction improbable aléatoirement hypothétique qui n'a aucune chance de se réaliser. Un peu comme le bosom de Higgs dont on parvient à prouver son existence en le désintégrant. Même aujourd'hui, un demi-siècle après le début de la saga nationale l'on doit racler les fonds de tiroir pour présenter quelques têtes d'affiches capables de rivaliser en originalité avec les grands frères de l'autre côté des mers. Et pourtant la France fut un des pays où l'on a le plus mythifié le rock. Peut-être parce que nous ne sommes jamais parvenus à l'acclimater chez nous. A le faire pousser à l'air libre et en liberté dans les jardins grand-public . Ne survit que dans d'étroites serres chaudes de fans transis. Le rock français est une chimère dont l'exaltation nous permet d'entrevoir quelques trop brèves secondes l'éclat vénéneux de sa toison de lion.
Mais, car il y a un mais comme dans tous les contes à dormir debout, fut un temps où ce ne fut pas pareil. Entre 1960 et 1964, la France fut la nation rock par excellence, en 62 l'on possédait davantage de groupes qu'en Angleterre ! A écouter la légende, les Beatles auraient dû s'appeler les Scarabées et les Rolling Stones, les Pierres Roulantes. C'est ici qu'intervient Jean-Marc Quintana, en chercheur fou et passionné, s'est juré de forer la couche de glace qui recouvre ces temps heureux du rock français et de ramener une carocktte témoin afin de parfaire à l'édification des générations futures.
JOHNNY

Les comptes ronds faisant les bons amis, il serait légitime de se demander pourquoi notre auteur commence son récit en l'an de grâce 1961 et non pas en 60. Ne l'accusez pas d'ignorance, en quelques pages il raconte tout ce qui s'est passé auparavant. C'est à dire rien, si ce n'est les tristes pantalonnades de Boris Vian et de l'ensemble du showbiz franchouillard qui ne comprirent pas l'importance de l'ovni qui leur dégringolait sur le groin.
La venue de Johnny Hallyday le 20 avril 1961, fut l'agent de cristallisation et de propagation du rock and roll en pays vauclusois. L'était attendu par toute une jeunesse. Bien sûr l'on savait que le rock existait, qu'il était synonyme de folie, mais c'est comme une bombe atomique dont on ne peut mesurer et prendre conscience des effets qu'une fois qu'elle ait explosé. Vous me direz qu'après c'est trop tard, oui mais avant c'est trop tôt.
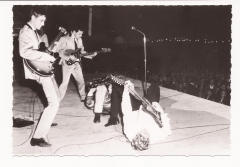
En 1961, Johnny possède une voix de crécelle et ses adaptations ( tout comme ses originaux ) sont – soyons gentils – approximatives. Oui, mais il y croit. De toutes ces forces. Et toute une génération supputait son apparition. Tout le monde en rêvait sans le savoir. Une ère nouvelle s'annonçait, le cauchemar des années de guerre s'estompait. L'était plus que temps de bousculer la tristesse des mortes saisons révolues. Et Johnny était l'étincelle qui mettait le feu à toute la plaine.
REACTIONS
Ceux qui le comprirent le mieux et le plus vite ne furent pas nos jeunes gens. Mais leurs aînés. Les articles des journaux que reproduit Jean-Marc Quintana vous transforment la minuscule souris d'un concert rock en Everest d'opprobre et de virulentes condamnations. Messieurs les journalistes ont la plume dure. Défendent leurs acquis et leurs certitudes. Le monde change de logiciel et ils s'accrochent à leurs strapontins. Ce sont eux qui désignent les équipes : les voyous, les sauvages, les barbares, les sous-évolués, les blousons noirs du côté des méchants et eux, et leurs goûts musicaux qu'ils qualifient de valeurs humanistes, dans le camp des sauveurs de la civilisation occidentale. Ni plus, ni moins.
EN CHAÎNE
Un malheur ne venant seul, après Johnny surgirent les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, et la brebis galeuse Vince Taylor. Mais un vol de microbes qui frôle un corps sain, le pourrit jusqu'à la moelle. Les chevaliers de l'apocalypse repartis, une armée d'imitateurs se lève sur le sol infecté : voici Bob Arnold et ses Black Boys, les Shark's, les Dan's, les Dragons, les Anges Noirs, les Dominos, les Aiglons, Alan Be... c'est la ruée vers le rock. L'on ne sait pas jouer, l'on ne possède pas de matériel, l'on transforme les postes de radio et les transistors en amplis, l'on bricole, l'on essaie d'électrifier la guitare acoustique, c'est un peu à la vas-y comme je te pousse, passe devant tant bien que mal, je te suis de mon mieux.

Et tout le monde s'y met. Des clubs pour accueillir cette nouvelle sorte de musiciens s'ouvrent de ci de là. Ce sont les organisateurs de concerts qui se frottent les mains. A l'époque le tour de chant n'existe pratiquement pas, les artistes se succèdent à la queue leu leu : chanteurs à voix, comiques, magiciens, jongleurs, tout ce qui gesticule fait scène. Ces groupes inconnus qui sont prêts à passer gratuitement sont une aubaine. En plus ils amènent du monde avec eux. Tous leurs copains. Un peu chahuteurs, mais qui mettent l'ambiance. Parfois le blousons noirs foutent un peu le souk, mais la police est là pour calmer les esprits. N'empêche que pour canaliser ces hordes remuantes mais nombreuses l'on sera amené à spécialiser quelque peu certains concerts, c'est ainsi que naissent les tremplins rock. L'existe aussi des concours plus généraux ouverts à tous ou à diverses catégories, avec éliminatoires, demi-finales et finales...
ROCK & TWIST

Lorsque l'ennemi est trop fort, vaut mieux ruser et pactiser. Le rock fait peur, on lui préfèrera un succédané : le twist. C'est une danse extrêmement conviviale qu'un enfant de trois ans apprend en trente secondes. Beaucoup plus démocratique et moins élitiste que les dures sonorités du rock. Donne l'impression d'être plus rapide que le rock, mais de fait c'est une musique qui arrondit les angles. L'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais la fureur du rock s'adoucit. Le twist s'impose aussi parce qu'il est un retour au chant, la plupart des groupes amateurs français s'étant lancés dans une espèce de surenchère musicale en s'adonnant à des orchestrations à la Shadows. La guitare électrique subjugue une large frange de la population, même quand l'on n'aime guère, l'on est forcé de reconnaître que ce sont de nouvelles sonorités que l'on n'avait jamais entendues avant.
GLISSEMENTS
Les groupes sont éphémères. L'appel sous les drapeaux agit comme un véritable couperet. Le mariage est la deuxième guillotine du rock français. L'on vend sa guitare pour offrir une machine à laver à sa belle. Certes les deux appareils sont électriques mais leur bruit est différent, ne jouent pas la même musique. Mais il reste des forcenés, des individus entêtés qui continuent. Progressent et au bout de trois ans de répétitions, de concerts, et d'entraînements intensifs l'on finit par savoir jouer. C'est une autre forme de piège, le musicos qui a débuté sur le rock et qui maintenant a acquis une certaine virtuosité aimerait se lancer dans des musiques plus complexes, moins frustres... Et puis si l'on veut devenir professionnel et croûter tous les jours, il faut tenir compte de l'évolution des goûts du public...
Du rock l'on est passé au twist. Du twist l'on va s'acheminer doucement sans à-coups au Yé-Yé. Les maisons de disques et les médias vont s'employer à faire accepter ces renonciations. Le Yé-Yé c'est de la variété avec un léger parfum rock, parfois indiscernable... En trois ans la donne a irrémédiablement changé.
IRONIE
Résultats des courses. Rien ne sert de courir, il faut arriver le premier. 1961 – 1965, le Vaucluse est touché par le rock and roll hurricane. Les premiers groupes de rock partent à la conquête de la gloire. A laquelle ils n'accèderont pas. C'est que le rock est un produit d'importation, bénéficie d'un engouement des populations locales pour les radio-crochets, les concerts, les tournées et les spectacles en direct, sous chapiteau ou sur la place publique. Mais la boîte à images pénètre en ces saisons-là dans les foyers populaires. Le public perd l'habitude de sortir, reste captif à la maison, c'est plus sûr, moins fatiguant... la télé n'admettra jamais le rock sur ses antennes, les rockers perdent une bataille qu'ils n'auront même pas livrés...
Ne soyons pas défaitistes, de tous ces jeunes vauclusois qui ont participé au maelstrom des années soixante, deux vont sortir de l'anonymat et atteindre à une gloire nationale pour l'un et internationale pour l'autre. Je vous livre les noms de ces deux rock and roll stars. Michele Torr pour la première. Et... Mireille Mathieu pour la seconde. Que même les japonais nous l'envient ! ( Pourquoi donc ne la leur a-t-on pas donnée ? ).

Jean-Marc Quintana enfonce le clou de l'amertume dans le pneu crevé de notre désespoir : le livre se termine sur Mireille Mathieu dans l'avion qui la mène aux States pour sa participation à l'Ed Sullivan Show.
AMERE POTION
Le Vaucluse ne représente que la centième partie des départements français. Un sur cent un, exactement. Quantité négligeable et statistiquement peu représentative. L'on est ainsi tenté de laisser Jean-Marc Quintina confit dans son Orange natale. Le malheur c'est que sa présentation sonne un peu comme une démonstration sans appel. Documents et témoignages en appui. A choisi la stratégie de l'effacement, ne promène pas son égo comme l'escargot sa coquille sur toutes les pages. Ne lâche pas la bride aux témoins de l'époque, refuse d'être le bureau des pleurs des occasions perdues ou le réceptacle des nostalgies de la jeunesse enfuie. Son constat lucide dégagé de tout romantisme n'en est que plus fort. La naissance du rock en France ressemble fort au récit d'une fausse couche. L'oiseau qui a couvé l'œuf du serpent qui le dévorera...

A lire. Ne serait-ce que pour les deux belles évocations de Vince Taylor et de Gene Vincent, qui restent les deux poutres maîtresses du rock français. Jean-Marc Quintana s'impose comme l'un des plus fins et plus lucides connaisseurs du rock hexagonal.
Damie Chad
P.S. : pas d'éditeur, se trouve facilement chez les grands distributeurs tel Amazon. Si vous êtes pour la survie des petites librairies de province, insistez auprès de votre libraire. ( 24 € / Beau papier glacé. )
22:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rockin for ervin, jean-marc quintana, don covay




Les commentaires sont fermés.