13/02/2014
KR'TNT ! ¤ 176 : EVERLY BROTHERS / KING BAKER'S COMBO / FOUR ACES / NO HIT MAKERS / ALL WILLIS & THE NEW SWINGTERS / THE SOUTHERNERS
KR'TNT ! ¤ 176
KEEP ROCKIN' TIL NEXT TIME
A ROCK LIT PRODUCTION
LITTERA.INCITATUS@GMAIL.COM
13 / 02 / 2014
|
EVERLY BROTHERS KING BAKER'S COMBO / FOUR ACES / NO HIT MAKERS / AL WILLIS & THE NEW SWINGTERS / SOUTHERNERS |
EVERLY FOR EVER
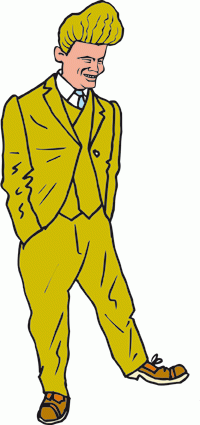
Jim Dickinson : «Pourquoi est-ce que Memphis n’a rien à voir avec Nashville ? Pour répondre à cette question, disons que Nashville est une ville d’entrepreneurs et que Memphis est une ville de renégats. Du coup, voilà ce qui se passe : les artistes de Nashville viennent à Memphis pour ‘se laisser un peu aller’ et donc faire ce qu’on ne leur permet pas de faire à Nashville, et beaucoup de gens de Memphis vont à Nashville vendre leur talent sur le marché. Ces deux villes sont aussi différentes que le sont New York et Los Angeles, alors qu’elles ne sont qu’à trois heures de route l’une de l’autre.»
On trouve cet éclairage dans «It Came From Memphis» de Robert Gordon. Mais on savait tout cela depuis longtemps. Depuis qu’on écoute les disques Sun produits par Sam Phillips et ceux des Everly Brothers produits à Nashville par des rednecks chapeautés. Côté Sun, on a la sauvagerie et l’invention d’un monde, et côté Nashville, on a la suite du modèle country conformiste qui ne fait pas de vagues. Et qui ne peut pas en faire. La réputation musicale de Nashville repose sur l’excellence des musiciens et le poli du son. Celle de Memphis, incarnée par Sam Phillips, repose sur l’inventivité. Une inventivité de choc, puisque les premiers morceaux d’Elvis enregistrés par Sam sur Sun n’ont pas pris une seule ride en soixante ans. La fabuleuse modernité de ces disques a traversé les décennies et continuera de les traverser, bien après nous. Depuis Sam et Sun, personne n’a jamais fait mieux. C’est bête à dire, mais c’est comme ça. Le monde entier connaît Elvis. Ce n’est certainement pas le cas de Hank Snow.

Le monde entier connaît aussi les Everly Brothers dont la carrière fut lancée à Nashville. Quand on écoute leurs premiers hits, on pense immédiatement aux Beatles à cause des harmonies vocales et au côté pop sautillante. Sur la pochette de leur premier album, on les voit tous les deux sur une moto, avec une guitare accrochée dans le dos de Don. Mais ce ne sont pas des Hell’s Angels. Ils sont à l’image de l’Amérique des années cinquante, rieuse et prospère. «This Little Girl Of Mine» est l’archétype du petit rock des jours heureux. Les voix des deux frères se confondent dans l’azur impénitent. Tous leurs hits pop sont encore aujourd’hui connus comme le loup blanc. Ils échappaient de peu au registre mielleux dans lequel se vautraient Pat Boone et Paul Anka. De très peu, car il faut bien admettre que les balades des frères Everly, souvent d’esprit country, provoquent l’ennui fatal. Sur leur premier album, ils proposent une belle ribambelle de reprises («Keep A Knocking», «Be-Bop A Lula», Rip it Up») dont on ne voit pas l’intérêt quand on connaît les versions originales pour le moins incendiaires. Il faut presque se forcer pour aller écouter la face B. «Wake Up Little Susie» est sacrément bien gratté. Voilà ce qu’on pourrait appeler un rock-pop des fifties sans engagement de votre part, à l’image des pelouses bien tondues. C’est l’Amérique bien propre et bien blanche qu’on entend, avec la voiture neuve garée devant le pavillon. Le rock aux oreilles bien dégagées et aux dents bien lavées. Et même si «Leave My Woman Alone» semble plus sérieux, avec son strumming diablement accrocheur, on reste sur une impression mitigée. Peut-on à la fois apprécier la pop des Everly Brothers et le rockab de Charlie Feathers ? Peut-on aimer les Beatles ET les Rolling Stones ? Stone ET Charden ? Bouvard ET Pécuchet ? Bien sûr que oui.
Aussi loin que je me souvienne, les Everly Brothers m’ont toujours ennuyé, mais j’ai toujours écouté leurs disques. J’en ai même acheté. Ils m’ennuyaient comme m’ennuient les films hollywoodiens à l’eau de rose des années cinquante et la country aseptisée de Nashville. Mais comme le dit si bien Chuck Berry : «Je ne crois pas qu’Elvis était aussi bon que les Everly Brothers, ni les Beatles.»
Si on les écoute, c’est en effet parce qu’ils sont bons. On finit par oublier l’Amérique de carton-pâte qu’ils incarnent pour ne s’intéresser qu’à leurs chansons et à la façon dont ils les chantent. C’est un style qu’on ne retrouve pas ailleurs, ni chez les Righteous Brothers, ni chez les Walker Brothers. Les frères Wilson, c’est encore autre chose. La belle pop joyeuse de «Claudette» finit par accrocher, car le morceau sent bon le lait fraise et l’ambre solaire, et on a tous vécu des périodes enchantées de vacances au bord de la mer où on ne se préoccupait que d’explorer les bikinis des copines en écoutant des conneries à la radio. Voilà ce qu’il y a dans «Claudette» (une chanson de Roy Orbison sur sa femme), du bon temps, des petites pulsions sexuelles et de l’insouciance à gogo. Un morceau comme «Like Strangers» est idéal pour s’endormir dans son fauteuil, et pourtant, ce fut un tube ! Même chose pour cette merde atroce qu’est «Let It be Me», pourtant connue comme le loup blanc. Plus c’était sirupeux, et mieux ça marchait. On ordonnait aux deux frères d’enregistrer ces slows lamentables et ils y allaient de bon cœur. C’est probablement l’une des raisons qu’on peut avoir de les détester. Puis on découvre qu’ils venaient d’un milieu si pauvre que tous les coups leur étaient permis. Amen. Sur les premiers albums, on trouve quelques bons morceaux qui font dresser l’oreille, et c’est pour ça qu’on a décidé de les suivre à travers le temps et les modes. «When Will I Be Loved» fait partie de ces morceaux sortis de nulle part qui accrochent bien. Voilà un vrai boogie du midddlewest. Toute l’énergie de leur Kentucky natal cavale dans ce cut indomptable. Belle allure, à travers la plaine. Ça y va. On peut même parler de fière allure, tellement ça tagadate. Un morceau comme celui-là, ça peut sauver une carrière. On retrouve ce strumming cavalant dans «Poor Jenny», mêlé à un léger parfum country et on regrette qu’ils n’aient pas rempli leurs albums de morceaux aussi racés que «Poor Jenny».
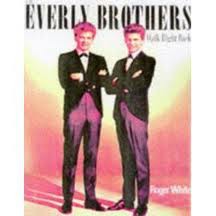
Un nommé Roger White leur a consacré un livre, et comme on s’en doute, il ne s’y passe pas grand chose. On peut même dire rien. C’est le même problème qu’avec Auguste Renoir. L’histoire de sa vie est d’une platitude affligeante. Par contre, l’histoire de Paul Gauguin, c’est autre chose. Il fait partie de ceux qui surent faire de leur vie une œuvre d’art. Ce qui n’est ni la cas d’Auguste, ni de Don, ni de Phil.
Phil et Don eurent la chance extraordinaire d’avoir un père guitariste, Ike Everly, qui était un musicien du niveau de son ami Chet Atkins. Leur seconde chance extraordinaire fut d’avoir Boudleaux et Felice Bryant comme anges gardiens. Les Bryant composèrent «Bye Bye Love» qui fut le premier hit des Everly Brothers. Pour la petite histoire, la chanson existait depuis un moment et elle fut proposée à une trentaine d’artistes (dont, paraît-il, Elvis) qui n’en voulurent pas. (On retrouve aussi le couple Bryant dans l’histoire tragique de Bob Luman.)

À leurs débuts, les deux frères se disaient admiratifs de Bo Diddley. Don : «Chet (Atkins) m’a montré comment accorder ma guitare en Sol et en Mi, comme Bo Diddley. (...) J’ai commencé à composer avec ma guitare accordée ainsi et le son des Everly Brothers vient de là.» Leur ascension fut fulgurante : en mars 1957, ils crevaient de faim et en décembre de la même année, ils vendaient deux millions de disques aux États-Unis et se pavanaient en tête d’affiche. Comme on s’en doute, ils étaient bien potes avec Buddy Holly qui composa «Not Fade Away» pour eux. Buddy savait que les deux frères en pinçaient pour Bo Diddley.

Les gens qui tiraient les ficelles à Nashville et qui pilotaient la carrière des Everly Brothers savaient très bien ce qu’ils faisaient. Ils tapaient en plein dans le mille puisque ces ballades et ces pop-songs plaisaient à la fois aux ados et aux parents. La vie de famille Everly était claire comme de l’eau de roche. Pas de scandale à redouter, comme chez Jerry Lee. Et comme Ricky Nelson, les deux frères affichaient une image de jeunes gens bien dans leur peau, sans histoires et professionnels jusqu’au bout des ongles. Et donc, les médias les adoraient. Leur image était tellement parfaite qu’on leur fit un pont d’or : ils signèrent un contrat d’un million de dollars, le premier du genre. On leur garantissant 100.000 dollars par ans pendant dix ans. Du pain béni.
Pendant un temps, Don se schtroumphait au speed. Ça n’eut pas autant de retentissement qu’avec Lemmy, on s’en doute. Don : «En ce temps-là, les gens ne savaient pas que les amphétamines étaient une drogue et qu’on pouvait développer une asdiction.» Don voyait régulièrement un speed doctor nommé Eddie Fisher. Comme Ginger Baker en Angleterre, Don prenait «des drogues sur ordonnance». Pas de problème avec les stup. Évidemment, on tombe ensuite sur le petit psychodrame de la désintox. C’est dingue ce que les gens peuvent être inconsistants parfois. Comme s’ils ne savaient pas quoi faire de leur vie.

En 1963, Don Arden fit venir les Everly Brothers en Grande-Bretagne pour une tournée «package» avec les Rolling Stones et Bo Diddley, mais comme les billets se vendaient mal, il dût appeler Little Richard en renfort. Ce que Phil et Don vont découvrir en Angleterre cette année-là va changer leur vie. Quand les journalistes leur tendent un micro, c’est pour leur demander ce qu’ils pensent des Beatles. Ils enregistrent «Two Yanks In England» à Londres et c’est la surprise : l’album est excellent. «Kiss Your Man Goodbye» préfigure les Moby Grape, c’est un psyché californien très haut de gamme et bourré d’énergie. On y trouve cette incroyable vitalité de l’unisson qui deviendra le fonds de commerce des Moby Grape. «Signs That Will Never Change» préfigure Love, avec sa mélodie softy et finement psyché. Mais c’est sur la face B que se nichent les perles rares. Avec ses grosses harmonies vocales, «Have You Ever Loved Somebody» sonne comme un hit fatal des Byrds. On sent que Don et Phil cherchent le nadir. Et ils le trouvent. Ils font une pop aussi lumineuse que celle des Byrds et des Beau Brummels. On sent l’essor, l’envolée des jours heureux. On les sent amateurs de magie vocale et c’est là où les Everly Brothers vont gagner leurs galons, comme on dit dans les casernes, et qu’il vont se tailler une réputation de duo culte, un peu comme Jan & Dean. Avec «Don’t Run & Hide», on revient au big californian sound. Les deux frangins font jerker les surfers. Ils plaquent des accords garage dans la canicule de l’été magique. Ils sont devenus très puissants. «Fifi The Flea» sonne comme un morceau tiré de l’Album Blanc des Beatles, rien de moins, et «Hard Hard Year» nous coupe littéralement la chique, avec ses chorus de guitare intrigants.

Si j’ai un conseil à vous donner, c’est le suivant : n’allez pas cavaler après tous les albums des Everly Brothers, parce que vous risqueriez de crever d’ennui en essayant d’en écouter certains. Sauf si vous aimez les ballades country bien roucoulées, évidemment. Sur «The Everly Brothers Sing» paru en 1967, on trouve trois ou quatre merveilles. Ils frisent le Mamas & The Papas avec «I Don’t Want To Love You». On les sent tentés par des registres plus pop et plus colorés et ils se mettent à gigoter pour de bon et à produire du vrai jus de juke. Mais il faut savoir apprécier la pop bien rose et bien fraîche. C’est la face B qui va vous réchauffer le cœur. «Mary Jane» croule sous la fuzz et les tablas et «Do You» sonne comme un artefact de la production hollywoodienne, car c’est d’une beauté formelle qui frise le kitsch. Ils enchaînent trois belles reprises, «Somebody Help Me (touillée à la fuzz), «A Whiter Shade of Pale» (version fantôme extraordinaire) et «Mercy Mercy Mercy» (r’n’b pourri de feeling).

«Pass The Chiken And Listen» est beaucoup plus country. «Women Don’t try To Tie Down» est un country-rock qui évoque le Buffalo Springfield. C’est chanté sous le vent et animé par des virtuoses du picking. Hélas, tout le reste de l’album bascule dans la country, sauf «Not Fade Away», solide comme un roc.

Quand ils sortent «The Price Of Love», ils ne sont plus à la mode aux États-Unis. Dommage, car ce fut leur meilleur titre, un joli rock tout en harmonies vocales, bien stompé et classieux en diable. Puis comme ça arrive parfois entre deux frères, ils commencent à s’envoyer des coups dans la figure. Et pif et paf dans le pif ! Alors, ils se séparent, comme le font les couples.

Ce genre d’incident est fréquent entre frères. On retrouve le même problème chez les frères Davies, ainsi que chez les Ramones qui ne s’adressaient plus la parole quand ils se retrouvaient assis à l’arrière du van qui les emmenait en tournée. Don monte les Dead Cowboys et s’en vient tourner en Europe. De son côté, Phil enregistre un album solo, «Star Spangled Springer», connu comme le loup blanc puisqu’il apparaît sur la pochette avec une tête d’épagneul. Je me souviens que tous les gens qui aimaient les chiens achetaient cet album. J’aurais préféré voir un cocker sur la pochette, mais finalement j’ai fini par m’habituer à l’épagneul. Le seul reproche qu’on pourrait faire à Phil Everly avec ce disque, c’est de chanter au lieu d’aboyer. Dommage. On aurait bien aimé qu’il jappe de la country. Pour ce disque, il a invité des tas de copains, du style James Burton et Duane Eddy. La plupart des chansons sont de belles mélodies romantiques bien léchées, et tant pis si l’image est tendancieuse, c’est de la faute à Phil. On note un petit regain de nervosité dans «It Pleases Me To Please You», mais il flirte avec l’insignifiance, et ce n’est pas nouveau. Les beaufs de Nashville lui ont appris à faire du gentillet, alors il fait ce qu’on lui a appris à faire. Et en plus ça rapporte du blé. Comme d’habitude, les deux bons morceaux de l’album se nichent sur la face B : «Poisonberry Pie» (petite pop bien tendue digne des Beatles) et surtout «Snowflake Bombardier», qui évoque des choses très bien chantées par des types du genre Sixto Rodriguez, avec cette belle voix perchée sur une mélodie qui étonne toujours plus à chaque réécoute. C’est extrêmement soigné et pas du tout destiné aux fans des Sex Pistols.

Après un break de dix ans, Phil et Don reforment le duo et débarquent en Angleterre pour enregistrer l’album de la reformation, «EB 84». Qui d’autre que Dave Edmunds pouvait produire un disque aussi chargé de sens ? Les Everly Brothers font bien sûr partie des héros de Dave Edmunds : «Dans le studio, ils ne se parlent pas. Pas un mot. Ils se regardent dans le blanc des yeux et ils chantent. Pendant vingt minutes, tu crois que ça ne marchera pas, que ce n’est pas la bonne chanson, et soudain, ça clique. C’est comme quand tu descend en chute libre et que ton parachute s’ouvre. Alors tu dresses l’oreille. Tu n’entendras jamais quelqu’un chanter comme eux. Ce sont les meilleurs. Ce sont des chanteurs naturels et ils sont les seuls que je connaisse. Tous les chanteurs que je connais, moi y compris, ont appris le thème musical et comment l’interpréter, mais Phil et Don ne travaillent pas comme ça. C’est fascinant de les voir travailler. Quand ils décollent, c’est du pur génie. C’est deux et deux qui font cinq et quand ça arrive, c’est fantastique.»

Cet album représente une sacrée tranche d’histoire de la pop. Tous ceux qui font des harmonies vocales se sont réclamés d’eux, principalement les Beatles et Simon & Garfunkel. Ils démarrent l’album avec «On The Wings Of A Nightingale» de Paul McCartney, rêve absolu de tout amateur de pop : gros son, orchestration soignée, harmonies vocales divines et compo solide. Cerise sur le gâteau : une production signée Dave Edmunds. «The Story Of Me» est le slow de circonstance, un truc hyper-produit singé Jeff Lynne et donc ELO, pas grand chose à dire sauf que c’est mélodiquement parfait. La grande majorité des Chansons de Jeff Lynne sont irréprochables, ce sont des bonbons parfumés qu’on suce dans sa chambre d’ado travaillé par le sexe. Pas surprenant qu’on ait retrouvé Jeff Lynne dans les Travelling Wilburys.
«I’m Takin’ My Time» fait mouche parce que ce morceau sonne exactement comme un hit de Dave Edmunds. Les deux frères parviennent tout juste à sonner aussi bien que Dave. Ils reprennent aussi «Lay Lady Lay» et la petite histoire veut que Dylan ait à l’origine composé cette chanson pour eux. «More Than I Can Handle», ça s’écoute sur le front de mer, sous un vent léger, au bras de sa copine d’école. Voilà la musique des jours heureux. C’est un véritable crève-cœur, la nostalgie peut tuer, tous les romantiques un peu trop sensibles le savent. Voilà un chef-d’œuvre de good time music et on retrouve cette facilité désarmante qu’ont les Everly Brothers à pondre du pur jus lumineux.

Il existe aussi le fameux concert de reformation, grâce auquel on peut entendre des versions assez spectaculaires de vieux hits qui nous paraissaient à l’époque tellement désuets. «The Price Of Love» et «Claudette» percutent bien. «Love Is Strange» rivalise de puissance avec les grands hits de Sonny & Cher. Magie pure des sixties. On retrouve une version sacrément musclée de «When Will I Be Loved», bon beat en douceur et en profondeur, assez proche de ce que faisaient les Beatles. Power-pop de goût supérieur. «Bird Dog», ce n’est pas «Bird Doggin’», c’est vrai, mais le morceau a tout de même une fière allure. On les sent beaucoup plus forts que les Ramones, par exemple, qui durent s’y mettre à quatre pour créer un monde. Mais on note au passage le grand nombre de déchets. Sur quinze titre, quatre sont bons. Le reste est un peu ennuyeux et on sent trop les racines country. Puis ils nous balancent des versions solides de «Gone Gone Gone» - bardé de gimmicks riches et fiévreux - et de «Bye Bye Love», qui éclate après l’intro on va dire mythique. Pas étonnant que Simon & Garfunkel aient repris ce tube dans leur set, cette pop-song insouciante et libre qui se balade dans les rues chaudes du rêve américain à la mormoille. On retrouve aussi le fameux «ouu-lala» de «Wake Up Little Susie», le gimmick le plus connu des temps anciens. Les deux frères savaient y faire.
Le pauvre Phil vient de casser sa pipe. Le cimetière du rock continue de se remplir et on risque d’assister dans les années qui viennent à un joli deathy-boom. On pense à tous nos héros et on leur dit secrètement : «Tenez bon les gars, ne nous laissez pas tomber.»
Signé : Cazengler, amateur d’Everlytrons
Everly Brothers. The Everly Brothers. Cadence 1958
Everly Brothers. The Fabulous Style Of The Everly Brothers. Cadence 1960
Everly Brothers. Two Yanks In England. Warner Brothers 1966
Everly Brothers. Sing. Warner Brothers 1967
Everly Brothers. Pass The Chicken And Listen. RCA 1972
Phil Everly. Star Spangled Springer. RCA 1973
Everly Brothers. EB 84. Mercury 1984
Everly Brothers. Reunion. Play 247 2007
Un livre couci-couça (pas de quoi se relever la nuit) :
The Everly Brothers. Walk Right back. Roger White. Plexus London 1998
LAGNY-SUR-MARNE / LONERS
07 – 02 – 2014 / KING BAKER'S COMBO
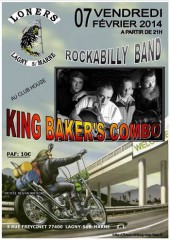
Re-local des Loners. Ca devient une habitude. De celles qui ont la vie rude. Même si Mumu notre GPS human-rock s'en tire plutôt bien, l'on pousse toujours un soupir de soulagement lorsque l'on aperçoit les flammes rougeoyantes et les étincelles volantes qui s'échappent des gros tonneaux placés devant l'entrée. L'antique pratique du feu de camp protecteur autour duquel se regroupe la horde primitive, aujourd'hui famélique et assoiffée des amateurs de rockabilly, est inscrite dans notre ADN culturel depuis la nuit des temps. Cet aspect de reconnaissance tribale est constitutif de l'imaginaire du rock'n'roll. Café chaud et sandwich réparateur engloutis nous sommes fin-prêts pour écouter le King Baker's Combo.
13 A LA DOUZAINE
Sont durs, les King Baker's Combo, ne nous donneront que la becquée pour ce premier set, treize malheureux petits morceaux et puis filent tout droit se rafraîchir au bar. C'est qu'ils nous laissent sur notre faim, ces treize pépites on les a avalées sans y penser, c'est fou comme on s'habitue aux bonnes choses, elles ne durent même pas une heure et l'on s'imagine qu'elles vont nous accompagner pour le restant de la nuit jusqu'aux incertaines pâleurs de l'aube.

Le grand barbu au fond c'est Jim. L'a une guitare pourrave qui a dû survivre à l'incendie de Rome aux temps reculés du divin Néron, une antiquité oui, mais une Gretch – déjà vous saluez – et le miracle c'est le son que Mister Jim arrive à en extraire – là l'on s'agenouille. Gratouille pas comme une andouille, le grand Jim, j'ai passé une bonne partie du concert à suivre ses doigts qui dansaient sur les cordes. Ce n'est pas du twang à toute vapeur, non c'est de la dentelle subtile, un toucher délicieux qui fait résonner les harmoniques à n'en plus finir. En plus c'est le roi de la vélocité, envoie sans tarder, et vous avez de temps en temps la guitare qui survole tout l'orchestre avec l'aisance d'un cormoran qui se rit de la tempête.

Carlos est aux drums, propre, honnête, efficace. Sonore et résonant. Pas besoin d'ébarber, le lingot est livré net de toute bavure. Un temps, un coup, un coup, un temps. Réglé comme une horloge suisse de précision. Plus les breaks qui font la différence. Cascade de coups de poings sur le tambour. Ne patauge pas dans la chair tendre, vise directement sur l'os. Là où ça fait le plus mal.

Vince est à la basse et à la base. Fournit la logistique rythmique à toute l'équipe. Trop occupé par sa contrebasse pour regarder les copains. Trime dur pour apporter la marchandise, mais l'on sent une expérience et un savoir-faire évidents. De la facilité même, ça galope tout seul. Sans arrêt, sans baisse de tension, une énergie sans cesse renouvelée. Cela s'entendra dans l'instrumental final qui arrachera des applaudissements nourris et des exclamations de joie.

Blanco est à la rythmique et au chant. Même sensation de rapidité que les trois autres, ne perd de temps entre les morceaux, devrait nous laisser savourer son interprétation de Long Blond Hair tellement bien roulée moulée qu'il ne pourra à la fin du morceau s'empêcher de signaler son contentement. Mais il a déjà remis cela, un Walkin' Talkin' Baby Doll des Three Ramblers et un Kitty Cat – d'après moi de Glen Glenn – suivront. Les King Baker's Combo revisitent des titres des petits (adjectif à consonances non péjoratives ) pionniers du rockabilly. Pas de chichi, ils distribuent franco de port, emballé sous vide et livré à domicile, entre vos deux oreilles. Ca nettoie les conduits auditifs et après cela, vous avez l'impression d'être devenu plus intelligent.
DEUXIEME DOUZAINE
Sont déjà de retour, un Buzz buzz pour faire le buz et ramener à l'intérieur les retardataires qui discutent dehors. Juste pour leur rappeler que s'ils tirent la clope ils peuvent fournir la boîte d'allumettes. De Matchbox l'on passe à My Little Sister, pas celle d'Elvis mais celle de Crazy Cavan qui fait de la mobylette à roulettes, ces deux morceaux étant joués davantage dans une optique rockabilly plutôt que pure Teddy. Le Long Black Train de Conway Twitty passe à toute vitesse sans s'arrêter, l'on aimerait bien y monter mais il est temps d'enfiler Blue Jean & Boy Shirt, encore une pierre précieuse de Glen Glenn. King Baker's Combo nous fait visiter tout le répertoire des seconds couteaux du rockabilly, ceux dont la postérité n'a pas retenu le nom mais qui sont devenus des figure-cultes chez les amateurs. Jusqu'à ce Trouble Up The Road de Jackie Brenston and His Delta Cats qui de fait fut le chanteur et saxophoniste de l'orchestre d'Ike Turner avec qui il enregistra ce fameux Rocket 88 chez Sun que certains s'obstinent à définir comme le premier disque de l'histoire du rock and roll.

King Baker's Combo se contente de cet âge d'or mythique du rockabilly. Vise à une certaine vraisemblance hommagiale sans se lancer dans l'harassante recherche du son Sun, perdu à tout jamais, car il ne faut pas oublier que même si vous parveniez à retrouver les instruments et le matériel d'enregistrement d'époque, il vous manquera toujours l'essentiel, la sensibilité générationnelle façonnée par une situation historique et économique propre à ces années d'après-guerre. L'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve du rockabilly. King Baker's Combo ne cherche pas à cloner le bon vieux rockab d'antan, ses membres essaient avant tout à restituer un état d'esprit intérieur qui leur appartient. Ils nous proposent leur lecture, leur vision, leur approche de ce phénomène sans prétendre à une parfaite reconstitution illusoire. Et il n'en faut pas plus pour notre bonheur.

Quatorze morceaux – il nous faudrait une grosse rallonge pour notre bonheur – pour ce second set, ce n'est guère plus, mais des membres de Crazy Dog sont dans le public et s'en viennent taper le boeuf. Notamment Eric à qui Hervé Loison avait confié la basse lors du concert de Hot Chicken, et le chanteur – j'ignore son nom - qui monte sur scène pour une superbe version de Jambalaya. Cadeau final et inattendu.
Un peu court tout de même, mais l'on en profite pour discuter le reste de la soirée... Merci aux Loners et à King Baker's Combo pour cette soirée.
Damie Chad.
( Illustrations prises sur le facebook des artistes ne correspondant pas à cette soirée )
ROCK 'N' BOAT / 08 - 02 – 2014
THE FOUR ACES / NO HIT MAKERS
AL WILLIS AND THE NEWS SWINGTERS
SOUTHERNERS / THE BE BOPS

La scène se passe sur la Seine. Nul besoin de faire la fine mouche et de sortir les pantoufles aquatiques, la Patache est amarrée au quai du Pont de l'Alma assez loin des pieds du célèbre zouave. D'habitude l'on y entend les flonflons du bal musette – typically french pour les touristes qui veulent regarder la culture française au fond des yeux – mais pour la deuxième année consécutive, ce soir c'est la grande kermesse rockabilly, le déjà fameux Rock'N'Boat. Deux jours, mais le second est consacré à la musique country. Pauvres amateurs de musique paysanne écartelés entre cette fiesta lacustre et le 7° Salon Country & Western sur les anciennes terres à blé, maintenant urbanisées, de Cergy-Pontoise.
Horaire particulier de boate de nuit : de dix heures du matin à deux heures du mat. Expo de voitures sur le quai – comme je n'aime pas rouler les mécaniques sous la pluie giboulante, je n'ai pas regardé - boutiques à l'intérieur. Beaucoup de fringues, un seul stand de disques qui sera fermé à une heure du mat lorsque je voulais me ravitailler en précieuses vinyliques rondelles... Tant pis pour moi !

Navire à fond plat, ce qui ne l'empêche pas de rouler et tanguer – de circonstance pour une journée rock and roll – par à-coups, ce qui vous donne l'impression d'être ivre sans avoir avalé une goutte d'alcool, à la réflexion nous tenons peut-être là une nouvelle méthode curative à expérimenter chez les Alcooliques Anonymes. Le bateau est plein comme un oeuf à la coque. L'on se presse dans les coursives, bananes et perfectos à foison, quelques teddies en costume, et toute une frange bobo recouverte de cuir noir des pieds à la tête, venue renifler de près la dernière tendance vintage, et qui bizarrement s'éclipsera très discrètement dès que les concerts commenceront. Si l'habit ne fait pas le moine, l'oreille distingue le rocker... En attendant, j'assiste aux balances des Four Aces, juteuse, et des No Hit Makers, prometteuse.
Dix neuf heures. A table ! La manoeuvre est assez complexe, d'abord vous achetez vos tickets, vous les présentez au comptoir adéquat, de charmantes jeunes filles écrivent votre prénom sur lesdits ticksons et descendent dans les antres du paquebot les apporter aux maîtres-coqs qui s'activent dans la cambuse. N'y a plus qu'à patienter que l'on appelle votre petit nom. Grand moment d'hilarité collective, entre ceux qui maudissent leur mère de leur avoir fourni le prénom que tout le monde porte, les derniers arrivés qui reçoivent leur casse-croûte avant les autres, ceux que l'on rappelle en vain, ceux qui ont été rayés du calendrier, et ceux qui exhibent de cocasses surnoms, un fabuleux désordre désopilant s'installe... Les langues se délient, des conversations s'engagent, de sympathiques regroupements s'effectuent, d'autant plus que dans ce joyeux brouhaha la distribution des provendes sustentatoires s'avèrera plus rapide que l'on aurait pu s'y attendre.

Mais l'estomac calé il est temps de passer aux choses sérieuses. Les Four Aces sont sur scène. Pas très surélevée, pas plus de vingt centimètre, c'est que le plafond de l'entrepont n'est pas très haut et je me demande ceux que doivent voir ceux qui ne sont pas aux premiers rangs. Heureusement que la sono est bonne et qu'elle crache bien.
THE FOUR ACES

Excellente idée de débuter par les Four Aces, un combo rock musclé et percutant qui d'emblée va élever le débat. Pique, Laurent est devant. En pointe. Des yeux de braise qui vous transpercent. La volonté à fleur de peau. Boucles à l'oreille et narines frémissantes. L'on devine l'étalon aux sabots de feu qui ne demande qu'à s'élancer dans la prairie infinie du rock'n'roll. Carlos frappe au carreau. Manière de vous saluer avant de vous y laisser dessus. Méthodique et incisif. Rien de trop, mais rien de moins. Vous cueille au passage. Dur et mat. Le son est plein et solide. Base sonore plus que rythmique, c'est lui qui donne son assise carrée au groupe. De tout coeur avec vous Marco, insuffle la rage sur sa guitare. Pulsation cardiaque ininterrompue mais avec de fantastiques syncopes labyrinthiques. Pas pour rien que sa guitare soit décorée d'un arianique filet rouge. Pendant que Carlos martèle, Marco vous prend par la main et vous fait visiter l'antre du Minotaurock. En connaît tous les détours et tous les raccourcis. Avec lui, vous n'êtes jamais perdu mais jamais en pays de connaissance. Il ne joue pas, il intervient. La guitare sur le fil du rasoir. Ne s'aventure pas, mais résout les problèmes. Ce n'est pas que les autres lui en posent, c'est qu'à chacune de ses interventions il invente une solution qui ne vous aurait pas effleuré l'esprit. La quatrième feuille du trèfle, c'est Malo. Il assure la balance, le sang noir du swing. N'a pas le temps de laisser brouter sa contrebasse. Lui fait raconter des histoires. Sombres et redoutables. Il ne sépare pas les temps, il les relie, instants par instants comme de minuscules facettes qu'il imbrique les unes dans les autres ce qui donne une impression de vélocité incomparable. Les Four Aces n'ont pas commencé un morceau qu'il est déjà fini. Mais selon un traitement définitif. Musique palpitante qui rougeoie de vie et de pétulance mais avec sa face noire et expéditive.

Laurent est au chant. Vit les morceaux de l'intérieur. Quelques gestes sobres, et il met en scène la tragi-comédie des lyrics, vous suivez le déroulement de l'action séquence par séquence. C'est l'intonation qui remplace le sous-titrage. Pas besoin de savoir l'amerloc, suffit de piger l'esprit du rock'n'roll. Et Laurent vous l'infuse à doses survitaminées. Amphétaminisées, car il vous arrache au démarrage et vous propulse droit devant pour la suite. Avec une facilité décourageante. Alors pour vous remonter le moral, il vous demande de lui tenir le crachoir sur Wild Little Willie par exemple. De Ronnie Hawkins. Mais il n'a pas vraiment besoin de nous. Se débrouillerait très bien sans. Beaucoup de reprises comme ce Cast Iron Arms de Roy Orbison ou Meaner than an Alligator de Johnny McGee mais sculptées à la mode Four Aces. La preuve en est donnée par les compos personnelles du groupe comme Bop the Blues, I'm Crazy About You, Tell me Baby, ou You'll never Stop qui s'inscrivent parfaitement dans la liste des hits brevetés d'époque.

Une vingtaine de titres plus tard et un rappel trop maigrelet au niveau de sa longueur, faut-il le préciser, l'on doit les laisser partir. Avec regret, car ils ont mis le feu et on les aurait gardés beaucoup plus longtemps. Deuxième fois que je vois les Four Aces et que j'en retire la même impression d'un rock maîtrisé de bout en bout. Percutant et offensif.

NO HIT MAKERS

Un nom de loosers, mais un son de winners. Les No Hit Makers sont sur scène. Formation classique. La caisse au fond, le chanteur devant, la basse sur votre droite et la guitare sur votre gauche. Puisque nous sommes sur un bateau nous commencerons par la section rythmique. Ont un look de pirate. De circonstance. De ceux qui montent à l'abordage le couteau entre les dents. Après avoir percé le fond de leur chaloupe car un set des No Hit Makers c'est du genre hissez le pavillon noir et pas de quartier. Le pire c'est qu'ils se marrent et qu'ils se tirent la bourre entre eux. Drummin'Dan – crâne rasé, teint sombre et oreille percée d'un anneau, pourrait jouer le rôle du méchant au grand coeur dans la fiancée du pirate – et Slap Bass Larbi – foulard rouge à la mode Caraïbe enserrant un sourire de forban sympathique - s'amusent comme des fous. Et je te rajoute deux coups de tom qui n'étaient pas prévus rien que pour vérifier tes réflexes, et moi je te bazarde deux zébrures de contrebasse torsadée pour voir si tu parviens à t'y retrouver. Non pas une fois, pour créer la surprise, mais systématiquement à la fin ( et même au début ) de chaque plan. En voilà deux qui s'entendent à merveille pour se repasser la patate chaude de la surenchère, écroulés de rire. Et le pire du pire c'est qu'ils évitent les pièges du copain avec une adresse diabolique. Cette manière de procéder ne nuit en rien à la cohésion du groupe, au contraire elle en sort renforcée.

Pendant que les facétieux gabiers caracolent dans les voiles, plus bas sur le tillac le quartier-maître ne plaisante pas. Est concentré sur sa tâche. Gretsch orange à la Eddie Cochran et lunettes à la Buddy Holly, Vince n'a pas l'esprit à la facétie. Le mec sérieux, qui ne s'écarte jamais d'un demi-degré du cap qu'il a déterminé à l'avance. La goélette des No Hit Makers file comme un air-craft. En pleine tempête. Houle déferlante et pluie d'écume, les notes pleuvent comme des bordées de canon, ininterrompues. C'est le secret des No Hit Makers, ne s'arrêtent jamais, et pour que ça dure plus longtemps Vince négocie les rafales sur son vibrato afin de filer encore plus vite sur la bande. Pas de hasard dans le jeu de Vince, il calcule les courbes au plus près. Intègre les imprévisibles variations funambulesques de sa section rythmique dans un cadrage rigoureux. Et à eux trois nos trois boucaniers font un boucan d'enfer. Fendent les flots à une telle vitesse qu'Eric ne s'apercevra pas que sur les deux premiers morceaux sa guitare rythmique est restée débranchée.

C'est qu'Eric est occupé. Il tient la barre. L'est au chant, et avec son équipage de gamins convulsifs et surdoués l'a intérêt à ne pas prendre de retard. Superbe voix, ample et généreuse mais surtout pourvue de splendides résonances mélodiques. L'est tout seul mais il semble que la voix ait été ovedubbée tant elle déploie une élasticité orchestrale étonnante. Quel organe sous sa casquette de poulbot ! Un air de mauvais garçon renforcé par l'anneau dans le lobe de l'oreille. Mais n'a rien de l'apache car il ne criaille pas. Du velours et de la soie. Une plasticité satinée étonnante qui lui permet de voler très haut sans jamais se perdre dans les aigreurs de l'aigu. Du miel, mais parfumé au piment rouge. S'agit pas de pousser la canzonetta à la Sole mio quand on est chanteur de rockab. Certes Elvis l'a fait, mais Elvis c'est Elvis. Et Eric s'est engagé à ne pas vendre son âme pour le seul plaisir d'engranger un hit qui fasse larmoyer les midinettes. L'annonce la couleur dès le premier titre, School of Rock'n'roll de Gene Sumer et ses Rebels, n'est pas du côté compassé des maîtres mais de celui de la luxuriance jouissive de la vie. Comme pour enfoncer le clou, ils termineront sur une version dévastatrice de Boogie Chillen de John Lee Hooker, la même demande, la même exigence d'une vie à bride abattue mais ô combien agréable !

Entre temps nous aurons eu un festival de pépites millimétrées au TNT, que ce soit des classiques comme l'intemporel All I can Do is Cry de Wayne Walker ou un morceau original comme Soldier of Peace à vous enrôler immédiatement dans les troupes d'assaut de la bonne parole rockabilly. Ah, cette emphase lyrique du son emmené par la cavalcade d'Eric ! Beau comme une robe d'appaloosa et percutant comme le grondement des sabots d'un troupeau de mustangs lancés au galop dans un canyon pierreux dont l'écho amplifie la rumeur transcendante de leur course effrénée vers la liberté.

Deuxième fois, eux aussi, que j'assiste à un concert – plus la participation impromptue d'Eric au boeuf final de Carl and the Rhthm all Stars au mois d'octobre dernier – et que je suis cloué sur place. Vu les applaudissements, je ne dois pas être le seul. N'ont pas la gloire, mais ils détiennent la puissance.

AL WILLIS & THE NEW SWINGTERS
Ne sont que trois sur scène. Minimum existentiel pour un groupe de rock, guitare, contrebasse, batterie. Maximum vital si l'on espère contempler le phénomène par le gros bout de la lorgnette. Ne sont que trois et je n'aurais pas assez de mes deux yeux pour les regarder. Trois mais chacun est un poème à part entière qui demanderait à être étudié séparément. Sûrs qu'ils ont de la bouteille, mais si le vin est bon il n'est pas interdit de s'en arroser le palais.

Al Willis. L'est tout frêle, les cheveux très légèrement grisonnants, derrière sa guitare. Sourire aux lèvres, doté d'une fine ironie, qu'il manie aussi bien à l'encontre de sa personne que de ceux qu'il croise. Un peu détaché du monde, en a sans doute trop vu pour être encore dupe de la comédie humaine. Je subodore un caractère à ne pas se faire de cadeau, impitoyable envers lui-même. L'on ne joue pas aussi bien de la gratte sans avoir été un cruel tyran envers ses propres renoncements. L'a dû bosser des jours entiers et maintenant il suffit qu'il tire sur une corde pour qu'elle sonne comme une sirène de tanker qui sort du port.

L'est pas tout seul, l'a choisi deux monstres de son acabit. Pascal Albretch est à la contrebasse ce que le bourreau est à sa victime. Un engin plutôt petit, mais ne l'a pas empoigné qu'il s'est mis à slapper comme un sauvage. L'image du Marquis de Sade assénant une terrible fessée à la douce et naïve Justine dans son boudoir s'est imposée à moi. Jamais vu ça. Qu'il aurait perdu ses doigts que ce serait pareil. La frappe de la main à plein battoir et à outrance. Ni pitié, ni relâche. L'a dû lui faire renforcer l'armature intérieure pour qu'elle résiste à de tels affronts. Une poigne de bûcheron, qui inflige un martyre à un pauvre instrument innocent. Et en plus il swingue à lui tout seul beaucoup plus que l'orchestre de Duke Ellington au grand complet. Dans le genre wild-wild-hot-hot certes, mais sans un gramme de monotonie. Ah la chienne de double-bass ! On l'entend jouir comme un éléphant en rut, descend les octaves et les remonte aussi sec. Elle barrit et elle tonne, elle barytone pire qu'à l'opéra.

Le géant qui écrase les futs de la batterie c'est Red Dennis. Pas n'importe qui. Son pédigrée ce n'est ni plus ni moins que l'histoire du rock and roll de ces trois dernières décennies. Me contenterai de dire qu'il était le batteur du groupe légendaire des Sprites, le premier french combo revival des années quatre-vingt spécialisé dans les reprises de Gene Vincent qui soit passé à la postérité. L'est en solo continu. Master-class ouverte à tous pour les chanceux que nous sommes. Il tape et il déchire. Il frappe et il nous lacère les viscères. L'est à la recherche de la note rouge. Rien à voir avec la larme bleue du jazz. C'est l'oeil de braise rougeoyante du rock'n'roll qu'il recherche. Il la traque, la poursuit, la cerne, la maintient prisonnière quelques instants pour la mieux laisser s'échapper, car il sait très bien qu'une fois prise et clouée à coups de maillets sur la peau de ses tambours elle s'étiolerait, se mourrait et disparaîtrait... Perte entropique qui serait due à l'immobilité, alors de ses bras et de ses muscles il verse des torrents d'énergie pure pour la maintenir en vie. Fait aussi travailler le cerveau, car il construit une architecture mentale afin d'édifier l'espace sonore nécessaire à l'impossible capture du feu follet.

Sont trois à s'escrimer comme des bêtes sur leur instrument. Semblent jouer en solitaires, mais tous trois contribuent à la tache commune. Les stridences de la guitare comme le battement effrénée de la double-bass et le baston à coups de manche de pioche de la drummerie. Deux qui foncent comme un train aveugle dans la nuit, et Al Willis qui modère et module la vitesse de la loco folle. Ils sont les rails et lui la vapeur qu'il relâche d'un doigt lorsque la cuve est prête à exploser. Brutalité et précision, les deux errements antinomiques du rock'n'roll.

Mais le set est encore d'une plus grande perversité. Que ce soit Pascal Albrecht ou Red Dennis, tous deux sont à l'extrême limite de leur instrument, à ce stade-là ne reste plus qu'à tout envoyer bouler à grands coups de pieds ou à fracasser sur scènes, leur manque la porte de sortie, la sortie de secours naturelle du rock 'n'roll, la sublimation vocale, le chant. La mue finale. Le passage à un autre état de la matière. La sublimation alchimique. Mais pour Al Willis qui assure le chant et la guitare, l'on devine qu'entre le chanteur, la guitare et le vocal, l'un des trois éléments est de trop. Faudrait dés-oblitérer la partie instrumentale du timbre vocal qui n'apporte rien d'essentiel à la raucité sonore de l'instrument. Tous les trois sont boderline, deux dans le manque de ce qui leur est retranché et un autre dans l'ajout de ce qui ne lui est pas supprimé.
Le public leur réserve la grande ovation. Avec des morceaux totalement revisités comme Big Fool, Angelina, Goin' Mad ou Goin' Mad, ils nous ont menés au point de rupture. Ne reste plus au serpent du rock'n'roll qu'à retourner sur ses pas ou à se mordre la queue.
THE SOUTHERNERS

Apparemment ils sont attendus. Le pourcentage de densité au mètre carré de la population rock'n'roll augmente subitement de façon exponentielle devant la scène. N' y a que le plateau qui semble étrangement désertique. Sont annoncés depuis cinq minutes mais il n'y a de présent que Vivi sagement assis derrière la batterie. Les autres vont et viennent d'une démarche hésitante. Tapotent l'air de rien sur les micros comme si la situation était normale. Faut se rendre à l'évidence, il en manque un. Le contrebassiste. L'arrive enfin et l'on comprend tout. Mais oui ! C'est bien lui, c'est Pascal Albrecht qui vient de livrer un set frénétique avec Al Willis. On lui pardonne le temps qu'il lui a fallu pour endosser une chemise propre et se réhydrater. En tout cas les Southerners ont un gros défi à relever et ils sont responsables ( à 33, 33 % ) de la rude tâche qui leur incombe. Entre nous, paraissent pas inquiets.

Moi par contre, je me fais du mouron pour P'tit Loup. Quand je me remémore l'espace qu'il a occupé sur l'estrade du New Morning voici deux semaines je me soucie fort de la possibilité de sa prestation sur les deux mètres carrés – en comptant très large - de l'étroite bande de terrain encombrée de fils qui lui sont alloués sur le devant de la scène, me demande comment il va faire. Pas le genre d'animal à rester planté derrière son micro. Le confirme tout de suite. Le combo n'a pas démarré depuis plus de quarante secondes que pied de micro en mains, à froid et sans préparation il effectue un grand écart digne d'une danseuse étoile, mais les boots apportent à l'exercice une note stylisée à l'extrême à laquelle des ballerines ne sauraient atteindre, s'en relève d'un saut catapulté en trois dixièmes de seconde et commence à chanter comme si de rien n'était.
Ce n'est qu'un début. Ne va plus s'arrêter jusqu'à la fin. Sont des vieux routiers, ont compris que l'on ne répond à un maximum de rock'n'roll que par un super maximum de rock'n'roll. La ligne d'horizon est dégagée. N'y a plus qu'à foncer. Leur faudra exactement trois morceaux pour emporter le challenge. Et si le micro de P'tit Loup avait été convenablement drivé à la table de mixage, suis prêt à parier que la prise en main aurait été plus rapide. C'est que les Southerners ont un truc en plus. Ont été précédés par trois bons groupes. Qui ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais leur a manqué l'essentiel. Cessez de leur jeter des regards suspicieux. Ils ont rempli leur contrat, eux. Nous et vous, non. Public réceptif, et admiratif. Mais éteint. Pas mal de jeunes pourtant. Mais nous a manqué la fièvre. Pas frileux, mais pas chaud. Et les Southerners vont rallumer la flamme.

La musique élémentale. Sans laquelle rien ne serait. Est indispensable. Mais aussi cet esprit de rébellion constitutif au rock'n'roll. Le rock'n'roll ce n'est pas de la bonne musique qui vous permet de construire votre niche écologique de survie dans un monde pourri que vous rejetez et dont vous cherchez à atténuer les effets dévastateurs sur votre douillette existence. Non le rock'n'roll est une étamine que vous hissez bien haut pour déclarer la guerre au reste du monde. Vous clamez votre unicité et vous la revendiquez haut et fort. Avec leur veste découpée dans le pavillon sudiste les Southerners ne mettent pas leur drapeau dans leur poche. One, Two, Three, Four, Five, Rock 'N' Roll Is Still Alive ! Slogans teddies à l'idéologie douteuses diront certains, mais symboliques d'un rock qui ne veut pas se considérer comme une excellente musique d'écoute. Un rock qui se veut vecteur d'une énergie revendicatrice et rebelle au formatage systémique et consensuel en vogue. C'est en se faisant phagocyter par le mythe de la respectabilité culturelle que le jazz est devenue une musique trop éloignée des préoccupations de la révolte noire pour être encore signifiante et opératoire... Et il ne faudrait pas que le rock s'aventurât sur de telles pentes mortifères.
Pascal ne slappe pas de la même manière qu'avec Al Willis. N'a plus besoin d'une telle radicalité. Il frappe encore mais tire aussi sur les cordes du bout des doigts. C'est qu'il a retrouvé son exutoire naturel, le chant. Debout appuyé sur sa contrebasse, le visage penché sur le micro parallèle au manche, l'est dans la position de l'orateur qui harangue la foule. Joue un duo fabuleux avec P'tit Loup qui chante et danse. Le corps comme lieu et expression du mime. Dire, et joindre le geste au même instant. Il est en même temps le chant et le reflet du chant. Extraordinaire showman, il ne joue pas un personnage, il exprime ce qu'il ressent, ce qu'il est. Les Southerners incarnent le rock d'une innocence perdue et retrouvée.

Changement de dimension avec tout ce qui a précédé. Toute une partie du public exulte. Chante en choeur. A un moment P'tit Loup se contentera de tenir le micro et lui laissera entonner les refrains et les couplets. Osmose frénétique. N'y aura pas de rappel. Iront d'un seul trait jusqu'au bout du temps imparti, car il est des moments magiques de communion et d'osmose qu'il est inutile de rompre artificiellement. Ont transformé la patate chaude en Patache Chaude. Un véritable brûlot de combat pour le rock'n'roll.
THE BE BOPS
Sont bien gentils et sympathiques. Mais après la décharge d'adrénaline que l'on vient de vivre, le compte n'y est pas. Le public s'éclaircit. Moi-même n'irai pas plus loin que le sixième morceau. Le temps de m'apercevoir que le contrebassiste d'un âge respectable, si j'en juge sa calvitie avancée, chante d'une manière plus incisive que le jeune singer lead-guitar à la tête totalement rasée. Un peu poussif. Manquent d'entrain. L'on aurait dû les mettre en tout premier, mais après les montagnes que l'on vient de gravir l'on trouve ces coteaux modérés bien trop plats. Je me donne l'excuse du dernier métro, mais pour n'importe lequel des quatre groupes précédents j'aurais rejoint la teuf-teuf mobile à pieds sans rechigner.
RETOUR
Ne regrette pas la soirée. Beaucoup de monde. De belles rencontres. M'attarde sur le souvenir de cette jolie demoiselle assise à mes pieds sur le rebord de la scène. Quand elle a sorti son portable j'ai cru qu'elle allait faire des photos de P'tit Loup, mais non s'est contentée durant tout le set de visionner dans sa banque de données deux auto-portraits de son propre visage. Ma foi très agréable. Comme quoi, tout le monde n'entretient pas le même rapport que moi au rock'n'roll ! C'est tout de même fou comme l'espèce humaine est narcissique ! Mais le rock n'est-il pas un reflet de la fugacité de la jeunesse ?

Damie Chad.
( Photos prises sur le facebook des artistes / en partie anciennes pour The Southeners )
01:15 | Lien permanent | Commentaires (0)



Les commentaires sont fermés.